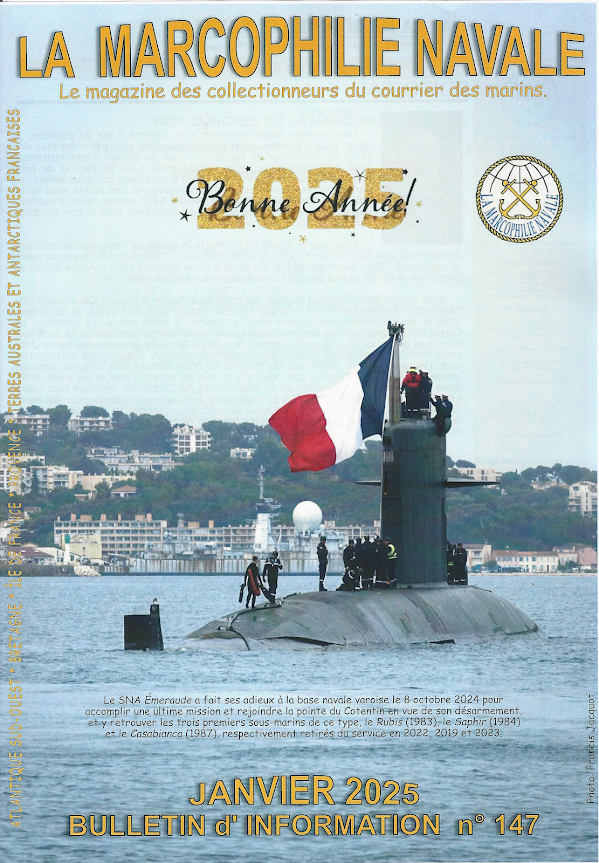BSAOM CHAMPLAIN Glorieuses Juan de Nova
Nous sommes repartis en mission le 19 novembre avec l’équipage B du Champlain dans le canal du Mozambique, pour la dernière tournée de ravitaillement des îles éparses (TRDI) de l’année 2024.
Un peu d'histoire
Le 10 mars 1952, le haut-commissaire de la République Française de Madagascar passe contrat avec la SOFIM (Société Française de Madagascar). Monsieur Hector Patureau, un franco-mauricien de 65 ans, frère de Maurice Patureau, grand gaulliste compagnon de la Libération, en est son directeur. L’objet de cette société est l’extraction de phosphate de l’île de Juan de Nova.
Monsieur Patureau vit dans la capitale, Port-Louis, en grand seigneur, très urbain, il a son avion personnel et il survole toute la région selon ses envies, en quête de fortune. A Juan de Nova, il a fait ériger au centre de l’île une grande maison qu’on appelle « Coin de France », une splendide habitation surveillée par ses cadres comme un château fort, d’accès très règlementé. Lorsque monsieur Patureau est présent, vers les 17 heures, il se rend sous la grande véranda prendre le thé, tout habillé de blanc, comme s’il était à Londres.
Le patron embauche à sa façon, des Seychellois et des Mauriciens, ils sont environ cent-vingt. Ses recruteurs choisissent dans la population de personnes endettées, des personnes en grand besoin d’argent, et, contre des promesses mirobolantes, il réussit à les emmener au paradis qu’est Juan de Nova, facilement. Pour avoir la signature au bas du papier, il propose une avance immédiate de 200 ou 300 roupies, ce qui est très convaincant, puis surplace, une maison équipée de réfrigérateur, et même une bicyclette pour les déplacements les jours de congés. Ces pauvres gens ne savent pas qu’en signant ce document, ils signent un retour au 18e siècle, au temps de l’esclavage.
Les logements ce sont de baraquements sommaires, en tôle, comme des boxes à chevaux, sans frigo, et le soleil qui tape toute la journée sur le toit les rend inhabitables, étouffants.
Il fournit par ouvrier, trois kilos de riz par mois, du sel, un peu d’épice, et aucune protéine. Les autres produits indispensables, ils doivent acheter à l’entrepôt de l’île. Les prix pratiqués à l’époque, dépassent de vingt pour cent ceux de La Réunion, déjà les plus chers de l’océan Indien. En moyenne, un ouvrier gagne cent-vingt-cinq roupies par mois, et plus de soixante passent en achats dans la boutique de monsieur Patureau.
Il existe aussi un règlement intérieur : pas d’alcool et pas de femmes dans l’île, ce qui incite l’homosexualité, admise en catimini. Les cadres qui ont la charge du respect de ces consignes sont trois : Dumeville, sinistre individu, interdit de séjour à Maurice, Betuel et Lemarchand. Le Seychellois Lemarchand, ancien marin britannique de cinquante-cinq ans, un baroudeur au long visage buriné, la peau bouffée de psoriasis, est une sorte d’intellectuel, en plus du français il parle l’anglais, et comprend tous les créoles. Ces contremaitres se promènent sur les chantiers, distribuant des cigarettes et des châtiments, selon les mérites des travailleurs.
Dans ce paradis, existe une prison, en réalité, deux vétustes baraques. Les coupables sont à la merci des humeurs des contremaitres. Ils font la loi. La pratique du fouet, et même des flagellations sont courantes. Le fouet est un magnifique outil en peau de rhinocéros, et il a même un nom : Taisez-vous.
Chaque dimanche se déroule la cérémonie du lever du drapeau. Tous les travailleurs sont alignés et au garde-à-vous. Ils accompagnent des yeux la montée du drapeau tricolore. Ensuite, ils doivent mettre un genou à terre et réciter un texte inventé par monsieur Patureau, qui vante tout à la fois ses louanges et celles de la France.
Les météorologues Alain Hoarau et Raphaël Folio, pionniers de la météo dans les îles éparses en ces années-là, ont été des témoins oculaires de ces exactions. Raphaël n’a pas mâché ses mots dans une publication écrite au vitriol qui a fait grand bruit dans le milieu administratif, éveillant sans doute, la curiosité des responsables réunionnais qui finiront par s’intéresser à l’affaire.