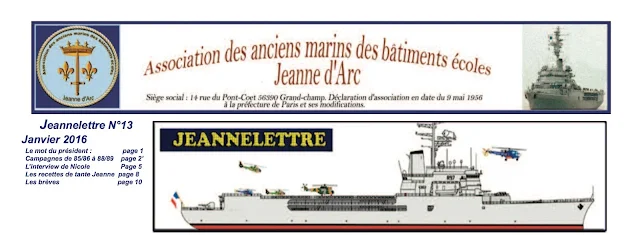Ah le bon vieux temps
Depuis quelques temps, mon entourage ne parle que du « bon vieux temps », ces trente glorieuses où il faisait bon vivre. Epoque bénie du respect et de l’amour de l’autre. En ces temps là une concierge armée d’un balai mettait en fuite des tireurs de sonnettes qu’aujourd’hui une compagnie de CRS aurait du mal à disperser.
Ayant connu tout cela je leur donne raison.
Nous vivions dans des appartements insalubres et surpeuplés avec eau et « cagadou » sur le palier. Nous nous rendions à l’école où un maitre en blouse grise ou en soutane nous apprenait d’indispensables éléments d’orthographe ou de calcul à grands coups de règle ponctués de baffes mémorables. Les écoles de frères allant parfois un peu au-delà de leur mission et ce ne sont pas Montherlant ou Roger Peyrefitte qui s’en sont plaints ( Léo Ferré peut être mais son avis ne compte pas).

Nous partions en vacances sur des routes meurtrières, dans des voitures qui puaient l’essence et ne manquaient jamais une occasion de tomber en panne ou de s’écraser contre un platane. Pour faire découvrir le monde à la jeunesse nos gouvernements avaient imaginé le concept de « guerre coloniale » qui consistait avec une bande de copains armés d’une mauvaise pétoire et d’un pack de bière à occuper un piton rocheux. Autour de cette forteresse improvisée une horde d’infidèles aussi méchants et sanguinaires qu’aujourd’hui s’apprêtait à nous égorger. On attendait alors que les HSS* des commandos marines viennent nous délivrer.
L’hôpital était alors autrement plus pittoresque. On était transporté par d’improbables ambulances pour y être entreposés dans des salles communes où nous jouissions du spectacle de tous les maux de la terre. Les médecins que ne contraignaient aucune loi ou poursuite nous envoyaient « ad patres » à la première incartade ou manifestation d’impatience.

Ne parlons pas de l’amour qui se pratiquait à la sauvette, et se terminait en désastre.
Enfin ultime bonheur l’écologie n’existait pas et ce ne sont pas les quelques fumées d’usines chimiques du nord de Paris ou de Lorraine qui perturbaient la santé ou la couche d’ozone. Tout au plus la mortalité des enfants d’Aubervilliers explosait un peu.
Temps heureux à jamais révolus…
Cela dit nous étudierons la semaine prochaine un vieux temps encore plusse bon celui de la vie en Lorraine à l’époque de la guerre de trente ans
A la semaine prochaine
Donec
* HSS : hélicoptère Sikorsky S58 appareil mythique (construit sous licence par Sud Aviation) qui œuvra dans la Marine Nationale, en particulier pendant la guerre d’Algérie