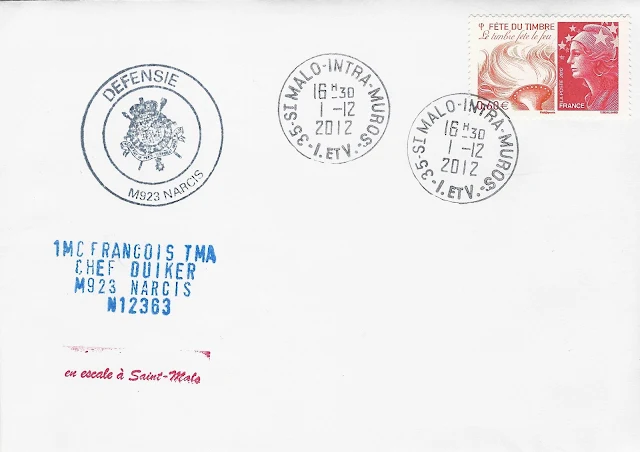Musée de la Marine Paris 1974 - 600 ans de constructions navales
Le musée national de la Marine est issu d'une collection offerte au roi Louis XV par Henri Louis Duhamel du Monceauinstallée au Louvre de 1752 à 1793, puis de 1827 à 1939. La collection permanente du musée est exposée depuis 1943dans l'aile Passy du Palais de Chaillot à Paris. Le musée est un établissement public à caractère administratif depuis 1971 et possède des antennes à Brest, Rochefort, Toulon et Port-Louis. Il traite aujourd'hui de toutes les marines à travers ses collections et ses expositions temporaires.
En mai 1974, l'exposition s'ouvre au Musée de la Marine
C'est dans un musée de la Marine transformé que se tient depuis le 17 mai à Paris l'exposition « 600 ans de constructions navales » consacrée à l'histoire des arsenaux et chantiers navals de la Marine française du XIVe siècle à nos jours. Importante manifestation culturelle et technique qui retrace le chemin parcouru depuis 1374, date à laquelle le roi Charles V signait la réorganisation du Clos des Galées de Rouen et confiait à Etienne de Brandis la charge du premier arsenal royal créant ainsi la première direction de constructions et armes navales
La voile et l'aviron furent depuis l'Antiquité les deux principaux moyens de propulsion des navires de haute mer. L'aviron présente un avantage sur la voile : il libère le bâtiment de sa sujétion au vent, élément naturel que le marin ne peut totalement contrôler. L'histoire de la propulsion vélique
est marquée par une date importante : celle où l'homme a pu réduire l'angle de route près du lit du vent. Cette phase a été atteinte par un redécoupage de l'espace de la voile, par une division de sa surface, par une nouvelle répartition des plans de toile le long de l'axe du navire.
Mais ce progrès s'est toujours heurté à plu- sieurs écueils. D'abord, celui de la zone du vent debout qu'un voilier ne peut jamais vaincre intégralement, ensuite, celui de l'absence ou de la surabondance de vent qui sont tous les deux (et particulièrement le premier) des entraves à la bonne marche du voilier.
« Je désire connaître. Messieurs, le nombre et l'espèce des bâtiments qui ont été construits dans les ports de votre district, depuis le 1er janvier 1762, jusqu'au dernier juin 1786. Vous voudrez bien, en conséquence, dresser un état général de ces navires, d'après les actes de propriété, devis de construction et certificats de jauge, qui ont dû être enregistrés dans votre greffe, conformément aux ordonnances, et suivant pour la forme de cet État, le modèle ci-joint. Je vous prie de vous en occuper sans délai et de me l'adresser le plus promptement qu'il sera possible... »
Enquête a été lancée par une circulaire du 5 novembre 1786, destinée aux officiers des différents sièges d'Amirauté de la France
Les deux « géants » de la construction navale française se trouvent donc être Nantes et Bordeaux. S'ils ne totalisent que 1 5 % environ du nombre des navires construits, ils représentent ensemble 29,5 % du tonnage global de la France. Ils sont suivis par trois « moyens » : Bayonne, Saint-Malo et Toulon, soit ensemble, environ 18,5% du nombre des navires et 22% du tonnage. Ces 5 amirautés totalisent donc 33,5 % des navires et près de 51 % du tonnage. Les deux premières amirautés disposent donc des navires du plus fort tonnage moyen : respectivement 273 et 1 78 tx.
Remarquons d'emblée que cette situation ne se retrouve pas dans la composition des flottes en service, si du moins l'on en croit le Moniteur de 1792. D'après ce document, on peut calculer la jauge moyen ne des flottes des grands ports français comme suit : Lorient 478 tx, Nantes 384 tx, La Rochelle 372 tx, Bordeaux 340 tx, Honfleur 223 tx, Marseille 220 tx, Le Havre 136 tx, Saint-Malo 75 tx. L'analyse géographique ne manque pas d'intérêt.
Les chantiers de la Manche sont très actifs, puisqu'ils produisent un tiers des bâtiments français. Mais ils sont dispersés en une série de petits et de moyens centres de construction. Seule l'amirauté du Havre arrive à rivaliser de justesse avec celles de Marseille, Saint- Malo ou Bayonne. Les handicaps ne manquent pas : efficacité du blocus anglais en temps de guerre, situation nautique de la Manche défavorable, concurrence proche de la Hollande, de l'Angleterre, éloignement relatif par rapport au commerce essentiel des Antilles, etc.
sources :
Ville de Paris / Bibliothèque Forney / Roger-Viollet
Les constructions navales en France pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle
Jean Meyer T. J. A. Le Goff
Cols bleus