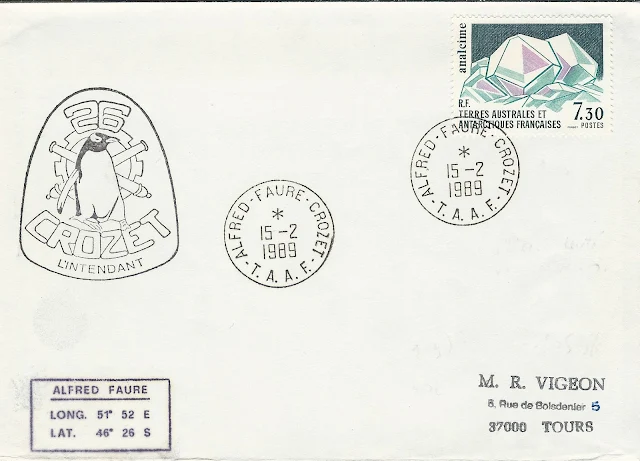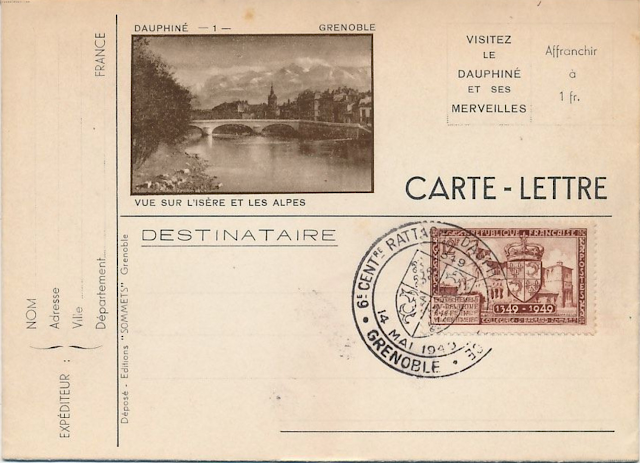Marion Dufresne OP1-23 TAAF Saint-Paul Amsterdam 9-4-2023
Une manip de dépollution a eu lieu au sein même du cratère Saint-Paul le 11 avril dernier. L’objectif était double, ramasser le plus de déchets possible et scruter le sol à la recherche d’indices de présence de rat, espèce éradiquée en 1997 mais dont quelques doutes subsistent quant à la présence d’individus.
Entrer dans un endroit aussi majestueux en regardant ces imposantes falaises qui nous surplombent et baisser les yeux pour y ramasser tout ce que le cratère accumule en plastique est un effrayant contraste. La quantité de détritus sur le bord du cratère est désolante pour un endroit ainsi perdu à des milliers de kilomètres de la première ville et où la présence humaine est très ponctuelle. Cordage et matériaux de pêche, bouteilles de plastique de toute provenance (Japon, Indonésie, Allemagne…), brosses à dent, sandales… L’énumération entache l’idée même de paradis inviolé que représente à nos yeux cette réserve en protection intégrale.
Une île et des naufrages. Sur le blog d'Amsterdam la découverte de restes du naufrage du Meridian.
Le 4 décembre dernier, lors d’une mission de reconnaissance dans le cadre du programme de restauration des écosystèmes insulaires de l’océan Indien (RECI) dans le secteur de la Pointe Vlaming, l’équipe de « mamintro » de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, composée de Samuel Uzan-Allard et Clément Legeay, a pu observer quelques débris de céramique dispersés sur le sol.
La présence d’une inscription sur un bouton en cuivre observé sur le site indique la ville de GRAVESEND qui est le lieu de départ d’un des navires ayant fait naufrage au sud de l’île Amsterdam : le Meridian.
c
Ce bateau, parti de Gravesend en Angleterre, naviguait à destination de Sydney avec à son bord 84 passagers (dont 17 femmes et 41 enfants), pour la plupart émigrant vers l’Australie, et 23 membres d’équipage.
Le navire fit naufrage le 24 août 1853 à proximité de la Pointe Vlaming. Trois personnes dont le capitaine périrent durant le naufrage tandis que les autres parvinrent à regagner le rivage.Le récit d’un des naufragés, le juge Alfred Lutwyche qui avait choisi d’émigrer en Australie, fut publié à Melbourne dès février 1854. Il est également paru dans les numéros 83 à 85 de la Revue australe et polaire éditée par l’AMAEPF.
Il nous apprend ainsi les conditions du naufrage, raconte l’établissement d’un campement de fortune puis le sauvetage.
Les naufragés eurent en effet la chance d’être repérés une semaine après le naufrage par le navire baleinier le Monmouth. Il leur fallut cependant un ultime effort avant d’embarquer, ils durent traverser l’île à pied en plusieurs jours pour atteindre un lieu d’embarquement moins périlleux (probablement situé dans le secteur de la base Martin de Viviès). Le 9 septembre, tous les passagers étaient enfin à bord du Monmouth. Le bateau mit alors le cap vers l’île Maurice où il arriva le 26 septembre. La plupart des passagers reprirent la direction de Sydney quelques semaines plus tard et atteignirent ainsi l’Australie le 30 décembre 1853.
"Le Meridian, une barque de 579 tonneaux, sur laquelle
j'ai navigué au départ de Gravesend le 4 juin 1853, a fait naufrage quelques minutes après 7 heures au soir du mercredi 24 août suivant à la pointe sud-ouest de l'île d'Amsterdam dans l'océan Indien.
Le Meridian faisait partie d'une ligne de paquebots assurant le commerce et le transport des passagers vers l'Australie Les propriétaires étaient MM. Carter and Co., de Leadenhall street, Londres, c'était un bon navire dans sa classe. Construit par MM. Hall, de Sunderland ; ses charpentes et ferrures étaient de chêne vivant et de teck, et sa ferronnerie était d'une réalisation très supérieure.
Elle était, en effet, aussi forte que le bois et le fer pouvaient le faire, et elle fut classée chez Lloyd's A. 1. pendant 13 ans. Elle pourrait porter avec sécurité une grande surface de toile, ses espars étant d'une taille et résistance habituelles, assez grandes, en effet, pour un navire de 900 tonnes. Ainsi surmâté, le Méridien était très maniable et, par conséquent, inconfortable en tant que navire à passagers, mais ce défaut de surmâtage a été providentiellement converti, comme la suite le montrera, en l'un des principaux moyens de notre délivrance. Le navire n'avait qu'un an, ayant fait son premier voyage à Moreton Bay en 1852, avec des émigrants du gouvernement, sous la direction du même commandant, le capitaine Richard Hernaman, un navigateur compétent et expérimenté, qui avait lui-même fait le voyage à Sydney quatre fois, et qui était à tous égards qualifié pour gagner la confiance et l'estime à la fois de ses passagers et de son équipage.
LUTWYCHE, Alfred, Récit du naufrage du Meridian sur l’île d’Amsterdam, Revue Australe et Polaire, N°83 à 85, juillet 2018- décembre 2018- juillet 2019, Amicale des Missions Australes et Polaires
Sources
A narrative of the wreck of the Meridian, on the island of Amsterdam
Date : 18/05/23 2:14 AM
https://nla.gov.au:443/tarkine/nla.obj-52793640
National Library of Australia Récit du naufrage du "Meridian" sur l'isle d'Amsterdam (nla.gov.au)
VERDENAL, Yannick, Voyage austral dans le temps, Saint Paul et Amsterdam édition Gérard Louis (septembre 2004)