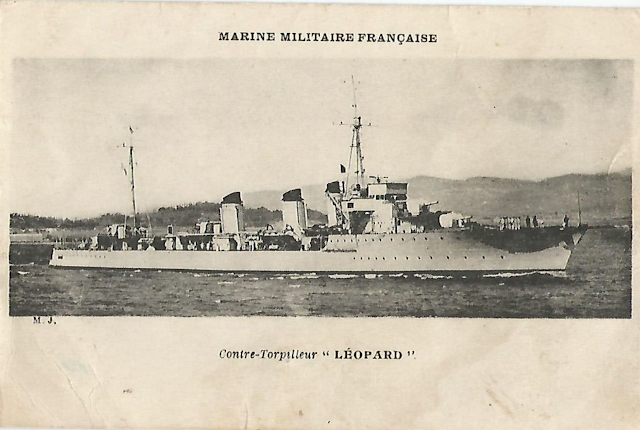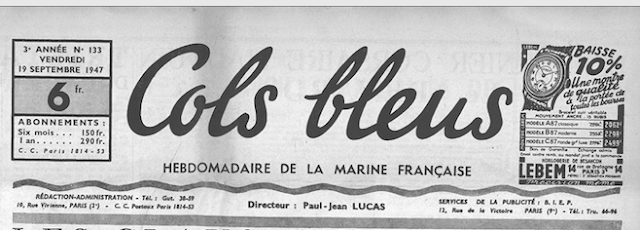Avec le phare d'Assinie, qui s'est effondré dans la mer, à la fin de novembre 1941, c'était, proportionnellement à son littoral, la colonie la mieux équipée au point de vue signalisation maritime.
Ce balisage comprend : le phare de Tabou, ceux de Sassandra, du Grand Lahou, de Port-Bouët, le feu du wharf de Port-Bouët, le phare de Grand Bassam, le feu du wharf de Grand Bassam, et les deux balises de Grand Bassam.
Le phare de Tabou est construit sur un rocher formant presqu'île à l'embouchure de la rivière Tabou (Pointe Sud).
Cette tour de 10 mètres de haut est aérée et éclairée par une meurtrière placée sous le vent. Elle est surmontée d'une lanterne et l'angle de visibilité est de 190°. De portée relativement réduite, il serait souhaitable que ce feu ait une portée moyenne de l'ordre de 20 milles par temps moyen.
Le phare de Sassandra
Ce phare est construit sur le sommet d'une colline à 1.200 mètres dans le Sud-Ouest de la ville , sur une côte bordée de rochers. La tour a 5 m. 70 de hauteur, et l'angle de visibilité est de 250°. Or, il serait utile de donner à ce phare, une portée de 12 milles environ. Il a été proposé par les techniciens, un éclairage au gaz , en remplacement de l'actuel éclairage au pétrole dont l'installation pouvait subsister comme appareil de secours.
 Le phare de Grand-Lahou et de Port-Bouët
Le phare de Grand-Lahou et de Port-Bouët
La Tour de Grand Lahou a été construite sur le bord de la plage dans l'ouest de l'embouchure de la rivière Bandama sur une côte bordée de cocotiers. Elle a une hauteur de 10 mètres et son angle de visibilité atteint 180°. On estime qu'une installation identique à celle de Sassandra constituerait une amélioration en rapport avec les besoins actuels ; un jeu donnant une lumière de 4 secondes et une occultation de 1 seconde , seraient souhaitables ,
 A Port-Bouët, c'est q'une tourelle quadrangulaire en béton , construite en 1932. Le phare est situé à 120 mètres environ de la plage, à 200 mètres dans l'ouest de l'enracinement du wharf. Bien des travaux sont à entreprendre en vue de redonner à ce phare toute la valeur qu'il aurait dû garder.
A Port-Bouët, c'est q'une tourelle quadrangulaire en béton , construite en 1932. Le phare est situé à 120 mètres environ de la plage, à 200 mètres dans l'ouest de l'enracinement du wharf. Bien des travaux sont à entreprendre en vue de redonner à ce phare toute la valeur qu'il aurait dû garder.
En parlant de Port-Bouët, signalons le feu du wharf. Son véritable rôle consiste surtout à marquer l'extrémité du wharf car , du large, il se confond facilement avec les autres feux . Aussi , ne peut-on compter que difficilement sur lui.
De base carrée et d’une hauteur élevée à trois étages le phare de Port Bouët est fait de béton et de barre de fer. Les marches de ses escaliers sont à l’extérieur et évoluent en spirale au niveau des quatre côtés du phare. Il est ventilé par plusieurs claustras et sa tour est de forme cylindrique vitrée Le rez de chaussée présente une porte et deux fenêtres en bois Il sert depuis sa construction, de signalisation maritime par son puissant système d’éclairage.
Le phare de Grand-Bassam Celui-ci apparaît en haut d'une tour de 27 mètres de haut et est situé près à l'intérieur dans le nord de la lagune ; sa visibilité, médiocre la nuit, est presque nulle le jour, car il est masqué, dans le sud-ouest , par les arbres. D'autre part, l'évaporation presque continuelle des eaux de la lagune et les embruns de la barre gênent sérieusement sa visibilité .  Le phare d’Assinie
Le phare d’Assinie C'est l'ancêtre de tous ceux de la côte ; il fut construit en 1907 et finit sa carrière, dans la mer, pendant la nuit du 28 au 29 novembre 1941,
GÉO-MOUSSERO
Il existe deux phares dans la région d’Abidjan en Côte d’Ivoire, le phare de Petit Bassam ou Port Bouët sur le le port d’Abidjan (Port Bouët est le port d’origine dans la région d’Abidjan. Situé à environ 5 km à l’est du canal Vridi à Port Bouët) et celui de Grand Bassam (Première capitale de Côte d’Ivoire, la ville de Grand-Bassam est un exemple urbain colonial de la fin du xixe siècle et de la première partie du xxe siècle) situé à environ 40 km d’Abidjan, mais celui-ci est éteint. Ce dernier est classé au Patrimoine Mondiale de L’UNESCO.
Port Bouët ou Petit Bassam :Étalée tout le long du littoral sur une dizaine de kilomètres au-delà du canal de Vridi, Port-Bouët porte le nom du commandant Bouët Villaumez qui, en 1837, fut chargé par le roi de France de conclure des traités de commerce et de protection avec des chefs côtiers. C’est en fait vers 1930 que Port-Bouët commença à être habité. La construction du wharf draina à ce moment toute une activité de manutention des marchandises. Le célèbre phare de Port-Bouët qui balaie la mer sur un rayon de milles marins fut construit à cette époque.
Grand Bassam :Grand-Bassam, une ville située à environ 40 km à l’est de Port Bouët, à l’extrémité est de la Lagune d’Ébrié, était brièvement la capitale coloniale française (1893-96). Le phare a marqué une entrée de la lagune qui a été asséché, donc il n’y a pas de port moderne.
 Situé à Ancien Bassam, l’établissement français d’origine, sur l’île barrière séparant l’océan de Lagune Ouladine à Grand Bassam
Situé à Ancien Bassam, l’établissement français d’origine, sur l’île barrière séparant l’océan de Lagune Ouladine à Grand Bassam
Situé au quartier du même nom, ce bâtiment de 24m de haut, rappelle l’essor économique connu par la ville de Grand-Bassam durant l’époque coloniale.
Ses travaux qui durèrent un an, s’achevèrent en 1914 mais ce n’est qu’en 1915 qu’il sera mis en service. Sa lanterne d’une portée de 33 km a permis l’orientation de bon nombre de bateaux aux larges des côtes ivoiriennes. Il est éteint en 1951 lorsque le port d’Abidjan est inauguré.
Aujourd’hui, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en même temps que la ville.
 Côte d’Ivoire : Port-Bouët
Côte d’Ivoire : Port-Bouët
Avant l’ouverture du canal de Vridi, le trafic des marchandises s’est fait sur des rades foraines situées aux débouchés en mer, des lagunes. Le trafic des marchandises sur ces rades foraines était rendu très difficile par la présence de la barre, phénomène de déferlement de la houle sur le rivage. C’est ainsi qu’a été construit le premier wharf (Appontement s’avançant dans la mer pour permettre aux bateaux d’accoster) à Grand- Bassam en 1897, puis un second wharf plus long et plus large, en raison de l’augmentation du trafic, a été mis en service en 1923. Pour décongestionner Grand- Bassam, dont le deuxième wharf était devenu insuffisant, il a été mis en service en 1931, un wharf à Port- Bouët. Cet emplacement avait été choisi intentionnellement près d’Abidjan, au lieu d’agrandir celui de Grand- Bassam, pour inciter toutes les installations commerciales à s’établir à Abidjan, là où devait être établi le futur Port ainsi que la capitale. En 1951, fut mis en service le wharf de Sassandra.
 Ces trois wharfs sont actuellement supprimés :- wharfs de Grand- Bassam et de Port-Bouët en 1951 après la mise en service du canal de vridi ;- wharf de Sassandra en 1971 après l’ouverture de port de San-Pedro. Port Bouët, porte le nom du Commandant Bouët Villaumez, qui fut chargé par le roi de France de conclure des traités. C’est vers 1830 que Port Bouët commença à être habité. La construction du wharf draina alors touts une activité de manutention des marchandises.
Ces trois wharfs sont actuellement supprimés :- wharfs de Grand- Bassam et de Port-Bouët en 1951 après la mise en service du canal de vridi ;- wharf de Sassandra en 1971 après l’ouverture de port de San-Pedro. Port Bouët, porte le nom du Commandant Bouët Villaumez, qui fut chargé par le roi de France de conclure des traités. C’est vers 1830 que Port Bouët commença à être habité. La construction du wharf draina alors touts une activité de manutention des marchandises.
L’ouverture du canal de Vridi déplaça ces activités vers le d’Abidjan. Depuis Port Bouët est devenu l’aéroport international d’Abidjan.
Une première demande pour la construction d’un wharf en lagune est introduite par la CFAO en 1906. Ce n’est qu’en 1931, en effet, que le wharf de Grand-Bassam fut doublé par un autre, à Port Bouët. . Du port, il ne reste plus que le wharf et des bateaux de pêche ghanéens.
Port-Bouët est l’une des 10 communes de la ville d’Abidjan et comprend le quartier d’Adjoufou, les villages d’Abouabou et de Mafiblé. Elle abrite l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
Étalée le long du littoral sur une dizaine de kilomètres au-delà du canal de Vridi, Port-Bouët porte le nom du commandant Bouët Villaumez qui, en 1837, fut chargé par le roi de France de conclure des traités de commerce et de protection avec des chefs côtiers. C’est en fait vers 1930 que Port-Bouët commença à être habitée. La construction du wharf draina à ce moment toute une activité de manutention des marchandises. Le célèbre phare de Port-Bouët fut construit à cette époque.
La deuxième étape du développement de cette commune remonte à la création du port, en 1950. Usines et entrepôts se multiplièrent ensuite à Vridi qui devint la principale zone d’emplois d’Abidjan. C’est à cette époque qu’une partie de la population de Port-Bouët fut déplacée dans la commune de Yopougon. Elle y fonda le quartier appelé Port-Bouët 2.
 Grand Bassam :
Grand Bassam :
La petite histoire
Achevé de construire en 1914, le phare de Grand-Bassam a cessé de balayer l’horizon de son feu blanc à éclats depuis 1951. Sa tour ronde de 24 m de haut, typique de l’architecture militaire de l’époque, est aujourd’hui une antique relique au pied de laquelle les enfants et adolescents du quartier viennent s’affronter dans des parties de foot animées. Les aventuriers pourront tenter de moyenner une ascension de son vieil escalier en colimaçon auprès des anciens du coin, et profiter ainsi d’une magnifique vue panoramique à 360° des environs, sous réserve, bien sûr, que cela soit encore possible : le phare étant dans un état de ruine avancé, assurez-vous tout de même de ne pas vous mettre en danger.
La ville historique de Grand-Bassam est un exemple urbain colonial de la fin du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle. Elle suit une planification par quartiers spécialisés pour le commerce, l’administration, l’habitat européen et l’habitat autochtone. Elle offre d’une part une architecture et un urbanisme colonial fonctionnaliste adaptés aux conditions climatiques et suivant les préoccupations hygiénistes de l’époque, d’autre part un village N’zima qui met en évidence la permanence des cultures autochtones. Grand-Bassam fut la première capitale coloniale, portuaire, économique et juridique de la Côte d’Ivoire ; elle témoigne des relations sociales complexes entre les Européens et les Africains, puis du mouvement populaire en faveur de l’indépendance.
La construction du phare de Grand Bassam débute en décembre 1913 et s’achève en février 1914. Il est mis en service en mars 1915, et remplace un feu fixe porté par une tour métallique installé en 19011.
Le phare cesse de fonctionner en 1951 avec la construction du phare de Port-Bouët à Abidjan.