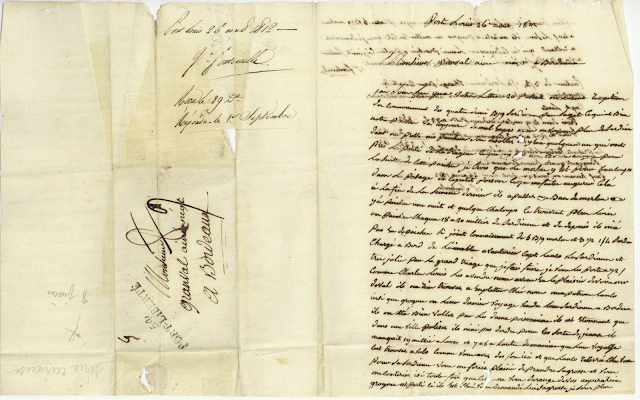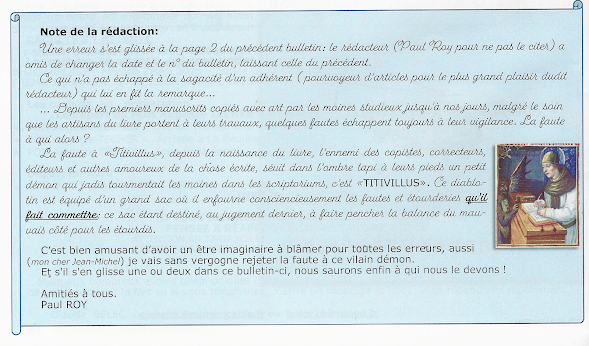Port-Louis Morbihan
En 1589, une première fortification est élevée pour barrer l’isthme qui mène à Blavet. Il s’agit d’un haut talus édifié par les troupes d’Henri IV (1553-1610), quand ces dernières se retranchent dans le bourg assiégé par l’armée du duc de Mercœur, qui a pris la tête de la Ligue bretonne. Philippe-Emmanuel de Lorraine (1558-1602), duc de Mercœur, est alors gouverneur de Bretagne. Il doute de la sincérité d’Henri IV qui n’a pas encore abjuré le protestantisme. À Blavet, les assiégés finissent par céder et les assaillants tuent « tout ce qu’ils rencontrent, sans discrétion d’âge ni de sexe ».Au printemps 1590, plusieurs milliers d’Espagnols envoyés par Philippe II d’Espagne (1527-1598) débarquent à Blavet pour soutenir Mercœur et ses ambitions d’indépendance. Pour Philippe II, c’est aussi l’occasion d’implanter des troupes en Bretagne, lieu hautement stratégique situé à mi-chemin entre l’Espagne et les Pays-Bas espagnols.

Bien que Blavet ait été pillé et incendié par les Ligueurs, les Espagnols aménagent un port pour leur flotte et des logements pour leurs soldats. Puis, en 1591, Cristóbal de Rojas (1555-1614), ingénieur militaire qui a travaillé sur de nombreuses places fortes de la péninsule ibérique, construit el Fuerte del Aguila, le Fort de l’Aigle, à l’extrémité de la presqu’île, sur un promontoire granitique d’environ deux hectares. Ce nom fait référence à Don Juan del Aguila (1545-1602), qui commande les troupes espagnoles implantées à Blavet. Ce fort paraît constitué de deux bastions côté terre et d’un boulevard d’artillerie côté mer, d’un donjon – héritage de l’architecture défensive du Moyen Âge –, de logements, d’une chapelle et d’une estacade pour les bateaux.

En 1598, la signature de la paix de Vervins met fin aux guerres de la Ligue. Les Espagnols sont reconduits vers la péninsule ibérique sur des navires français, à la condition qu’ils détruisent le fort de l’Aigle. Ce dernier n’est cependant que partiellement démoli côté chenal et le front de terre semble être conservé. En 1616, le maréchal de Brissac (1550-1621) se porte acquéreur du fort et reçoit l’ordre de le remettre en état. Car, sur avis de ses ingénieurs convaincus de l’importance stratégique de la rade de Blavet, Louis XIII (1601-1643) a décidé de réédifier le fort et de reprendre en main l’agglomération voisine, Blavet. Cette décision est concrétisée par les lettres patentes du 17 juillet 1618 qui transforment le bourg en cité royale et indiquent que « le lieu-dit Blavet soit retranché, fossoyé, fermé de murailles, bastions et remparts et dorénavant appelé Port-Louis ». Blavet prend alors le nom de Port-Louis et devient symbole de la puissance royale dans une Bretagne contestataire. À la demande du maréchal de Brissac, Jacques Corbineau, aidé de Léonard Malherbe et René Le Meunier, construit la citadelle de Port-Louis de 1616 à 1621.


 La forteresse, édifiée en bordure de l’étroit chenal d’accès à la rade, devient ainsi le centre d’un système défensif élaboré destiné à protéger Lorient : dès 1695, deux ouvrages fortifiés sont implantés dans l’avant-rade puis, à partir du milieu du XVIIIe siècle, le système défensif se densifie depuis l’île de Groix jusqu’à l’intérieur de la rade.
La forteresse, édifiée en bordure de l’étroit chenal d’accès à la rade, devient ainsi le centre d’un système défensif élaboré destiné à protéger Lorient : dès 1695, deux ouvrages fortifiés sont implantés dans l’avant-rade puis, à partir du milieu du XVIIIe siècle, le système défensif se densifie depuis l’île de Groix jusqu’à l’intérieur de la rade.
 La Révolution française signe la fin de la Compagnie des Indes. La Marine réinvestit alors l’ensemble de ses installations commerciales pour développer l’arsenal militaire. À la citadelle, les militaires poursuivent leur mission de surveillance du chenal et de régulation du trafic, les bastions sont rehaussés et les supports des canons bétonnés. Des observatoires camouflés et des soutes à munitions sont également aménagés sur les remparts. Une vigie est construite sur le Grand bastion et, en partie basse, une grande salle voûtée sert de magasin à poudre.
La Révolution française signe la fin de la Compagnie des Indes. La Marine réinvestit alors l’ensemble de ses installations commerciales pour développer l’arsenal militaire. À la citadelle, les militaires poursuivent leur mission de surveillance du chenal et de régulation du trafic, les bastions sont rehaussés et les supports des canons bétonnés. Des observatoires camouflés et des soutes à munitions sont également aménagés sur les remparts. Une vigie est construite sur le Grand bastion et, en partie basse, une grande salle voûtée sert de magasin à poudre.
La Compagnie des Indes
En 1664, Colbert (1619-1683), chargé du commerce extérieur sous Louis XIV (1638-1715), fonde la Compagnie française des Indes orientales pour concurrencer le commerce anglais et hollandais. Les Français, solidement ancrés à l’île Bourbon (actuelle île de La Réunion) puis à l’île de France (actuelle île Maurice), s’installent en Inde à Surate, puis à Pondichéry et à Chandernagor.
Comme leurs concurrents, ils échangent piastres d’argent en provenance de l’Amérique espagnole contre thé, café, épices, porcelaines, lingots de zinc ou toiles indiennes. Ce commerce est à son apogée au début du XVIIIe siècle. En 1706, les difficultés financières de la Compagnie liées aux guerres menées par Louis XIV l’obligent à sous-traiter ses privilèges à des armateurs privés de Saint-Malo et, en 1719, le banquier John Law fonde la Compagnie perpétuelle des Indes dont les bénéfices doivent servir à combler la dette engendrée par le règne de Louis XIV. Mais la guerre de Sept Ans conduit à la fermeture de la Compagnie en 1769. En 1785, la nouvelle Compagnie des Indes orientales et de la Chine prospère rapidement, mais prend fin en 1790 sous la Révolution française.
https://www.musee-marine.fr/nos-musees/port-louis/le-musee-a-port-louis/a-propos-du-musee-de-port-louis/histoire-de-la-citadelle.html