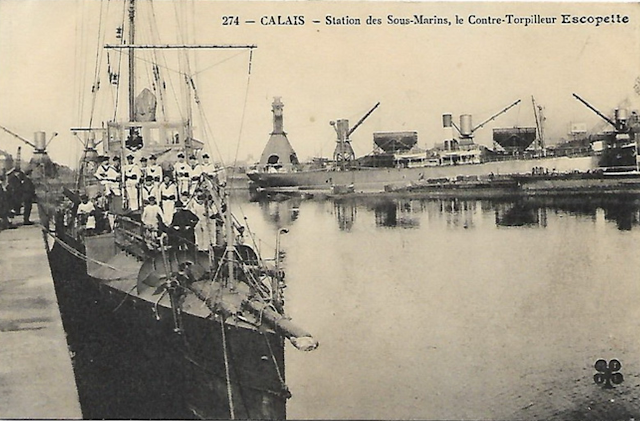AVISO BELFORT FNFL Greenock aéropostale Dakar Natal
Cet article tout simplement parce que le Belfort est devant la grande porte de Saint-Malo. On va parler de tout et de rien, de l'aéropostale, des FNFL, de Greenock...« Tandis que les unités des forces terrestres stationnées en Grande-Bretagne font l’instruction d’éléments destinés à combattre ailleurs, c’est à partir des ports anglais que la plupart de nos forces navales prennent part, sur l’Atlantique, la Manche, la mer du Nord, l’Arctique, à la bataille des communications. Pour le faire, tout nous commande de profiter des bases alliées. Nous n’avons, en effet, nulle part, aucun moyen qui nous soit propre de réparer, d’entretenir, de ravitailler nos navires. A fortiori, ne pouvons-nous pas les doter des moyens nouveaux : défense contre avions, asdic, radar, etc., qu’exige l’évolution de la lutte. Enfin, sur le vaste théâtre d’opérations maritimes dont l’Angleterre est le centre, il faut l’unité technique et tactique des efforts. C’est pourquoi, si les navires que nous armons nous appartiennent entièrement, quelle que soit leur origine, s’ils n’ont de pavillon que tricolore, s’il n’y a, pour les états-majors et pour les équipages, d’autre discipline que française, s’ils n’exécutent de missions que par ordre de leurs chefs, bref si notre marine demeure purement nationale, nous avons admis, qu’à moins d’épisodes qui nous amènent à l’utiliser directement, elle fait partie, pour l’emploi, de l’ensemble de l’action navale menée par les Britanniques."Charles de Gaulle - Mémoires de guerre
Le Belfort est un aviso de la classe Arras lancé en mars 1919 et actif dans la marine française et les Forces navales françaises libres de 1920 à 1946.
 |
| Aviso Belfort devant la Grand'porte Saint-Malo |
Le Belfort est issu d'un programme de guerre, constitué d'une série de quarante-trois avisos dont seules trente unités sont construites. Il est mis sur cale à l'arsenal de Lorient, avec ses sister-ships Bar-le-Duc et Bapaume, puis est lancé en mars 1919.

L’aviso présente une silhouette semblable à celle d'un cargo. Il s'agit de leurrer les équipages de sous-marins, sur le modèle des bateaux pièges Q-ships britanniques camouflés en navires marchands. La passerelle de navigation est placée au centre et englobe la cheminée.
Le navire est propulsé par deux turbines à engrenages Parsons/Bréguet de 5 000 ch, alimentées par deux chaudières chauffées au mazout. Cet ensemble permet de naviguer à une vitesse de pointe de 20 nœuds, avec une autonomie de 3 000 nautiques à 11 nœuds.
L'armement comprend pour la lutte anti-navire et anti-sousmarine deux canons de 138 mm, deux grenadeurs, deux mortiers et une torpille remorquée. La lutte anti-aérienne est menée avec un canon de 75 mm et quatre mitrailleuses antiaériennes de 8 mm.
Le Belfort entre en activité dans la Marine nationale en 1920.
Conçue dans ses principes à Montaudran, aérodrome situé au nord de Toulouse, la « Ligne » — d'abord Société aérienne Latécoère, puis Compagnie générale aéropostale, destinée à relier la France à l'Amérique latine — commença à devenir une réalité le 25 décembre 1918. Ce jour-là, à 8 h 30 du matin, un avion Salmson, construit pour l'armée et piloté par le capitaine
René Cornemont décollait du terrain de Toulouse-Montaudran. L'appareil emmenait un passager : l'industriel Pierre-Georges Latécoère qui s'était mis en tête, quelques mois plus tôt, de lancer une ligne aérienne postale de quelque 13 100 km reliant Toulouse à Buenos Aires. Deux heures et vingt minutes après leur décollage, Cornemont et Latécoère se posaient sur l'hippodrome de
Barcelone. Le premier pas était fait.
Ces bâtiments, Didier Daurat les voulait rapides de façon à ce que ne soit pas perdu en mer le temps gagné par ses pilotes, au prix souvent de prouesses héroïques ; ils avaient été difficiles à trouver.Le financier Marcel Bouilloux-Lafont, qui avait pris la suite de Pierre-Georges Latécoère, avait réussi à convaincre la Marine nationale de lui céder, en location, pour un franc symbolique par an et par bateau, six anciens chasseurs de sous-marins construits au moment où la guerre finissait et qui, de ce fait avaient peu navigué. Ayant été débarrassés de leur canon de 75 et remis en état de prendre la mer après leur longue immobilisation dans le bassin Charles X de l'arsenal de Cherbourg, les avisos devinrent donc civils tout en gardant leur nom d'origine. Pour honorer des villes martyres de la Grande Guerre, ils avaient été baptisés : Péronne, Lunéville, Revigny, Epernay, Belfort et Reims. Autant de cités qui n'avaient aucun rapport avec l'aviation postale d'alors...
Le navire est mis à disposition de la Compagnie générale aéropostale (CGA) en 1927. Cette société opère à cette période deux flottes, en Méditerranée et dans l’Atlantique. Avant la mise en place des traversées aériennes de l’Atlantique, des avisos transportent le courrier entre Dakar (Sénégal) et Natal (Brésil), dont le Belfort.
L'armement de ce dernier est retiré, il est loué pour un franc par an et doit être rendu dans son état d'origine. L'équipage est limité à vingt-deux personnes pour des raisons économiques. Cette situation pose des problèmes d'exploitation des chaudières, conçues pour fonctionner avec une équipe plus nombreuse.
L'aviso est à Natal le 12 novembre 1927, où il s’échoue sans dommage. L’Aéropostale l'utilise jusqu’au 25 janvier 1931, à son retour à Brest. La Marine nationale le récupère le 12 mars 1931 et le place à Cherbourg en réserve normale.
Chaque semaine, un bateau partait de Dakar et un autre de Recife. On se croisait en plein Atlantique. Parfois, à la suite d'un ennui quelconque, il nous arrivait de transborder le courrier et les passagers et de repartir chacun de notre côté...
Entre-temps, l'Aéropostale avait commandé aux chantiers de Bordeaux et de Nantes quatre nouveaux avisos destinés à remplacer les bâtiments en service trop onéreux en combustible et en entretien
La liaison maritime entre Dakar et Natal est d'abord assurée par des avisos loués à la Marine nationale. Vers 1930, ces navires sont remplacés par des avisos spécialement construits pour ce service. Plus robustes et plus rapides, ils permettent d'assurer avec grande régularité la liaison maritime Dakar-Natal. Ils jaugent environ 500 tonneaux et sont mus par des moteurs Diesel développant 1 350 CV. Ils soutiennent une vitesse moyenne d'environ 16 noeuds. Chaque équipage se compose de 25 officiers et marins. L'Aéropostale possède également deux vapeurs se déplaçant de 350 à 650 tonnes, une citerne à eau, une citerne à mazout et quatre vedettes.
Après la transformation en ravitailleur d'hydravion du transport côtier Hamelin de classe Jacques Cœur, décidée en 1928, et avant la Diligente en 1939, le Belfort est modifié en 1935 et livré à la première Région Maritime. Il reçoit sur la poupe une pièce de 75 mm modèle 1891. Une grue est fixée sur l'emplacement du canon arrière de 138 mm.
Le ravitailleur talonne au sud de l’île d’Yeu, sur les rochers de la Tranche, le 15 mars 1938. Il est remorqué à Lorient par l'Aurochs et la Cascade.
Le Belfort est intégré aux actions des Forces Maritimes du Nord. Il connaît des actions de combat sous le commandement du capitaine de corvette Pierre Viel. Les survivants du cargo Douaisien sont secourus le 29 mai 1940 et le torpilleur Cyclone endommagé est escorté le 1er juin vers Cherbourg. Il participe à l’évacuation de Dunkerque le 3 juin et se replie sur Brest le 15 juin.
Le navire part le 17 juin pour Plymouth et fait l'objet d'une saisie par la Royal Navy le 3 juillet. Il est reversé aux Forces Navales de la France Libre (FNFL) en août 1940. Il est transformé en octobre 1942 en bâtiment-base pour la 23e flotille Motor Torpedo Boats basée à Darmouth et sert d'annexe de la Caserne Birot.
 |
| Monument aux FNFL Greenock Ecosse |
1940, premières missions depuis Greenock
Greenock, lieu d’un naufrage dramatique (la perte accidentelle du Maillé-Brézé, le 30 avril 1940), devient rapidement une base majeure pour les FNFL : quelques-uns des rares navires français libres à la disposition du général de Gaulle et Muselier s’y regroupent.
Le Savorgnan de Brazza, déjà. Son premier commandant raconte que l’aviso « appareilla de Portsmouth le 21 août 1940 au soir au beau milieu d’une alerte aérienne, et fit route sur Greenock, évitant de justesse dans le canal de Saint-Georges les bombes de trois avions allemands ».
Il est vite rejoint par le Commandant-Duboc.
« 29 août 1940. Entrons dans l’embouchure de la Clyde. Mouillage à 15h, à Greenock. Mouillons près de l’épave du Maillé-Brézé. Le bâtiment de guerre français a brulé dans le port voici plusieurs mois après la violente explosion d’une de ses torpilles. Il fut conduit dans le milieu du fleuve, où il est maintenant échoué. On aperçoit ses deux mâts et trois cheminées. La 4ème a dû sauter lors de l’explosion. »5
Le 31 août, un convoi de transports de troupes se forme, escorté notamment par les avisos dragueurs Commandant-Duboc et Commandant-Dominé ; les navires s’apprêtent à appareiller – c’est le début de l’opération de Dakar :
« 31 août. Le Commandant-Duboc et le Commandant-Dominé, accompagnés de quelques bâtiments britanniques, escorterons des transports et cargos transportant des légionnaires français avec leur armement […]. Levons l’ancre à 20h. L’équipage, aligné sur le pont, chante La Marseillaise. Nous échangeons des hurras avec l'équipage du Vikings, chalutier armé des FNFL, puis avec les bâtiments britanniques que nous doublons »
En plus des légionnaires, les cargos transportent le matériel et les munitions du Premier bataillon de fusiliers marins (1er BFM) créé par l’amiral Muselier le 14 juillet 1940, dont des éléments sont aussi à la disposition du général de Gaulle ; ceux-ci avaient insisté pour « se battre corps à corps contre le boche, et ce fut l’origine du 1er Régiment des Fusiliers Marins »: ils participent ainsi à l’opération de Dakar, on les retrouvera à Bir Hakeim en 1942.
L’autre convoi en direction de Dakar, celui des transports de charge, est également escorté par des navires français libres, le patrouilleur Président Houduce et l’aviso colonial Savorgnan de Brazza, dont la mission était « de déposer puis de reprendre devant les passes la vedette portant l’équipe des parlementaires du commandant Thierry d’Argenlieu – qui allaient malheureusement être accueillis et atteints par les mitrailleuses de la défense de Dakar…

L’activité des navires français libres à Greenock ne s’arrête pas là. Des bâtiments-bases y sont rapidement amarrés. C’est le cas du vieil aviso Amiens, qui devient une école de mécaniciens, chauffeurs et électriciens, du torpilleur Ouragan, des avisos Arras et Diligente ; tous restent à quai pour servir de bases flottantes. En décembre 1940, enfin, les torpilleurs Léopard et Le Triomphant – ce dernier enfin réparé, après avoir subi des avaries lors d’un raid victorieux dans le détroit du Kattegat entre la Norvège et le Danemark en avril 1940 –, forment à Greenock la première division de torpilleurs des FNFL.
1941 : Greenock devient la base des corvettes françaises libres
En 1941, neuf corvettes sont cédées aux FNFL par la Royal Navy. Trois opèrent dans l’Atlantique sud (Les Commandant-Détroyat, Commandant-Drogou et Commandant-D’Estienne-d’Orves), tandis que les six autres pratiquent l’Atlantique nord et forment les 1ère et 2nde divisions d’escorte, composées respectivement des corvettes Mimosa, Alysse, Aconit et Lobélia, Renoncule, Roselys. Dès 1942, ces six corvettes françaises affectées à la protection des convois sont toutes rattachées au Western Approach Command, à la base de la Clyde, à Greenock. Cette base leur sera d’un grand secours pour les relèves, l’entraînement des équipages, le ravitaillement, les réparations, souvent pendant de très courtes escales de huit à dix jours, tandis que les missions d’escorte de convois durent un à deux mois…
Le rapport de M. Raoul Aglion, intitulé Enquête sur le ralliement des marins à la France Combattante, daté du 1er avril 1943, exprime avec force la condition de ces marins FNFL, tous volontaires et servant sur les corvettes depuis 1941 :
« Dans les FNFL :
1. – La paye est moins élevée que sur les bateaux de l’amiral Fénard ;
2. – La nourriture est moins abondante et moins bonne ;
3. – La discipline y est plus sévère ;
4. – Ils ont 80% de chances de perdre leur vie dans les unités des FNFL alors qu’ils ont 80% de chances de s’en sortir s’ils restent là où ils sont. En effet […] la France Combattante n’a pas de grosses unités. Les marins du général de Gaulle font leur service principalement sur des corvettes qui gardent et protègent les convois. De ce fait, ils sont continuellement en combat avec les sous-marins. La vie sur les cuirassés est beaucoup moins dangereuse, car les sous-marins évitent de les rencontrer.
Les marins auxquels ces discours ont été faits n’ont pas hésité, et ont signé leur engagement malgré ces avertissements sévères. »9
Les corvettes sont en effet de petits bâtiments qui tiennent bien la mer, quoique difficiles à vivre par gros temps, et relativement lents – 16 nœuds, une vitesse cela dit suffisante pour la poursuite des sous-marins submergés et limités à 9 nœuds. « C’étaient des escorteurs tout neufs, d’un millier de tonnes environ, pourvus des moyens de lutte les plus modernes contre les sous-marins », écrit l’amiral Auphan.10 Conçues d’après les plans d’un baleinier, elles devaient pouvoir être construites à bas prix et rapidement, en particulier par de modestes chantiers navals qui se consacraient d’ordinaire à la production de navires marchands ; ainsi plusieurs de ces corvettes, dont l’Alysse, ont été construites à Greenock, aux chantiers navals George Brown & Co ; tandis que les Commandant Detroyat, Lobelia et Roselys ont été construites à Aberdeen, et que l’Aconit et la Renoncule proviennent des chantiers navals de Troon et Renfrew.
Les corvettes françaises s’illustrent en premier lieu durant l’expédition de Saint-Pierre et Miquelon en décembre 1941. Le Lobelia venait tout juste de prendre son service, lorsque l’amiral Muselier s’y embarque, le 24 novembre 1941 à Greenock. Son objectif déclaré : l’inspection des corvettes françaises en missions d’escorte sur la ligne de l’Atlantique nord. Mais sa mission est toute autre. « Parvenu sur les côtes d’Islande et après avoir effectivement inspecté deux ou trois de ces bâtiments, il se transborda sur le Mimosa et mit le cap sur Saint-Jean de Terre-Neuve où il retrouva l’Alysse et l’Aconit. » Cette concentration de corvettes, puissamment soutenues par le Surcouf et ses canons de 203 mm, était supposée effectuer des exercices au large de Terre-Neuve ; si bien que le 24 décembre, lorsqu’elle se présente dans le chenal qui sépare Saint-Pierre de Miquelon, la surprise est totale. Sans un seul coup de feu, le ralliement était vite obtenu, et le gouverneur arrêté.
L’exploit de la corvette Aconit, dont Greenock fut le port d’attache, est un fait d’armes sans pareil dans l’histoire de la Seconde guerre mondiale. Sous le commandement du lieutenant de vaisseau Levasseur, l’Aconit a en effet coulé deux sous-marins, l’U-444 et l’U-432 à douze heures d’intervalle, le même jour, le 11 mars 1943. L’amiral Auphan raconte la bataille :
« En compagnie de la Renoncule, l’Aconit ramenait trois trainards d’un convoi d’Halifax – le H.X.228 – le 10 mars 1943, lorsque des sous-marins se manifestèrent. Au milieu de la nuit, le chef d’escorte, H.M.S. Harvester, signala qu’il s’était fait des avaries en abordant un sous-marin et ordonna à l’Aconit de rallier. C’est alors que la corvette française aperçut et éperonna l’U-444, celui-là même que son chef avait abordé en lui causant des dégâts superficiels. Quatre marins allemands recueillis par l’Aconit apportaient la preuve de cette première victoire. Mais la meute ennemie était bien fournie. L’Harvester eut son compte à 11 heures du matin. L’Aconit qui se précipitait à son secours repéra le coupable en surface à l’horizon. L’attaque dura vingt-trois minutes : grenades, canon, et pour finir, à 12h45, l’U-432 s’ouvrit en deux sous l’étrave de son vainqueur. L’Harvester était vengé dans l’heure qui avait suivi sa perte. Vingt prisonniers furent recueillis. Ils étaient, racontèrent-ils, à la soupe – célébrant peut-être leur victoire – quand l’Aconit avait attaqué. ‘J’espère, écrivit avec quelque férocité, dans son rapport, le LV Levasseur, qu’ils auront apprécié le dessert de mes dix grenades !’ »11
Du 19 juin 1941, date de son entrée en service, au 8 mai 1945, la corvette Aconit, compagnon de la Libération, aura escorté 34 convois et parcouru 84 000 milles marins en 405 jours de mer, coulé deux sous-marins, capturé 24 prisonniers, secouru 220 naufragés et participé au ralliement de Saint-Pierre et Miquelon.
Cette coopération militaire va de pair avec des manifestations de fraternité à l’égard des marins français libres qui continuent le combat dans des bases éloignées. À Greenock, un foyer est créé. Les marins sont choyés par l’hospitalité écossaise. La Free French House d’Édimbourg devient le centre de la culture française en Écosse ainsi qu’un lieu de repos pour les officiers en permission, avec films, conférences et concerts. Le philosophe Raymond Aron intervient pour situer la France libre dans l’Europe démocratique ; Paul Éluard évoque la poésie, la survivance de l’amour dans la guerre ; et le jeune Jean-Louis Crémieux-Brilhac, alors lieutenant, vient relater son évasion d’un Stalag allemand à travers la Pologne…Le Belfort navigue difficilement vers Cherbourg en septembre 1945. Il est vendu par la Marine Nationale le 22 novembre 1946 puis subit une démolition le 16 janvier 1947.
sources :
http://www.france-libre.net/fnfl-et-ecossais/
https://www.colsbleus.fr/articles/9916
















 Une force de haute mer basée à Changhai, dans laquelle ont figuré essentiellement et à des dates variables les croiseurs-cuirassés Jules Michelet et Waldeck Rousseau, les croiseurs Lamotte Picquet, Primauguet, et Suffren, les avisos Algoi, Altaïr, Amiral Chamer, Bellatrix, Craonne, Dumont d’Urville, Mame, Régulus, Rigault de Genouilly, Savorgnan de Brazza et Tahure, et le sous-marin Phénix.
Une force de haute mer basée à Changhai, dans laquelle ont figuré essentiellement et à des dates variables les croiseurs-cuirassés Jules Michelet et Waldeck Rousseau, les croiseurs Lamotte Picquet, Primauguet, et Suffren, les avisos Algoi, Altaïr, Amiral Chamer, Bellatrix, Craonne, Dumont d’Urville, Mame, Régulus, Rigault de Genouilly, Savorgnan de Brazza et Tahure, et le sous-marin Phénix.