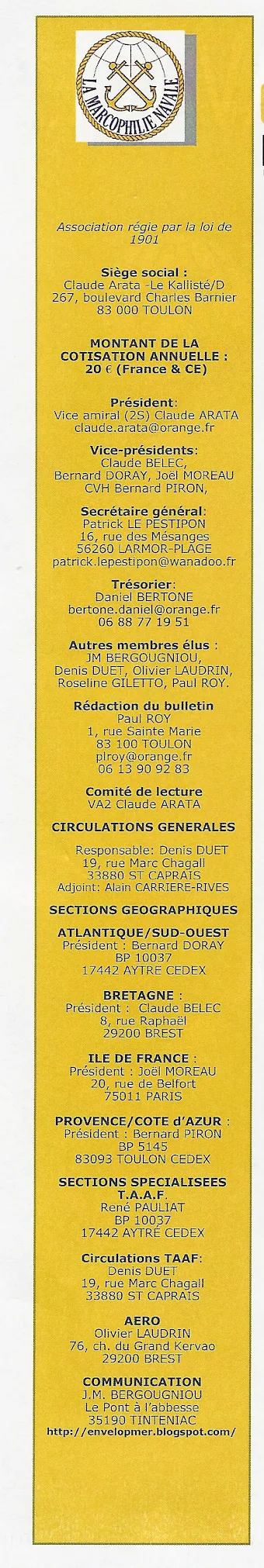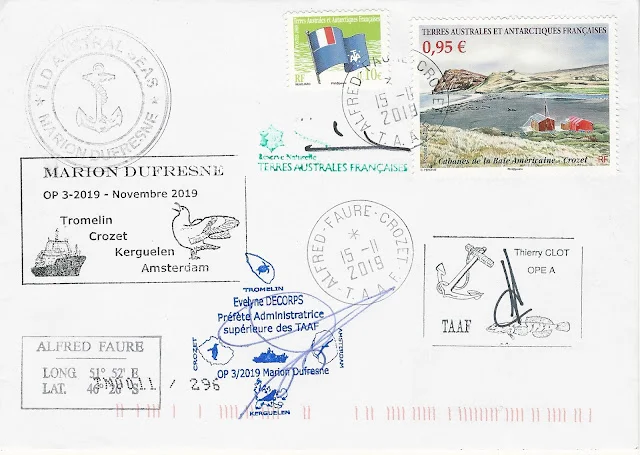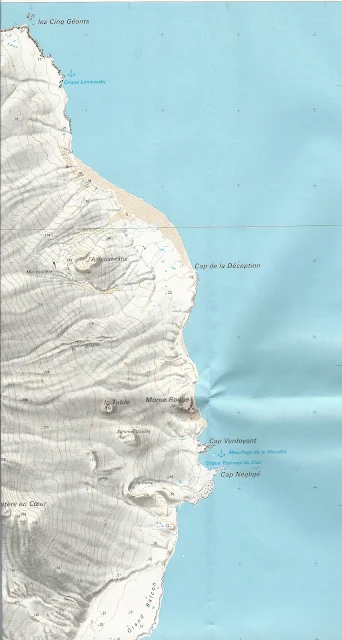sous-marin Le TRIOMPHANT
Une profonde mutation technologique

En 1982, alors que débutaient les premiers développements et que le projet du sous-marin n'était encore que dans les limbes, la conception et la réalisation du Triomphant ont été perçues d'emblée comme une tâche d'une ampleur et d'une complexité comparables, quoique se situant dans des domaines différents, à celles qu'avait connues en son temps la conception du Redoutable.
- définition des formes de carène et d'un nouveau type de propulseur (pompe-hélice) permettant de minimiser les bruits d'origine hydrodynamique ;
- conception, puis qualification d'appareils à très faibles niveaux intrinsèques de vibrations ;
- définition, développement et validation des dispositifs très divers permettant "de filtrer" les vibrations résiduelles dans leur cheminement vers la coque.
Mais la discrétion acoustique ne constitue pas, loin de là, le seul domaine où il a fallu innover pour satisfaire le niveau de performance recherché.

Citons sans prétendre à l'exhaustivité :
- l'accroissement très sensible de l'immersion maximale permis par la mise en oeuvre d'un nouvel acier à très haute limite élastique (100 HLES) et le développement d'une nouvelle technologie des circuits d'eau de mer ;
- le système d'exploitation tactique, qui utilisera un réseau d'antennes de détection sous-marine représentant une multiplication par un facteur d'environ dix du nombre d'hydrophones installés, et, par voie de conséquence, de la puissance de traitement et de calcul associée, par rapport aux SNLE type M4 ;
 |
| arrivée du bloc moteur sur une barge |
- la résolution des délicats problèmes posés par l'éjection en plongée du missile M4 à partir de tubes dont la géométrie est notablement différente de celle des tubes utilisés sur les SNLE actuels ;
- le système de transmission radio-électrique qui autorisera la réception en plongée des ondes LF et VLF dans un domaine accru d'immersion et de vitesse
De nombreux types d'acier ont été utilisés, permettant de descendre à des profondeurs de plus en plus importantes. Un coefficient de sécurité est attribué pour les sous-marins, c'est-à-dire que si le sous-marin est conçu pour descendre à une certaine profondeur, il ne peut dans la réalité l'atteindre, pour laisser une marge de manœuvre en cas d'incident. Ce coefficient de sécurité varie de 1,2 à 2 selon les pays.
Tous les pays constructeurs de sous-marins sont passés aux aciers alliés au nickel-chrome molybdène-vanadium à Haute Limite Elastique Soudable. La France utilise du 100 HLES, c'est-à-dire qu'il peut résister à 100 kg/mm2. Seuls les russes utilisent des alliages à base de titane, aluminium, vanadium. Cet alliage présente l'avantage, à égalité de limite élastique, d'être 1,8 fois plus léger que les aciers alliés. Le titane est par ailleurs incorrodable et sa signature magnétique est très faible. Les marines occidentales n'ont pas adopté les alliages de titane, 300 fois plus onéreux que l'acier et dont la mise en œuvre nécessite des installations de soudage sous vide. Les sous-marins à coque de titane ont une immersion maximale opérationnelle supérieure à celle des coques aciers.
Actuellement, le maximum atteint pour naviguer en profondeur est de 900m et est détenu par une classe de sous-marins russes.
Cols Bleus 03 juillet 1993 N°2221
https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2007/10/Guide-HLE-mis-en-forme-complet-version-finale.pdf