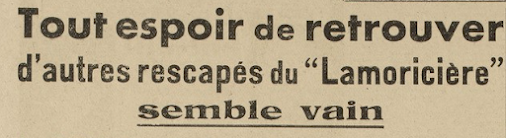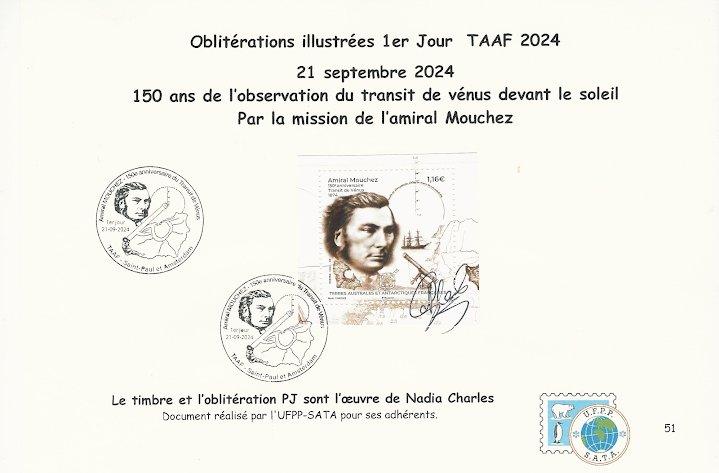SS Lamoricière Aviso impétueuse naufrage
Le 6 janvier 1942 à 17 heures le paquebot " Lamoricière" de la "Compagnie Générale Transatlantique" quitte Alger pour Marseille. Le paquebot est commandé par Joseph Milliasseau et à son bord il y a 272 passagers et 120 hommes d'équipage. Les passagers sont des fonctionnaires et militaires affectés en Afrique du Nord, des résidents d'Algérie venus passer les vacances sur le continent et des enfants rentrant de colonie de vacances ou de séjours dans des familles d'accueil.
Le 8 janvier le "Lamoricière" à son tour subit de graves avaries, l'eau s'engouffre dans les soutes à charbon par les "portelones" déformées par les chocs des paquets de mer, provoquant une forte gite sur bâbord. A 17h10 le paquebot émet un signal de détresse.
A 16h l’aviso l’Impétueuse arrive sur les lieux et récupèrera une heure plus tard un radeau avec 15 passagers épuisés dont Maguy Dumont Courau qui, à son retour, publia le récit de ce drame. Parmi ces 15 rescapés figurait un enfant. Elle recueille sur l’Impétueuse ce bref témoignage : « Dans la cabine voisine, je vois le jeune homme blond de notre groupe. Il a 16 ans et faisait partie du groupe de l’œuvre Guynemer. Il est couché et n’a pas l’air très bien. «J’ai nagé tellement longtemps avant de rallier le radeau», explique-t-il. Tous ses camarades, ont péri sous ses yeux dans une embarcation brutalement renversée... ». Maguy Dumont Courau qui perdit son mari dans le naufrage décèdera à l’âge de 101 ans.
Le 9 janvier 1942 vers 12h35 le paquebot coule à la latitude de 40°38N et la longitude de 04°38E près des côtes de Minorque.
La tragédie fait 299 victimes dont 80 membres d'équipage, y compris le commandant Milliasseau.
Les rescapés, sont recueillis par les 3 navires présents sur la zone de naufrage.
 Catastrophes maritimes Le mardi, 6 janvier, le paquebot « Lamoricière » quittait Alger pour Marseille avec des passagers et une cargaison de fruits. La mer était houleuse, sans plus. Mais, dans la nuit de mercredi, le bateau en se portant au secours du cargo français « Jumièges » en détresse, fut pris dans une épouvantable tempête. Les rafales l'inclinaient dangereusement. La cargaison de fruits fut transportée de tribord à bâbord pour rétablir l'équilibre. Jeudi après midi l'eau commence à suinter à travers la coque. Les pompes entrent en action ; l'équipage et ies passagers font la chaîne et avec des sceaux travaillent à vider les cales. Le soir, une voie d'eau se déclare... Les machines sont inondées, la lumière s'éteint. Le « Lamoricière » lance le S.O.S. Le paquebot « Gouv. Général Gueydon » arrive, essaye de lui passer une haussière : en vain. Vendredi, à 11 h., un navire de guerre et le « général Ghanzy » arrivaient à leur tour. Le commandant du Lamoricière croit pouvoir faire évacuer femmes et enfants sur les trois bateaux sauveteurs. Pendant l'opération, la tempête redouble, le « Lamoricière » donne de la bande, il s'enfonce par l'arrière; à midi 40, il avait disparu. Ses passagers, son équipage étaient maintenant tous à la mer. Tragique spectacle. Des centaines d'êtres humains étaient le jouet des vagues hautes de 10 mètres. Ils disparaissaient, reparaissaient. Les trois bateaux sauveteurs ne pouvaient que croiser sur les lieux et laisser traîner en mer toutes leurs cordes et leurs filins dans l'espoir de voir les naufragés s'y accrocher. Leurs équipages travaillaient de toutes leurs forces au sauvetage : tel marin de l'Etat se fit descendre par une corde au ras des flots pour happer quelques survivants... Il y a bien des rescapés... mais il y a aussi hélas ! 290 disparus : parmi lesquels le commandant et le chef mécanicien, morts à leur poste. Du « Jumieges » au secours duquel le « Lamoricière » se portait, on n'a pas trouvé de traces. Il a été perdu corps et biens.
Catastrophes maritimes Le mardi, 6 janvier, le paquebot « Lamoricière » quittait Alger pour Marseille avec des passagers et une cargaison de fruits. La mer était houleuse, sans plus. Mais, dans la nuit de mercredi, le bateau en se portant au secours du cargo français « Jumièges » en détresse, fut pris dans une épouvantable tempête. Les rafales l'inclinaient dangereusement. La cargaison de fruits fut transportée de tribord à bâbord pour rétablir l'équilibre. Jeudi après midi l'eau commence à suinter à travers la coque. Les pompes entrent en action ; l'équipage et ies passagers font la chaîne et avec des sceaux travaillent à vider les cales. Le soir, une voie d'eau se déclare... Les machines sont inondées, la lumière s'éteint. Le « Lamoricière » lance le S.O.S. Le paquebot « Gouv. Général Gueydon » arrive, essaye de lui passer une haussière : en vain. Vendredi, à 11 h., un navire de guerre et le « général Ghanzy » arrivaient à leur tour. Le commandant du Lamoricière croit pouvoir faire évacuer femmes et enfants sur les trois bateaux sauveteurs. Pendant l'opération, la tempête redouble, le « Lamoricière » donne de la bande, il s'enfonce par l'arrière; à midi 40, il avait disparu. Ses passagers, son équipage étaient maintenant tous à la mer. Tragique spectacle. Des centaines d'êtres humains étaient le jouet des vagues hautes de 10 mètres. Ils disparaissaient, reparaissaient. Les trois bateaux sauveteurs ne pouvaient que croiser sur les lieux et laisser traîner en mer toutes leurs cordes et leurs filins dans l'espoir de voir les naufragés s'y accrocher. Leurs équipages travaillaient de toutes leurs forces au sauvetage : tel marin de l'Etat se fit descendre par une corde au ras des flots pour happer quelques survivants... Il y a bien des rescapés... mais il y a aussi hélas ! 290 disparus : parmi lesquels le commandant et le chef mécanicien, morts à leur poste. Du « Jumieges » au secours duquel le « Lamoricière » se portait, on n'a pas trouvé de traces. Il a été perdu corps et biens.