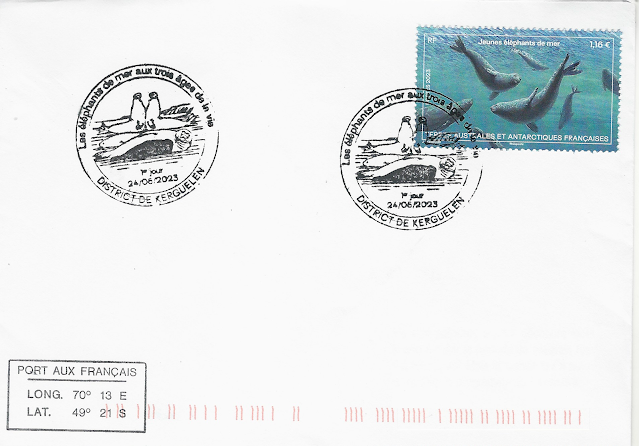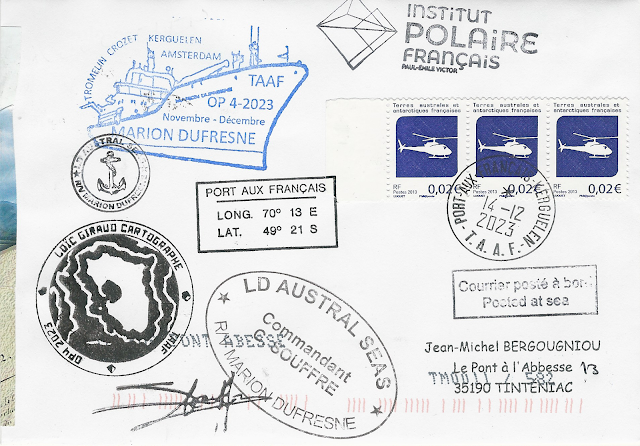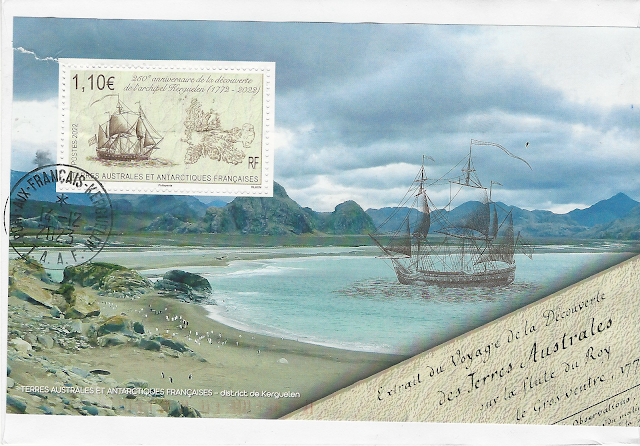BRF Jacques Chevallier DLD
Avec ses 194 mètres de long, plus de 27 mètres de large et une masse de 31 000 tonnes, le BRF Jacques Chevallier est le deuxième plus gros et le troisième plus long des navires de la flotte, après le porte-avions Charles de Gaulle et le porte-hélicoptères amphibie.L’Islande est ainsi la première escale dans un port étranger pour le bâtiment parti de Toulon le 27 septembre dernier afin de mener son premier déploiement de longue durée. L’équipage a rencontré des conditions de mer difficiles pendant son transit avant d’accoster.
Le capitaine de vaisseau Pierre Ginefri, commandant du bâtiment, a accueilli l’ambassadeur de France en Islande, Guillaume Bazard ainsi que plusieurs autorités islandaises lors d’un déjeuner officiel à bord. Une visite du bâtiment a clôturé cette journée en présentant aux autorités islandaises et françaises les nouvelles capacités opérationnelles du Jacques Chevallier.
Cette escale a également été l’occasion de confirmer le port de Reykjavik comme point d’appui des BRF dans le cadre de déploiements en soutien des bâtiments français et alliés du Grand Nord. Enfin, l’Islande est un point de départ naturel pour rallier les hautes latitudes dans lesquelles les différents systèmes du BRF seront éprouvés par mer froide.
Le premier déploiement du Jacques Chevallier le conduira en océan Atlantique Nord et Sud, en océan Indien, en mer Rouge et en mer Méditerranée, ultime étape avant son admission au service actif.
 |
| RAM avec le Georges Washington © Marine Nationale |
Plus de 2 700 m3 de F44 et 2 000 m3 de F76 ont été embarqués. 4 700 m3 en tout, à un débit cumulé de près de 2 000m3/h, du jamais vu de mémoire de ravitaillé français.
 |
| Prince of Wales © Marine nationale |
Le 4 novembre, un RAM triple a été réalisé où le BRF a cette fois-ci joué le rôle du ravitailleur auprès de l’US Navy :200 m3 de F76 transmis au destroyer USS Leyte Gulf ;
50 palettes et 1 200 m3 de F44 transmis au porte-avions USS Georges Washington.
Plusieurs défis ont été relevés pour le premier de série français : des transferts depuis 3 postes, un rythme déjà opérationnel pour le transfert de charges lourdes et l’utilisation des pompes à leur débit maximal, pour un débit F44 de 1 200 m3/h.
La collaboration avec la Marine américaine a été renforcée par un échange, appelé « Crossdeck », entre des marins français et américains pour une après-midi et une nuit. Ce fut l’occasion des premières manœuvres aviation du BRF avec un hélicoptère étranger.
Entre deux ravitaillements à la mer, le Jacques Chevallier a fait escale dans la plus grande base navale américaine : Norfolk. De nombreuses personnalités françaises et américaines, mais aussi alliées, ont été reçues à bord pour un déjeuner, une réception ou une visite. La baie de Chesapeake restera une étape importante du déploiement longue durée (DLD) du bâtiment avant sa traversée vers les Antilles pour des interactions avec les forces armées aux Antilles.
Au programme pour les deux bâtiments, une présentation pour ravitaillement à la mer, puis plusieurs manœuvres aviation. Pour ce faire, un hélicoptère SeaHawk de la marine brésilienne a réalisé des exercices de « touch and go » sur la plateforme hélicoptère du BRF et un Cougar a permis un transfert d’équipage, d’environ une dizaine de marins, pour une visite sur leurs bâtiments respectifs.
Les équipes de visite des deux bâtiments ont réalisé un exercice de simulation de visite. Les marins brésiliens ont investi le BRF en corde lisse et les marins français sont intervenus à l’aide d’une embarcation de drome opérationnelle (EDO).
Pendant le ravitaillement à la mer, plusieurs m3 de carburant ont été transférés par le Jacques Chevallier à l’Atlantico.
Ces exercices opérationnels conjoints démontrent l’efficacité de la coopération militaire franco-brésilienne en mer et permettent de renforcer l’interopérabilité entre les deux marines.
Le bateau Jacques Chevallier permet de maintenir l’autonomie de la flotte française. Autrement dit, il permet de pousser les navires de la Marine Nationale plus loin et de les garder plus longtemps en mer, en les ravitaillant.
Le Jacques Chevallier a la capacité d’embarquer 1 500 tonnes de matériel, 13 000 m3 de carburants et peut contenir jusqu’à 20 conteneurs de 20 pieds. Il est également capable de fournir des vivres pour soutenir environ 2000 personnes pendant 2 mois.
Le cap des Aiguilles : Le point le plus loin de l’Afrique
Le cap des Aiguilles est le point de relief le plus méridional du continent africain. Il est injustement inconnu au profit du cap de Bonne Espérance. Mais c’est bien lui le point de repère officiel pour marquer le passage de l’océan Atlantique et l’océan Indien.L’origine du nom est portugaise.
C’est l’explorateur Bartolomeu Dias qui découvre le cap en 1488. Il l’appelle alors quelques années plus tard, en 1500 : Agulhas (aiguille en portugais).
Il fut dénommé ainsi, car des navigateurs avaient remarqué la coïncidence entre le nord magnétique et le nord géographique dans cette région.
Le courant des Aiguilles : un des plus fort du monde.
Le courant des Aiguilles est un courant de surface. Il est parmi les plus fort et les plus réguliers du monde. Le volume de ce courant ne varie que très peu selon les saisons et il peut atteindre jusqu’à 5 km/h.
Il est créé par la rencontre entre les eaux froides de l’océan Antarctique à l’ouest et des eaux chaudes de l’océan Indien à l’est.
Les vents aussi ont un rôle dans la dangerosité de cette zone géographique tant redoutée des marins. Les vents d’ouest, souvent très forts, arrivent face au courant des aiguilles. Ce phénomène crée alors des vagues d’une hauteur vertigineuse, responsable de nombreux naufrages.
Jusqu’au 26 décembre 2023, le premier Bâtiment Ravitailleur de Forces (BRF) de la Marine Nationale, nommé "Jacques Chevallier", est en escale au Grand Port maritime de La Réunion. Livré en septembre dernier, ce dernier-né de la marine française est encore en phase d’essai.
Avec sa taille imposante, il ne passe pas inaperçu. Certains Réunionnais ont peut-être vu le Bâtiment Ravitailleur de Forces (BRF) Jacques Chevallier, hier ou ce jeudi 21 décembre 2023, au large de nos côtes.
Le bateau fait escale sur notre île jusqu’au 26 décembre prochain. Avant de rejoindre son point d’attache à Toulon, le Jacques Chevallier remontera par le Canal de Suez, lieu de conflit maritime actuellement.