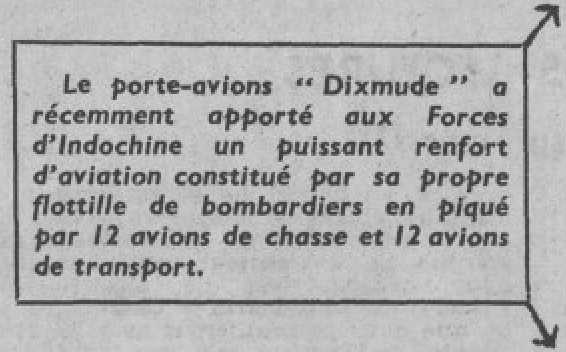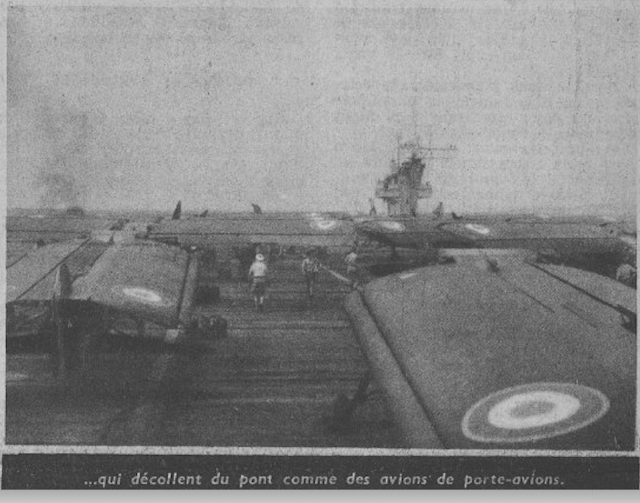Super Etendard
flottille 11F 17F
En 1977, quinze ans se seront écoulés depuis l'arrivée en flottille des premiers Etendard IV. Il sera donc largement temps à cette date qu'un successeur puisse armer nos flottilles.
Dans cette perspective, le Service Central de l'Aéronautique Navale étudie depuis presque dix ans le problème du remplacement de l'Etendard.
En 1965 où l'optimisme régnait dans les étages de la rue Royale, il était envisagé de remplacer, vers 1975, les Etendard dans leurs missions d'appui et d'assaut par une version Marine du Jaguar et les Crusader dans leur mission d'interception par un avion qui aurait pu être à géométrie variable.
Les difficultés budgétaires et surtout la définition précisée par le « plan bleu » des missions dévolues à l'aviation embarquée ont conduit l'Etat-Major à ne considérer qu'un type d'avion qui, seul, armerait nos porte- avions dans les années 1980.
Ainsi ne subsistait plus que le projet « Jaguar Marine ..
Il est apparu très vite aux spécialistes du SC. Aéro que si le Jaguar pouvait être, dans sa version terrestre, l'avion satisfaisant qu'il est devenu, de sérieuses difficultés se présentaient en matière de navalisation. Ces craintes sont devenues certitudes à l'issue d'une deuxième campagne d'essai sur porte-avions au mois d'octobre 1971 : pour plusieurs raisons dont une, suffisante à elle seule qui est la trop faible poussée de ses moteurs, le Jaguar ne pouvait pas être utilisé sur porte-avions dans les limites raisonnables de sécurité.
L'échéance imposée par le vieillissement des avions en service ne permettait plus de lancer le développement d'un avion nouveau.
 A l'issue d'une mission d'évaluation effectuée aux Etats-Unis par le pilote officier de marque du SC. Aéro, la Marine proposait que le choix de l'avion se porte de préférence sur une nouvelle version du Skyhawk A4 de Mac Donell Douqlas, sinon sur une nouvelle version de l'Etendard, baptisée « Super Etendard », qui serait équipée du moteur de l'A 4 le J 52 de Pratt et Whitney. En concurrence avec ce moteur se trouvait une proposition de la SNECMA : l'ATAR 8 K 50.
A l'issue d'une mission d'évaluation effectuée aux Etats-Unis par le pilote officier de marque du SC. Aéro, la Marine proposait que le choix de l'avion se porte de préférence sur une nouvelle version du Skyhawk A4 de Mac Donell Douqlas, sinon sur une nouvelle version de l'Etendard, baptisée « Super Etendard », qui serait équipée du moteur de l'A 4 le J 52 de Pratt et Whitney. En concurrence avec ce moteur se trouvait une proposition de la SNECMA : l'ATAR 8 K 50.Le Dassault Super-Étendard est un avion d’attaque de chasse français, construit par Dassault, destiné à être embarqué à bord de porte-avions. Successeur de l'EtendardIV, il a été produit à 85 exemplaires mis en service par la Marine française et l'Argentine.
La version initiale du Super-Étendard est parfois désignée de façon abrégée SUE (pour Super-Étendard), tandis que la version modernisée apparue à la fin des années 1980 est désignée SEM (pour Super-Étendard modernisé).
 |
| Rochefort Super Etendard ANAMAN photo JM Bergougniou |
 |
| Rochefort Super Etendard ANAMAN photo JM Bergougniou |
 |
| Rochefort Super Etendard ANAMAN photo JM Bergougniou |


Elle participe à de nombreuses opérations extérieures telles que la mission Olifant en 1983 au Liban, Prométhée dans le golfe d'Oman à bord du Clemenceau, Balbuzard en mer Adriatique ou encore Héraclès à bord du Charles De Gaulle.

 | |
Rochefort Super Etendard ANAMAN photo JM Bergougniou |
 |
| Rochefort Super Etendard ANAMAN photo JM Bergougniou |
Le Super étendard sur le Charles de Gaulle
Mis en service en 1978, le Super étendard sera l'avion d'assaut et de reconnaissance du groupe aérien embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle jusqu'à son remplacement par le Rafale vers 2010. Les améliorations qui lui ont été apportées le rendent apte à remplir ses missions de projection de puissance jusqu'à cette date avec une efficacité remarquable et une vulnérabilité réduite.
 | |
Saint-Jacques de Lande SEM 11F photo JM Bergougniou |
 |
| Saint-Jacques de Lande SEM 11F photo JM Bergougniou |
 |
| Saint-Jacques de Lande SEM 11F photo JM Bergougniou |
 |
| Saint-Jacques de Lande SEM 11F photo JM Bergougniou |
Sources
BnF Gallica
Cols bleus 9-6-1973 n° 1283
Cols Bleus 14-6-1997 n°2399
Cols Bleus 7-5-2008 n°2869





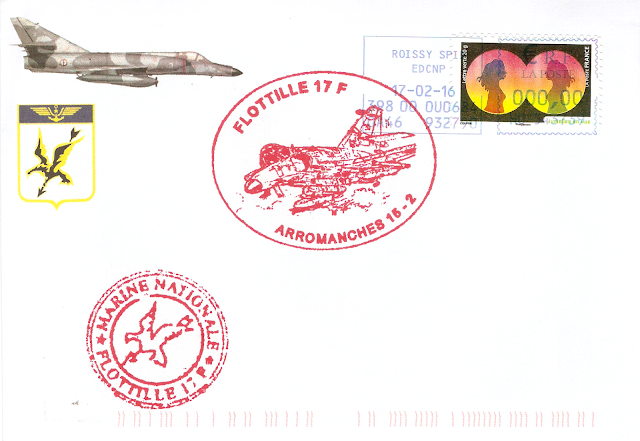














.gif)