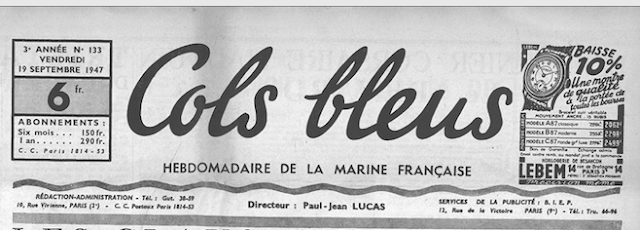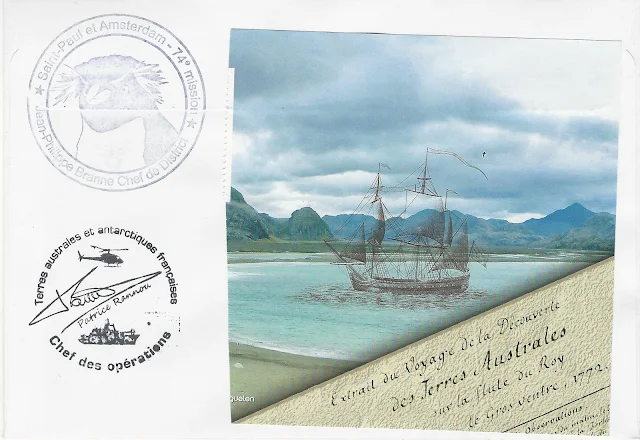La Côte d'Ivoire et quelques phares
LA SIGNALISATION MARITIME EN COTE D'IVOIRE
D ans un récent article, nous avons parlé du cabotage en A.O.F. et plus particulièrement sur la Côte d'ivoire. Le balisage s'étend sur 500 km. environ et comporte 5 phares de 4e ordre.
 A Port-Bouët, c'est q'une tourelle quadrangulaire en béton , construite en 1932. Le phare est situé à 120 mètres environ de la plage, à 200 mètres dans l'ouest de l'enracinement du wharf. Bien des travaux sont à entreprendre en vue de redonner à ce phare toute la valeur qu'il aurait dû garder.
A Port-Bouët, c'est q'une tourelle quadrangulaire en béton , construite en 1932. Le phare est situé à 120 mètres environ de la plage, à 200 mètres dans l'ouest de l'enracinement du wharf. Bien des travaux sont à entreprendre en vue de redonner à ce phare toute la valeur qu'il aurait dû garder.  Le phare d’Assinie
Le phare d’Assinie GÉO-MOUSSERO

Il existe deux phares dans la région d’Abidjan en Côte d’Ivoire, le phare de Petit Bassam ou Port Bouët sur le le port d’Abidjan (Port Bouët est le port d’origine dans la région d’Abidjan. Situé à environ 5 km à l’est du canal Vridi à Port Bouët) et celui de Grand Bassam (Première capitale de Côte d’Ivoire, la ville de Grand-Bassam est un exemple urbain colonial de la fin du xixe siècle et de la première partie du xxe siècle) situé à environ 40 km d’Abidjan, mais celui-ci est éteint. Ce dernier est classé au Patrimoine Mondiale de L’UNESCO.
Étalée tout le long du littoral sur une dizaine de kilomètres au-delà du canal de Vridi, Port-Bouët porte le nom du commandant Bouët Villaumez qui, en 1837, fut chargé par le roi de France de conclure des traités de commerce et de protection avec des chefs côtiers. C’est en fait vers 1930 que Port-Bouët commença à être habité. La construction du wharf draina à ce moment toute une activité de manutention des marchandises. Le célèbre phare de Port-Bouët qui balaie la mer sur un rayon de milles marins fut construit à cette époque.
Grand Bassam :
Grand-Bassam, une ville située à environ 40 km à l’est de Port Bouët, à l’extrémité est de la Lagune d’Ébrié, était brièvement la capitale coloniale française (1893-96). Le phare a marqué une entrée de la lagune qui a été asséché, donc il n’y a pas de port moderne.

Situé au quartier du même nom, ce bâtiment de 24m de haut, rappelle l’essor économique connu par la ville de Grand-Bassam durant l’époque coloniale.
Ses travaux qui durèrent un an, s’achevèrent en 1914 mais ce n’est qu’en 1915 qu’il sera mis en service. Sa lanterne d’une portée de 33 km a permis l’orientation de bon nombre de bateaux aux larges des côtes ivoiriennes. Il est éteint en 1951 lorsque le port d’Abidjan est inauguré.
Aujourd’hui, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en même temps que la ville.
Avant l’ouverture du canal de Vridi, le trafic des marchandises s’est fait sur des rades foraines situées aux débouchés en mer, des lagunes. Le trafic des marchandises sur ces rades foraines était rendu très difficile par la présence de la barre, phénomène de déferlement de la houle sur le rivage. C’est ainsi qu’a été construit le premier wharf (Appontement s’avançant dans la mer pour permettre aux bateaux d’accoster) à Grand- Bassam en 1897, puis un second wharf plus long et plus large, en raison de l’augmentation du trafic, a été mis en service en 1923. Pour décongestionner Grand- Bassam, dont le deuxième wharf était devenu insuffisant, il a été mis en service en 1931, un wharf à Port- Bouët. Cet emplacement avait été choisi intentionnellement près d’Abidjan, au lieu d’agrandir celui de Grand- Bassam, pour inciter toutes les installations commerciales à s’établir à Abidjan, là où devait être établi le futur Port ainsi que la capitale. En 1951, fut mis en service le wharf de Sassandra.

L’ouverture du canal de Vridi déplaça ces activités vers le d’Abidjan. Depuis Port Bouët est devenu l’aéroport international d’Abidjan.
Une première demande pour la construction d’un wharf en lagune est introduite par la CFAO en 1906. Ce n’est qu’en 1931, en effet, que le wharf de Grand-Bassam fut doublé par un autre, à Port Bouët. . Du port, il ne reste plus que le wharf et des bateaux de pêche ghanéens.
Port-Bouët est l’une des 10 communes de la ville d’Abidjan et comprend le quartier d’Adjoufou, les villages d’Abouabou et de Mafiblé. Elle abrite l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
Étalée le long du littoral sur une dizaine de kilomètres au-delà du canal de Vridi, Port-Bouët porte le nom du commandant Bouët Villaumez qui, en 1837, fut chargé par le roi de France de conclure des traités de commerce et de protection avec des chefs côtiers. C’est en fait vers 1930 que Port-Bouët commença à être habitée. La construction du wharf draina à ce moment toute une activité de manutention des marchandises. Le célèbre phare de Port-Bouët fut construit à cette époque.
La deuxième étape du développement de cette commune remonte à la création du port, en 1950. Usines et entrepôts se multiplièrent ensuite à Vridi qui devint la principale zone d’emplois d’Abidjan. C’est à cette époque qu’une partie de la population de Port-Bouët fut déplacée dans la commune de Yopougon. Elle y fonda le quartier appelé Port-Bouët 2.
Achevé de construire en 1914, le phare de Grand-Bassam a cessé de balayer l’horizon de son feu blanc à éclats depuis 1951. Sa tour ronde de 24 m de haut, typique de l’architecture militaire de l’époque, est aujourd’hui une antique relique au pied de laquelle les enfants et adolescents du quartier viennent s’affronter dans des parties de foot animées. Les aventuriers pourront tenter de moyenner une ascension de son vieil escalier en colimaçon auprès des anciens du coin, et profiter ainsi d’une magnifique vue panoramique à 360° des environs, sous réserve, bien sûr, que cela soit encore possible : le phare étant dans un état de ruine avancé, assurez-vous tout de même de ne pas vous mettre en danger.
Le phare cesse de fonctionner en 1951 avec la construction du phare de Port-Bouët à Abidjan.