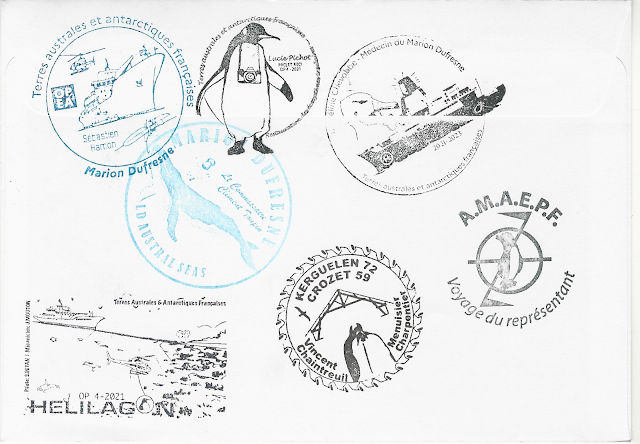ÉPOUVANTABLE DÉSASTRE En rade de Toulon le cuirassé "La LIBERTÉ" explose
Le 25 septembre 1911, alors qu'il se trouve encore dans le port méditerranéen, un feu localisé près des munitions de 194 mm se propage malgré les efforts des marins pour noyer la soute à munitions. À 5h53, le navire explose emportant 200 hommes d'équipage et une centaine de marins des navires les plus proches.
Les mots manquent pour exprimer comme il faudrait, dans toute sa profondeur et son intensité, la douleur d'un pareil désastre. Au lendemain de l'admirable revue navale du 4 septembre et dans un moment où les difficultés extérieures ont ravivé chez nous la flamme des grands enthousiasmes
patriotiques, ce sinistre événement meurtrit l'âme française dans ses espoirs les plus nobles et dans ses plus généreuses fiertés. Mais quelle angoisse de plus pour nous gens de Bretagne, quand nous songeons à toutes ces familles de marins, nos compatriotes, que l'horrible catastrophe met en deuil. Hier, à l'heure où nos vendeurs annonçaient dans Rennes la tragique nouvelle, nous aperçûmes un officier d'infanterie qui venait de parcourir le journal et qui, ne pouvant se contenir, fondait en larmes. Sainte émotion du soldat qui pleure ses frères d'armes, morts en service, mais qui sans doute voit plus loin que des infortunes particulières et qui s'enfièvre et s'alarme au souvenir des désastres précédents dont on avait cru que la série était enfin close et auxquels vient s'ajouter soudain l'explosion de la Liberté.
Pauvre marine française Quelle fatalité la poursuit donc ?C'est la question que l'on est tenté de se poser en présence de ces catastrophes. Question qui laisse deviner de l'impatience, peut-être de la colère et peut-être même chez quelques-uns, du découragement. Eh bien, non ne parlons pas ce langage-là Ne soyons ni des impatients ni des découragés. Dominons, autant qu'il est en nous, la véhémence de nos sentiments, et que notre douleur patriotique soit pour nous, non point une occasion de défaillance, mais le principe d'un dévouement plus stoïque et plus tenace aux grands intérêts de la défense nationale, Pleurons les victimes du devoir faisons mieux encore admirons-les et puisons, tous tant que nous sommes, dans leur héroïque exemple, la force dont nous avons besoin pour consentir a la cause qu'ils ont clarifiée les sacrifices que celle-ci réclame. Ah si nous le voulions, si la presse française et particulièrement celle de Paris qui dispose dans ce riche et généreux pays d'une si considérable influence, voulait se concerter pour appeler en témoignage, à la face du monde, le patriotisme français Si, par elle, l'idée d'une souscription nationale était lancée et si, grâce à une contribution volontaire des citoyens de France, le bâtiment de guerre dont nous déplorons la perte était remplacé par une autre unité de combat du type Jean Bart ou Courbet, ce don magnifique du pays à sa marine militaire serait assurément l'un des gestes les plus beaux et !es plus opportuns que l'on puisse imaginer pour attester la réalité et l'ardeur du sentiment national.
 Sachons du moins ne pas marchander à notre marine, quand l'Etat nous les demande, les sacrifices nécessaires. C'est à celui-ci qu'il appartient d'empêcher, autant que les risques de l'armement moderne lui en laissent les moyens, le retour de ces catastrophes terribles. Mais c'est seulement notre bonne volonté qui lui permettra d'en réparer les désastres. E. D. L.
Sachons du moins ne pas marchander à notre marine, quand l'Etat nous les demande, les sacrifices nécessaires. C'est à celui-ci qu'il appartient d'empêcher, autant que les risques de l'armement moderne lui en laissent les moyens, le retour de ces catastrophes terribles. Mais c'est seulement notre bonne volonté qui lui permettra d'en réparer les désastres. E. D. L.L'équipage comptait 715 sous-officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, commandés par un état-major de 25 officiers. Le "Liberté" se trouvait à Toulon après avoir participé à la grande revue navale du 4 septembre 1911 qui se déroula sous les ordres du vice-amiral Jauréguiberry, dont le croiseur Jules Ferry portait la marque, et en présence du Président de la République Armand Fallières.Près de quatre-vingts unités y participèrent, soit 19 cuirassés répartis en trois escadres, 10 croiseurs-cuirassés en trois divisions, 24 torpilleurs organisés en 4 escadrilles, 10 sous-marins en 2 escadrilles. S'y ajoutaient : 2 croiseurs mouilleurs de mines, la division des navires écoles, ainsi que de nombreux bâtiments auxiliaires.
Aux grandes cérémonies nationales succèdent les hommages locaux dans toutes les communes touchées bretonnes par le drame.Après les hommages aux morts il fallut tout naturellement arriver aux questions troublantes que se posaient les travailleurs des poudrières, les équipages de la flotte, intéressés au premier chef, mais aussi toute la population frappée durement à des intervalles si rapprochés.
On commença à donner l'ordre de remplacer les poudres antérieures à 1901. Il fut question d'étudier un autre explosif. Cependant la poudre B avait toujours ses partisans qui cherchèrent à orienter l'enquête vers d'autres directions.
Et il fallut, avant d'en finir avec l'utilisation de la poudre B, que le Ministre de la Marine Delcassé prenne des mesures draconiennes. Il chargea un spécialiste, le capitaine de vaisseau Scherer, d'étudier un explosif moins dangereux, ayant une probabilité de combustion instantanée presque nulle. Il ordonna la révision et l'amélioration des systèmes de prévention et de lutte contre l'incendie.