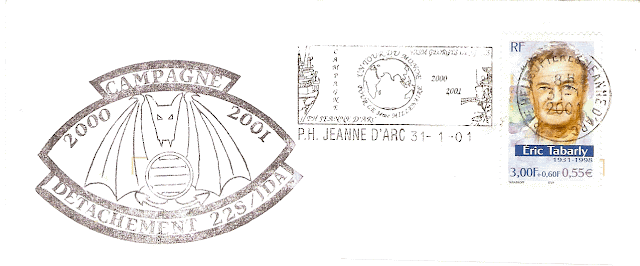Sous-marin le Lutin coulé à Bizerte
DERNIÈRE. HEURE Paris, 16 octobre. Comme le "Farfadet", le "Lutin" ne remonte pas sur l'eau Le sauvetage arrêté par la nuit
Quinze hommes vivants au fond de la mer
Nous recevons la terrifiante nouvelle d'un épouvantable sinistre maritime analogue à celui du Farfadet.Le Lutin est un sous-marin de 185 tonneaux, son effectif officiel est de 12 hommes. il a élé lancé en 1902, il est muni de 4 lance-torpilles, sa vitesse est de douze nœuds 3.
Disparu
Bizerte, 16 octobre.
Le sous-marin Lutin, commandé par le lieutenant de vaisseau Fepoux, sorti à huit heures du matin par une forte houle pour des exercices de plongée, a été signalé comme disparu vers six heures par le remorqueur convoyeur. Deux torpilleurs et trois remorqueurs sont partis à sa recherche avec l'amiral Bellue en personne. Jusqu'à présent, on est sans nouvelles.
Le sondage
Bizerte, 16 octobre.
La mer houleuse rend à peu près impossible les travaux de sauvetage du sous-marin Lutin.
Le dragage a permis de- constater une certaine résistance à l'endroit où le Lutin a fait une plongée.
La nuit oblige à suspendre le sauvetage Bizerte, 16 octobre.
L'obscurité a obligé d'interrompre les opérations de sauvetage, qui seront reprises à la pointe du jour:
Le consul général d'Angleterre à Tunis a proposé à M. Danthouard, délégué à la résidence, de télégraphier au gouvernneur de Malte pour envoyer à Bizerte les moyens de secours dont dispose la flotte anglaise de Malte. M. Danthouard a télégraphié cette offre à l'amiral commandant, qui a accepté. Le consul a télégraphié immédiatement à Malte.
Le Lutin a quatorze hommes d'équipage, commandés par un lieutenant de vaisseau.
Coulé par 40 mètres de fond
Bizerte, J6 octobre.
Au cours des dragages effectués au point où on suppose que doit se trouver le sous-marin Lutin, on a trouvé une résistance par 40 mètres de fond.
Le sous-marin Lutin, sister-ship du sous-marin Farfadet, construit par les Chantiers navals de Rochefort/sur mer d’après des plans de Gabriel Maugas. est un submersible pour la défense côtière. C'est un ous marin à coque unique. Commandé le 26 septembre 1899, lancé le 12 février 1903, il sera mis en service le 17 septembre 1903.
Le dragage a permis de- constater une certaine résistance à l'endroit où le Lutin a fait une plongée.
La nuit oblige à suspendre le sauvetage Bizerte, 16 octobre.
L'obscurité a obligé d'interrompre les opérations de sauvetage, qui seront reprises à la pointe du jour:
Le consul général d'Angleterre à Tunis a proposé à M. Danthouard, délégué à la résidence, de télégraphier au gouvernneur de Malte pour envoyer à Bizerte les moyens de secours dont dispose la flotte anglaise de Malte. M. Danthouard a télégraphié cette offre à l'amiral commandant, qui a accepté. Le consul a télégraphié immédiatement à Malte.
Le Lutin a quatorze hommes d'équipage, commandés par un lieutenant de vaisseau.
Coulé par 40 mètres de fond
Bizerte, J6 octobre.
Au cours des dragages effectués au point où on suppose que doit se trouver le sous-marin Lutin, on a trouvé une résistance par 40 mètres de fond.
Ces caractéristiques Sont :
Longueur : 41,49 m - Maître-bau (sa plus grande larguer) : 2,90 m
Tirant d’eau : 2,68 m
Tonnages : 84,97 tonnes en surface, et 202,47 tonnes en plongée
Puissance : 600 cv (électrique)
Propulsion : 2 moteurs électriques Sautter-Harlé de 300 cv- 2 hélices à pales orientables
Vitesse : 6,10 nœuds en surface – 4,20 nœuds en plongée
Immersion : 35 m
Armement : 4 tubes lance-torpilles de 450 mm de diamètre.
Équipage : de 14 à 16 membres.
SONT-ILS VIVANTS ?
Bizerte, 18 octobre. La coque du « Lutin » vient d'être retrouvée par 36 mètres de fond. Le sous-marin repose à plat sur le fond. Dans les milieux maritimes on émet l'espoir que des fissures n'ayant pas été relevées, l'équipage pourra être retrouvé vivant.
Les secours anglais
Bizerte, 18 octobre. Le cuirassé « Implacable", le croiseur ci Carnogos » et le destroyer « Albatros », venant de Malte, sont arrivés cette nuit, vers une heure, et ont mouillé en dehors du port...
Marseille, 18 octobre. M. Thomson, avant le départ de la Jeanne-d'Arc, a communiqué le programme suivant de la commission d'enquête sur l'accident du Lutin »
La commission s'appliquera à découvrir les causes de l'accident. Elle interrogera le personnel du convoyeur pour essayer de reconstituer les circonstances de la disparition du Lutin. Elle recherchera si rien dans le fonctionnement intérieur du matériel ne peut donner lieu à des présomptions, et si aucun accident caractéristique ne s'était produit sur le Lutin avant sa perte. Enfin elle s'efforcera de fixer les mesures à prendre pour empêcher à l'avenir sur les sous-marins le retour de semblable catastrophe.
La liste de l'équipage du Lutin
Paris, 18 octobre.
Le ministère de la marine communique la liste de l'équipage du sous-marin « Lutin, avec les pays d'origine.
Faut-il en conclure que ces deux marins n'étaient pas à bord, pour une raison quelconque, une courte permission par exemple C'est ce à quoi on ne peut répondre d'une façon certaine pour le moment et ce point demande confirmation.
Breveté torpilleur, âgé de 23 ans, de Brest Immédiatement, le préfet maritime a fait communiquer la nouvelle à M. Aubert, maire de Brest, en le priant de lui faire parvenir des renseignements sur les familles et de les aviser...
 M. Fépoux, très instruit et très travailleur. se plaisait au milieu des jeunes gens qui, à bord de notre vaisseau, se destinent à embrasser la carrière de mécaniciens dans la marine. Il leur faisait lui-même des cours, et sa compagnie pouvait être citée comme modèle.
M. Fépoux, très instruit et très travailleur. se plaisait au milieu des jeunes gens qui, à bord de notre vaisseau, se destinent à embrasser la carrière de mécaniciens dans la marine. Il leur faisait lui-même des cours, et sa compagnie pouvait être citée comme modèle.
 Sous des dehors un peu froids, peut-être, il cachait un excellent cœur et avait sa s'attirer les sympathies de tout l'équipage. »
Sous des dehors un peu froids, peut-être, il cachait un excellent cœur et avait sa s'attirer les sympathies de tout l'équipage. »
M. Royer ajoute que le lieutenant de vaisseau Fépoux, qui est né à Strasbourg, a fait de brillantes études aux lycées de Nancy et de Brest, puis à l'école navale dont il sortit un des premiers.
 Nommé aspirant de 1ère classe le 5 octobre 1894 et enseigne le 5 octobre 1896, il fut promu au choix lieutenant de vaisseau le 19 octobre 1903.
Nommé aspirant de 1ère classe le 5 octobre 1894 et enseigne le 5 octobre 1896, il fut promu au choix lieutenant de vaisseau le 19 octobre 1903.
M. Fépoux, marié, il y a deux ans environ, avec une Parisienne, fille d'un négociant en fourrure, M. Aldebert, a une fillette d'an an...
 Les autres officiers du bord confirment tous les renseignements donnés par M. le professeur Royer. Ils sont très affectés de la catastrophe et se demandent avec anxiété si l'on pourra renflouer le Lutin.
Les autres officiers du bord confirment tous les renseignements donnés par M. le professeur Royer. Ils sont très affectés de la catastrophe et se demandent avec anxiété si l'on pourra renflouer le Lutin.  Paris, 18 octobre. Le second du « Lutin », l'enseigne Millot, est originaire de Tours et fils d'un général de brigade, décédé il y a quelques années, et il participa à l'expédition, du Tonkin.
Paris, 18 octobre. Le second du « Lutin », l'enseigne Millot, est originaire de Tours et fils d'un général de brigade, décédé il y a quelques années, et il participa à l'expédition, du Tonkin.

Le quartier-maître Louis Ollivier
Brest, 18 octobre. Louis Ollivier qui, comme nous l'avons dit, a été élevé par les époux Creignou, était très intelligent. Il fit ses études à l'école de l'Ile de Kerléan, puis, quand il obtint son certificat d'études, il voulut apprendre le métier de mécanicien» Les époux Creignou y consentirent et le placèrent chez M. Batrude, serrurier-mécanicien, place de la Mairie, où il resta trois
mois. En quittant l'atelier de M. Batrude, il entra à l'école des mousses où il se fit remarquer par son travail assidu et sa bonne conduite.
Louis Ollivier avait obtenu trois avancements successifs à bord du cuirassé "Pothuau »; à 19 ans et demi, il était quartier-maître.
LES CAUSES DE LA CATASTROPHE
 Cette hypothèse n'est pas absolument impossible, mais depuis longtemps les sous-marins plongent alors que la mer est quelquefois très agitée, et cela sans inconvénient. A la vérité, je serais moi-même très embarrassé pour fournir une explication. Et de ce fait que les deux sous-marins auxquels il soit arrivé des accidents semblables le Farfadet et le Lutin, sont de votre construction, faut-il en tirer une conclusion, un indice quelconque
Cette hypothèse n'est pas absolument impossible, mais depuis longtemps les sous-marins plongent alors que la mer est quelquefois très agitée, et cela sans inconvénient. A la vérité, je serais moi-même très embarrassé pour fournir une explication. Et de ce fait que les deux sous-marins auxquels il soit arrivé des accidents semblables le Farfadet et le Lutin, sont de votre construction, faut-il en tirer une conclusion, un indice quelconque
Longueur : 41,49 m - Maître-bau (sa plus grande larguer) : 2,90 m
Tirant d’eau : 2,68 m
Tonnages : 84,97 tonnes en surface, et 202,47 tonnes en plongée
Puissance : 600 cv (électrique)
Propulsion : 2 moteurs électriques Sautter-Harlé de 300 cv- 2 hélices à pales orientables
Vitesse : 6,10 nœuds en surface – 4,20 nœuds en plongée
Immersion : 35 m
Armement : 4 tubes lance-torpilles de 450 mm de diamètre.
Équipage : de 14 à 16 membres.
Le 16 octobre 1906, le Lutin appareille de Sidi-Abdallah pour une sortie d’exercice. Arrivé à environ 2 milles au nord-est de Bizerte, il sombre accidentellement par suite de l’éclatement d’un ballast. Le remorqueur qui l’accompagne donne l’alerte. Des remorqueurs venus de Toulon, des bâtiments britanniques et un navire de sauvetage danois et ses scaphandriers seront dépêchés sur les lieux, mais les conditions de la mer difficiles ne permettront pas le dragage de la zone du naufrage. Finalement une drague touchera l’épave qui sera ainsi localisée.
Le 23 octobre 1906, après 7 tentatives, l’épave du Lutin sera arrimée sous un dock flottant, comme le fut le Farfadet et sera transportée dans un bassin. Les cadavres des 16 membres de l’équipage seront alors extraits de la coque le 27 octobre 1906.
Bizerte, 18 octobre. Le ministre de la marine a reçu de l'amiral Bellue la dépêche suivante
Ce matin à 4 heures, dans un changement d'évitage, les haussières se sont dégagées du point de résistance sur lequel les scaphandriers étaient descendus hier sans résultat. Une bouée avait été mouillée en cet endroit. Dés le jour un scaphandrier est descendu et a atteint le fond qu'il a exploré dans un rayon de douze mètres sans rien voir. Les dragages ont repris en cet endroit, mais continuent ailleurs.
Ce matin à 4 heures, dans un changement d'évitage, les haussières se sont dégagées du point de résistance sur lequel les scaphandriers étaient descendus hier sans résultat. Une bouée avait été mouillée en cet endroit. Dés le jour un scaphandrier est descendu et a atteint le fond qu'il a exploré dans un rayon de douze mètres sans rien voir. Les dragages ont repris en cet endroit, mais continuent ailleurs.
SONT-ILS VIVANTS ?
Bizerte, 18 octobre. La coque du « Lutin » vient d'être retrouvée par 36 mètres de fond. Le sous-marin repose à plat sur le fond. Dans les milieux maritimes on émet l'espoir que des fissures n'ayant pas été relevées, l'équipage pourra être retrouvé vivant.
Les secours anglais
Bizerte, 18 octobre. Le cuirassé « Implacable", le croiseur ci Carnogos » et le destroyer « Albatros », venant de Malte, sont arrivés cette nuit, vers une heure, et ont mouillé en dehors du port...
Toulon, 18 octobre. M. Thomson est arrivé ce matin à Toulon à 10 heures. Il était accompagné de la commission d'enquête sur l'accident du "Lutin », composée de MM. le contre-amiral Barnaud, président de la section des sous-marins au comité technique l'ingénieur en chef Trébaol l'ingénieur chef Maugas, auteur des plans du « Lutin"; le lieutenant de vaisseau Voisin, secrétaire de la section des sous-marins.
Le ministre de la marine a été reçu sur le quai de la gare par le préfet des Bouches-du-Rhône, le contre-amiral Campion, etc. M. Thomson est alors monté dans un calandou, qui l'a conduit immédiatement au môle. Il a pris place ensuite dans la chaloupe à vapeur du commandant de la Jeanne-d'Arc, puis est monté à bord de ce croiseur, mouillé au bassin National. Le commandant et les officiers de l'état-major de la Jeanne-d'Arc ont reçu le ministre à la coupée, puis le croiseur a appareillé et levé l'ancre pour Bizerte.
Marseille, 18 octobre. M. Thomson, avant le départ de la Jeanne-d'Arc, a communiqué le programme suivant de la commission d'enquête sur l'accident du Lutin »
La commission s'appliquera à découvrir les causes de l'accident. Elle interrogera le personnel du convoyeur pour essayer de reconstituer les circonstances de la disparition du Lutin. Elle recherchera si rien dans le fonctionnement intérieur du matériel ne peut donner lieu à des présomptions, et si aucun accident caractéristique ne s'était produit sur le Lutin avant sa perte. Enfin elle s'efforcera de fixer les mesures à prendre pour empêcher à l'avenir sur les sous-marins le retour de semblable catastrophe.
La liste de l'équipage du Lutin
Paris, 18 octobre.
Le ministère de la marine communique la liste de l'équipage du sous-marin « Lutin, avec les pays d'origine.
- Olivier Charles Antoine, matelot torpilleur breveté
- Henri Bardane, quartier-maître mécanicien
- François Bellec, matelot torpilleur breveté
- François Bourges, second maître torpilleur
- Gustave Clairet, quartier-maître mécanicien
- Noël Donval, quartier-maître torpilleur
- Louis Dufau, matelot torpilleur breveté
- Oscar Fépoux, lieutenant de vaisseau
- Eugène Fortain, quartier-maître mécanicien
- Fortuné Guezel, quartier-maître mécanicien
- Eugène Maingault, quartier-maître torpilleur
- Jean-Baptiste Millot, enseigne de vaisseau
- Pierre Montsarrat, quartier-maître mécanicien
- Jean Yves Nicolas, second maître mécanicien
- Louis Ollivier, quartier-maître torpilleur
- Louis Sicher, quartier-maître mécanicien.
Dans l'Ouest-Eclair :
On remarquera que cette liste officielle ne fait pas mention d'Olivier Antoine, de Brest, dont nous avons parlé hier et qui fait partie de l'équipage du Lutin elle ne mentionne pas non plus Louis Sécher, dont nous publiions hier une lettre, et qui fait également partie de l'équipage du sous-marin.Faut-il en conclure que ces deux marins n'étaient pas à bord, pour une raison quelconque, une courte permission par exemple C'est ce à quoi on ne peut répondre d'une façon certaine pour le moment et ce point demande confirmation.
A Brest
Brest, 18 octobre. C'est toujours avec la plus vive anxiété que la population maritime de Brest attend des nouvelles du « Lutin".
On sait que deux des engloutis sont brestois Charles-Olivier Antoine, né à Lambézellec, le 6 avril 1883, et Louis-Charles Olivier, né à Brest, le 24 juin 1880. C'est cet après-midi seulement que la préfecture maritime a été avisée officiellement que deux marins du "Lutin" étaient de Brest.
Brest, 18 octobre. C'est toujours avec la plus vive anxiété que la population maritime de Brest attend des nouvelles du « Lutin".
On sait que deux des engloutis sont brestois Charles-Olivier Antoine, né à Lambézellec, le 6 avril 1883, et Louis-Charles Olivier, né à Brest, le 24 juin 1880. C'est cet après-midi seulement que la préfecture maritime a été avisée officiellement que deux marins du "Lutin" étaient de Brest.
Breveté torpilleur, âgé de 23 ans, de Brest Immédiatement, le préfet maritime a fait communiquer la nouvelle à M. Aubert, maire de Brest, en le priant de lui faire parvenir des renseignements sur les familles et de les aviser...
Brest, 18 octobre.
On sait que le lieutenant de vaisseau Fépoux était capitaine de la compagnie des mécaniciens à bord de la Bretagne, quand il fut appelé au commandement du Lutin.
M. Rayer, professeur à bord de la Bretagne, a fait le plus grand éloge du commandant du sous-marin, qui était un officier remarquable, intimement lié a-t-il dit avec le lieutenant de vaisseau Théroulde, qui venait d'être récemment choisi, comme aide de camp par l'amiral Bellue, le lieutenant de vaisseau Fépoux était fout heureux de son commandement, qui le rapprochait de son meilleur ami.
M. Rayer, professeur à bord de la Bretagne, a fait le plus grand éloge du commandant du sous-marin, qui était un officier remarquable, intimement lié a-t-il dit avec le lieutenant de vaisseau Théroulde, qui venait d'être récemment choisi, comme aide de camp par l'amiral Bellue, le lieutenant de vaisseau Fépoux était fout heureux de son commandement, qui le rapprochait de son meilleur ami.
 M. Fépoux, très instruit et très travailleur. se plaisait au milieu des jeunes gens qui, à bord de notre vaisseau, se destinent à embrasser la carrière de mécaniciens dans la marine. Il leur faisait lui-même des cours, et sa compagnie pouvait être citée comme modèle.
M. Fépoux, très instruit et très travailleur. se plaisait au milieu des jeunes gens qui, à bord de notre vaisseau, se destinent à embrasser la carrière de mécaniciens dans la marine. Il leur faisait lui-même des cours, et sa compagnie pouvait être citée comme modèle. Sous des dehors un peu froids, peut-être, il cachait un excellent cœur et avait sa s'attirer les sympathies de tout l'équipage. »
Sous des dehors un peu froids, peut-être, il cachait un excellent cœur et avait sa s'attirer les sympathies de tout l'équipage. »M. Royer ajoute que le lieutenant de vaisseau Fépoux, qui est né à Strasbourg, a fait de brillantes études aux lycées de Nancy et de Brest, puis à l'école navale dont il sortit un des premiers.
 Nommé aspirant de 1ère classe le 5 octobre 1894 et enseigne le 5 octobre 1896, il fut promu au choix lieutenant de vaisseau le 19 octobre 1903.
Nommé aspirant de 1ère classe le 5 octobre 1894 et enseigne le 5 octobre 1896, il fut promu au choix lieutenant de vaisseau le 19 octobre 1903.M. Fépoux, marié, il y a deux ans environ, avec une Parisienne, fille d'un négociant en fourrure, M. Aldebert, a une fillette d'an an...
 Les autres officiers du bord confirment tous les renseignements donnés par M. le professeur Royer. Ils sont très affectés de la catastrophe et se demandent avec anxiété si l'on pourra renflouer le Lutin.
Les autres officiers du bord confirment tous les renseignements donnés par M. le professeur Royer. Ils sont très affectés de la catastrophe et se demandent avec anxiété si l'on pourra renflouer le Lutin. L'enseigne Millot
 Paris, 18 octobre. Le second du « Lutin », l'enseigne Millot, est originaire de Tours et fils d'un général de brigade, décédé il y a quelques années, et il participa à l'expédition, du Tonkin.
Paris, 18 octobre. Le second du « Lutin », l'enseigne Millot, est originaire de Tours et fils d'un général de brigade, décédé il y a quelques années, et il participa à l'expédition, du Tonkin.
Le quartier-maître Louis Ollivier
Brest, 18 octobre. Louis Ollivier qui, comme nous l'avons dit, a été élevé par les époux Creignou, était très intelligent. Il fit ses études à l'école de l'Ile de Kerléan, puis, quand il obtint son certificat d'études, il voulut apprendre le métier de mécanicien» Les époux Creignou y consentirent et le placèrent chez M. Batrude, serrurier-mécanicien, place de la Mairie, où il resta trois
mois. En quittant l'atelier de M. Batrude, il entra à l'école des mousses où il se fit remarquer par son travail assidu et sa bonne conduite.
Louis Ollivier avait obtenu trois avancements successifs à bord du cuirassé "Pothuau »; à 19 ans et demi, il était quartier-maître.
LES CAUSES DE LA CATASTROPHE
 |
| lettre du commandant Fépoux à un ami L'Ouest-Eclair 28-10-1906 |
M. Maugas- constructeur du « Lutin » et du Farfadet » croit à une erreur de manoeuvre. On en est cependant réduit à des hypothèses
Paris, 18 octobre. Il était intéressant d'avoir sur les causes de la catastrophe l'opinion du constructeur lui-même, M. Maugas. le rédacteur de l'Echo de Paris » a pu avoir avec lui au moment de son départ avec le ministre de la marine pour Bizerte la conversation suivante
Paris, 18 octobre. Il était intéressant d'avoir sur les causes de la catastrophe l'opinion du constructeur lui-même, M. Maugas. le rédacteur de l'Echo de Paris » a pu avoir avec lui au moment de son départ avec le ministre de la marine pour Bizerte la conversation suivante
Quelles sont les causes, selon vous, de l'accident ?
Nous n'en pouvons pas définir les causes. De même que l'on peut être tué dans la rue en se promenant, on est exposé à se noyer pour de multiples raisons qui restent inconnues de tout le monde.Peut-on attribuer la catastrophe à ce fait que le navire est sorti par une très forte houle ? L'amiral Touchard, à Toulon, a déclaré que, selon lui, le bateau aura voulu plonger en dépit de la houle, et se sera jeté contre un fond.
 Cette hypothèse n'est pas absolument impossible, mais depuis longtemps les sous-marins plongent alors que la mer est quelquefois très agitée, et cela sans inconvénient. A la vérité, je serais moi-même très embarrassé pour fournir une explication. Et de ce fait que les deux sous-marins auxquels il soit arrivé des accidents semblables le Farfadet et le Lutin, sont de votre construction, faut-il en tirer une conclusion, un indice quelconque
Cette hypothèse n'est pas absolument impossible, mais depuis longtemps les sous-marins plongent alors que la mer est quelquefois très agitée, et cela sans inconvénient. A la vérité, je serais moi-même très embarrassé pour fournir une explication. Et de ce fait que les deux sous-marins auxquels il soit arrivé des accidents semblables le Farfadet et le Lutin, sont de votre construction, faut-il en tirer une conclusion, un indice quelconque Je ne puis voir là qu'une coïncidence déplorable.
Sources :
L'Ouest-Eclair
Sources :
L'Ouest-Eclair