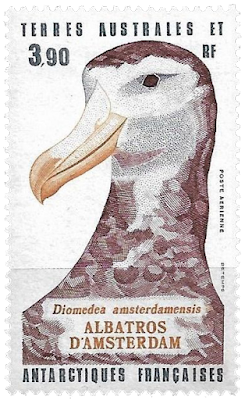Hôtel de la Marine place de la Concorde Paris
 |
| Photo JM Bergougniou |
Le monument, en tant que témoin de plus de 200 ans d’histoire, vous invite à traverser les époques et à revivre certains événements majeurs, depuis l’Intendance de Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray à l’Occupation de Paris lors de la Seconde Guerre mondiale en passant par l’abolition de l’esclavage.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Elément central du bâtiment, l'escalier d'honneur est emprunté par tous les invités prestigieux qui viennent à l'Hôtel de la Marine, notamment lors des nombreux bals donnés tout au long du XIXe siècle.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Pourquoi les dauphins symbolisent souvent la marine et les marins ? Explication grâce à la mythologie grecque ! Un jour, Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse, prend un bateau pour se rendre sur l'île de Naxos. Il voyage incognito sous l'aspect d'un jeune mortel. Pendant la traversée, il surprend une conversation entre les marins qui projettent de le vendre comme esclave en Asie. Dionysos entre alors dans une colère folle, transforme les avirons en serpents, fait pousser une vigne prodigieuse qui envahit le navire, pendant qu'un son de flûte sorti de nulle part finit de terroriser les marins. La seule échappatoire pour eux est de sauter à la mer, vers une mort certaine. C'est alors que Poséidon, dieu de la mer, intervient à la rescousse des malheureux et les transforme en dauphins. Sauvés, ils sont depuis en charge de venir en aide aux naufragés.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Siège de l’état-major de la Marine de 1789 à 2015, ce monument emblématique de la place de la Concorde va s’ouvrir au public prochainement. Après quatre ans de travaux pour une très belle restauration.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Aménagés dès 1765 par Pierre Elisabeth de Fontanieu, les appartements de l’intendant sont remodelés à partir de 1786 par Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray. Ils sont un exemple de l’appartement idéal, tel qu’il était perçu à la fin du siècle des Lumières, disposant a minima d’une antichambre, d’une chambre et d’un cabinet.
Les appartements de l'intendant sont situés à l’est, au premier étage, « l’étage noble », donnant actuellement sur la place de la Concorde et la rue Saint-Florentin.
Transformés au fil de années en fonction des occupants des lieux, ils comprennent aujourd’hui :
Transformés au fil de années en fonction des occupants des lieux, ils comprennent aujourd’hui :
● Au nord, les appartements de Thierry de Ville d’Avray : une antichambre, une chambre, le cabinet d’audience et le cabinet des bains.
● Au sud, la chambre de Madame Thierry de Ville d’Avray.
● Les deux appartements sont reliés entre eux par les pièces de réception : salon et salle à manger.
● Sur cour, la chambre de Pierre Elisabeth de Fontanieu ainsi que le cabinet des glaces et le cabinet doré installés par l’intendant.
La place Louis XV, actuelle place de la Concorde, doit sa création à la volonté de la Ville de Paris d’édifier une statue à la gloire du roi Louis XV en 1748.
Pour mettre en valeur cette statue équestre commandée à Edmé Bouchardon, l’idée d’une place à la gloire du roi, sur le modèle de la place Vendôme et de la place des Vosges, fait son chemin
C’est en 1765 que l’on décide d’installer le Garde-Meuble royal, institution en charge du mobilier du roi, dans le palais le plus à l’est (entre l’actuelle rue Royale et la rue Saint-Florentin), le futur Hôtel de la Marine. Censé, dans un premier temps, n’occuper qu’une partie du bâtiment, le Garde-Meuble finit par investir l’entièreté du lieu en 1767.
Pierre-Elisabeth de Fontanieu, intendant à la tête du Garde-Meuble, en profite pour faire aménager l’Hôtel pour répondre pleinement aux besoins de son administration : lieux de stockage, ateliers, appartements de fonction, galeries d'exposition, lieu de vie également avec sa chapelle…
La façade se décompose comme suit :
au niveau de la rue : un soubassement à arcades permet la circulation des Parisiens.
Dès le début de la Révolution, le roi Louis XVI quitte Versailles pour Paris.
Toutes les administrations de l’État présentes à Versailles doivent donc regagner la capitale.
Mais un obstacle de taille se dresse : où les installer à Paris ? Le ministère de la Marine, avec à sa tête le comte de La Luzerne et Jean-Baptiste Berthier, s’installe dans le palais abritant le Garde-Meuble en 1789.
Dans un premier temps, la Marine occupe des espaces au deuxième étage et à l’ouest du premier étage. Il lui faudra moins de 10 ans avant de pouvoir occuper le bâtiment dans son ensemble. C’est le début de deux siècles de présence de cette administration dans ce palais qui portera désormais le nom d’Hôtel de la Marine. Ce n’est qu’en 2015 que le ministère de la Marine quitte le bâtiment.
Louis-Antoine de Bougainville navigateur et explorateur Charles Louis du Couëdic : officier de marine ayant participé à la guerre d'indépendance des États-Unis ;
Claude de Forbin : officier de marine français du Grand Siècle ; Jean-François de La Pérouse
Dans la première moitié du XIXe siècle, les ministres successifs tentèrent de s'approprier l'ancienne galerie des meubles. Cette galerie servait, à l'époque du Garde-Meuble, à exposer les grosses pièces de mobilier au public. Elle était donc très large et peu pratique.
 Après de nombreuses tentatives avortées, l'amiral Mackau, nommé ministre de la Marine en 1843, lança une grande restauration de cette galerie pour en faire un salon de réception et une grande salle à manger.
Après de nombreuses tentatives avortées, l'amiral Mackau, nommé ministre de la Marine en 1843, lança une grande restauration de cette galerie pour en faire un salon de réception et une grande salle à manger.
La décoration de ces pièces est grandiose : des panneaux blancs font ressortir des décors en bois sculptés et dorés. Les cheminées de part et d'autre de l'ensemble sont surmontées de glaces où se reflètent les lustres et les dorures du plafond.
Ces pièces seront un écrin parfait pour tous les événement de prestige organisés par l'État ou les ministres de la Marine tout au long des XIXe et XXe siècles.
Mais l’accès s’est refermé après la Révolution avec l’installation de l’état-major de la Marine, qui va y rester plus de 200 ans. Une continuité d’occupation qui s’est avérée « une chance » pour le CMN.
« Car la Marine, qui a modifié des pièces en salon d’apparat au XIXe, a seulement fait repeindre, sans rien détruire, les appartements de l’intendant du Garde-meuble ».
Tous les médaillons sont identiques et surmontés d'une étoile sauf...
celui de Rochefort qui est inversé et surmonté du monogramme « N »
finement entrelacé du chiffre « 3 »,symbole de Napoléon III.
C'est grâce à ce détail que l'on peut dater la réalisation de ce décor
sous le Second Empire
Si on vous dit « marine », vous pensez « port » ? Ce sont bien les ports de guerre qui sont mis à l'honneur dans une galerie donnant sur la cour d'honneur dans un décor en bois sculpté datant des années 1867-1870. On retrouve donc, dans cette galerie à l'esprit « colonial », les cinq principaux ports de guerre de l'époque : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.
Leurs noms sont écrits dans des médaillons dorés sur des panneaux en bois peints pour imiter l'ébène ou encore l'acajou.
● Les deux appartements sont reliés entre eux par les pièces de réception : salon et salle à manger.
● Sur cour, la chambre de Pierre Elisabeth de Fontanieu ainsi que le cabinet des glaces et le cabinet doré installés par l’intendant.
 |
| Photo JM Bergougniou |
La place Louis XV, actuelle place de la Concorde, doit sa création à la volonté de la Ville de Paris d’édifier une statue à la gloire du roi Louis XV en 1748.
Pour mettre en valeur cette statue équestre commandée à Edmé Bouchardon, l’idée d’une place à la gloire du roi, sur le modèle de la place Vendôme et de la place des Vosges, fait son chemin
Après l’édification des plans et le lancement des travaux d’aménagement de la place, il est temps de trouver une affectation pour les deux palais situés au nord de la place.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Pierre-Elisabeth de Fontanieu, intendant à la tête du Garde-Meuble, en profite pour faire aménager l’Hôtel pour répondre pleinement aux besoins de son administration : lieux de stockage, ateliers, appartements de fonction, galeries d'exposition, lieu de vie également avec sa chapelle…
 |
| Photo JM Bergougniou |
La façade se décompose comme suit :
au niveau de la rue : un soubassement à arcades permet la circulation des Parisiens.
de chaque côté, deux pavillons d’angle tracés selon l’utilisation de dimensions symboliques pour en faire un parfait exemple d’architecture académique et de référence à l’Antiquité. Ils sont tous les deux surmontés de frontons triangulaires sculptés représentant la Magnificence et la Félicité publique. Elles sont l’œuvre de Guillaume Coustou et Michel-Ange Slodtz.
la partie centrale est marquée par une loggia avec une colonnade rappelant les péristyles antiques. Les 12 colonnes crantées sont surmontées de chapiteaux corinthiens.
la partie centrale est marquée par une loggia avec une colonnade rappelant les péristyles antiques. Les 12 colonnes crantées sont surmontées de chapiteaux corinthiens.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Durant près de vingt-cinq ans, le Garde-Meuble et son intendant, Pierre-Elisabeth de Fontanieu puis Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray, vont occuper le palais.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Dès le début de la Révolution, le roi Louis XVI quitte Versailles pour Paris.
Toutes les administrations de l’État présentes à Versailles doivent donc regagner la capitale.
Mais un obstacle de taille se dresse : où les installer à Paris ? Le ministère de la Marine, avec à sa tête le comte de La Luzerne et Jean-Baptiste Berthier, s’installe dans le palais abritant le Garde-Meuble en 1789.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Dans un premier temps, la Marine occupe des espaces au deuxième étage et à l’ouest du premier étage. Il lui faudra moins de 10 ans avant de pouvoir occuper le bâtiment dans son ensemble. C’est le début de deux siècles de présence de cette administration dans ce palais qui portera désormais le nom d’Hôtel de la Marine. Ce n’est qu’en 2015 que le ministère de la Marine quitte le bâtiment.
 |
| Photo JM Bergougniou |
 |
| Photo JM Bergougniou |
 |
| Photo JM Bergougniou |
Sur les murs, se trouvent les portraits d'amiraux célèbres de l'Ancien Régime :
Anne Hilarion de Costentin de Tourville : vice-amiral de Louis XIV ;
Jean Bart : corsaire issu d'une famille de marins renommés ;
René Duguay-Trouin : corsaire malouin au quatre-vingts combats ;
Abraham Duquesne : lieutenant-général des armées navales de Louis XIV ;
Anne Hilarion de Costentin de Tourville : vice-amiral de Louis XIV ;
Jean Bart : corsaire issu d'une famille de marins renommés ;
René Duguay-Trouin : corsaire malouin au quatre-vingts combats ;
Abraham Duquesne : lieutenant-général des armées navales de Louis XIV ;
 |
| Photo JM Bergougniou |
 |
| Photo JM Bergougniou |
: Capitaine de vaisseau et explorateur, il disparaît en mer en 1788 ;
Pierre-André de Suffren : vice-amiral célèbre pour ses nombreux exploits face à la Marine anglaise ;
Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville : officier de marine et homme politique pendant la Révolution française.
Pierre-André de Suffren : vice-amiral célèbre pour ses nombreux exploits face à la Marine anglaise ;
Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville : officier de marine et homme politique pendant la Révolution française.
 |
| Photo JM Bergougniou |
 |
| Photo JM Bergougniou |
Dans la première moitié du XIXe siècle, les ministres successifs tentèrent de s'approprier l'ancienne galerie des meubles. Cette galerie servait, à l'époque du Garde-Meuble, à exposer les grosses pièces de mobilier au public. Elle était donc très large et peu pratique.
 Après de nombreuses tentatives avortées, l'amiral Mackau, nommé ministre de la Marine en 1843, lança une grande restauration de cette galerie pour en faire un salon de réception et une grande salle à manger.
Après de nombreuses tentatives avortées, l'amiral Mackau, nommé ministre de la Marine en 1843, lança une grande restauration de cette galerie pour en faire un salon de réception et une grande salle à manger. |
| Photo JM Bergougniou |
Ces pièces seront un écrin parfait pour tous les événement de prestige organisés par l'État ou les ministres de la Marine tout au long des XIXe et XXe siècles.
 |
| Photo JM Bergougniou |
Mais l’accès s’est refermé après la Révolution avec l’installation de l’état-major de la Marine, qui va y rester plus de 200 ans. Une continuité d’occupation qui s’est avérée « une chance » pour le CMN.
 |
| Photo JM Bergougniou |
« Car la Marine, qui a modifié des pièces en salon d’apparat au XIXe, a seulement fait repeindre, sans rien détruire, les appartements de l’intendant du Garde-meuble ».
En retirant jusqu’à dix-huit couches de peinture accumulées au fil des ans, « nous avons pu retrouver celle d’origine, qui était protégée par un vernis ». Plutôt que « de tenter de refaire à l’identique, nous nous sommes attachés à remettre au jour, petit à petit, ces décors du XVIIIe cachés. L’ensemble a ensuite été restauré comme un tableau. » |
 |
| Photo JM Bergougniou |
celui de Rochefort qui est inversé et surmonté du monogramme « N »
finement entrelacé du chiffre « 3 »,symbole de Napoléon III.
C'est grâce à ce détail que l'on peut dater la réalisation de ce décor
sous le Second Empire
Si on vous dit « marine », vous pensez « port » ? Ce sont bien les ports de guerre qui sont mis à l'honneur dans une galerie donnant sur la cour d'honneur dans un décor en bois sculpté datant des années 1867-1870. On retrouve donc, dans cette galerie à l'esprit « colonial », les cinq principaux ports de guerre de l'époque : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.
Leurs noms sont écrits dans des médaillons dorés sur des panneaux en bois peints pour imiter l'ébène ou encore l'acajou.