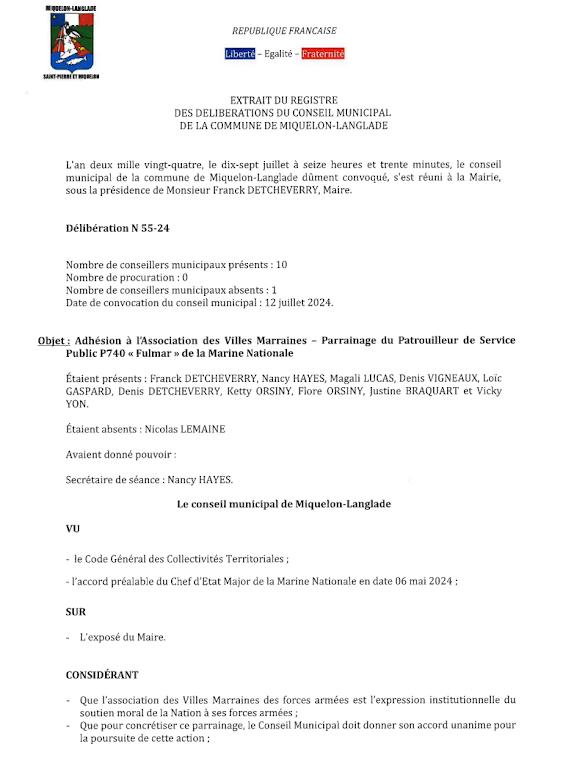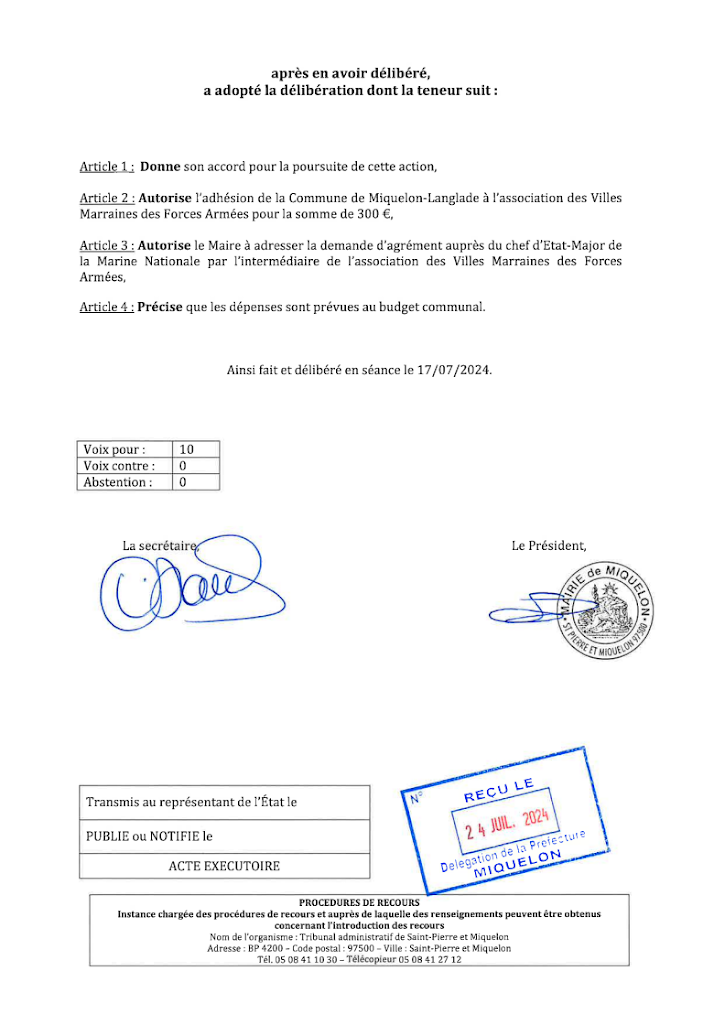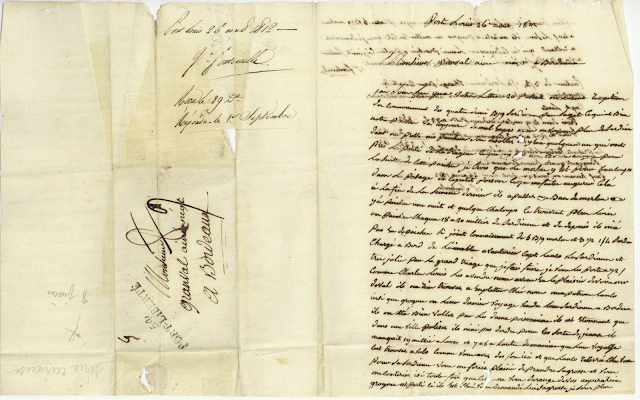Dunkerque - FREMM AQUITAINE
 |
| Seamen's Club © JM Bergougniou |
Dimanche, les visites étaient réservées au grand public, permettant à chacun de se familiariser avec la vie à bord. Les visiteurs ont pu en apprendre davantage sur les missions essentielles du navire. La FREMM Aquitaine, vaisseau polyvalent de la Marine nationale, est conçue pour mener des opérations anti-sous-marines, antiaériennes et contre des menaces de surface.
 |
| Dunkerque le port et la sidérurgie © JM Bergougniou |
En son sein, des systèmes de détection et de surveillance avancés. L’armement du navire comprend des missiles de croisière navals et des torpilles. Les infrastructures permettent d’accueillir un hélicoptère NH90 à bord. Le quotidien des marins a également été abordé comme les conditions de vie en mer, les rotations des quarts et l’importance du travail en équipe pour assurer le bon fonctionnement du navire.
À la tête du navire : François Trystram, commandant de la FREMM Aquitaine. Son histoire résonne avec la ville de Dunkerque, puisque son nom est directement lié à l’histoire maritime locale. Une statue en bronze du commandant Trystram, un parent de l’actuel capitaine, trône sur le port de Dunkerque. Elle témoigne de son engagement passé pour la Marine.
 |
| François Trystram commandant de L'Astrolabe © JM Bergougniou |
François Trystram s’est illustré dans de nombreuses missions de sécurité maritime et de lutte contre la piraterie. Diplômé de l’École navale, il a gravi les échelons en occupant des postes de responsabilité, notamment en tant qu’officier de manœuvre et commandant en second sur différentes unités.
 La frégate multi-missions Aquitaine est en escale à Dunkerque ce dimanche. Le bateau sera exceptionnellement ouvert au public.
La frégate multi-missions Aquitaine est en escale à Dunkerque ce dimanche. Le bateau sera exceptionnellement ouvert au public.
Au programme : rencontre avec l'équipage, et visite du navire. Long de 142 mètres et large de 20 mètres, il est armé par deux équipages de 109 marins chacun. Rendez-vous dimanche après-midi de 13h à 17h30 quai Freycinet 6. C'est gratuit sur simple présentation d'une pièce d'identité. Chaussures fermées obligatoire, et pas d'accès pour personnes à mobilité réduite.
 |
| Statue de JB Trystram © JM Bergougniou |
 |
| Dunkerque - L'hôtel de ville © JM Bergougniou |
Député de 1876 à 1877, de 1878 à 1885, et de 1886 à 1889, né à Ghyvelde (Nord) le 9 janvier 1821, il fonda à Dunkerque une importante maison de commerce. Membre de la chambre de commerce, il comptait parmi les républicains modérés, adversaires de l'Empire, lorsque le gouvernement de la Défense nationale le nomma (24 septembre 1870) sous-préfet de Dunkerque. Il donna sa démission le 1er avril 1871, fut élu conseiller général du canton ouest de Dunkerque, devint président de la chambre de commerce, s'intéressa à la question de l'amélioration des ports de la ville
 |
| Ecluse Trystram © JM Bergougniou |
Il fut élu, le 20 février 1876, député de la 2e circonscription de Dunkerque, par 5 874 voix (9 839 votants, 13 695 inscrits), contre 3 920 à M. Dupuy de Lôme, bonapartiste. Il fut des 363.
Candidat républicain, le 14 octobre 1877, dans la même circonscription, il échoua avec 4 905 voix, contre 5 911 au candidat officiel élu, M. d'Arras. Mais l'élection de ce dernier ayant été invalidée, M. Trystram regagna son siège, le 7 juillet 1878, par 5 495 voix (8 100 votants, 14 180 inscrits), contre 2 248 à M. d'Arras, député sortant.
Il appartint à la majorité opportuniste qui soutint le ministère Dufaure, vota :
- pour l'article 7,
- pour l'invalidation de l'élection de Blanqui,
- contre l'amnistie plénière.
Il obtint le renouvellement de son mandat, le 21 août 1881, par 6 364 voix (7 180 votants, 14 541 inscrits.) Il appuya les cabinets Gambetta et Ferry, et se prononça pour les crédits de l'expédition du Tonkin.Porté, le 4 octobre 1885, sur la liste républicaine du Nord, il échoua avec 122 987 voix (292 696 votants). Mais il prit sa revanche le 21 novembre 1886, avec 148 986 voix (273 636 votants, 352 693 inscrits), contre 122 370 à M. Dervaux, revint siéger à gauche, donna son suffrage à la politique des cabinets Rouvier et Tirard, et opina, en dernier lieu :
- pour le rétablissement du scrutin d'arrondissement (11 février 1889),
- contre l'ajournement indéfini de la révision de la Constitution,
- pour les poursuites contre trois députés membres de la Ligue des Patriotes,
- pour le projet de loi Lisbonne restrictif de la liberté de la presse,
- pour les poursuites contre le général Boulanger.
Merci à Romuald