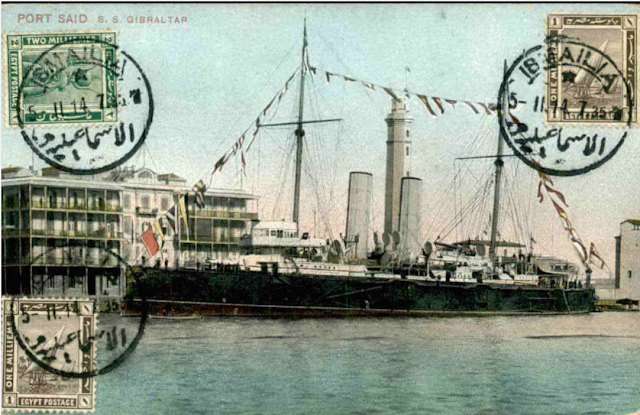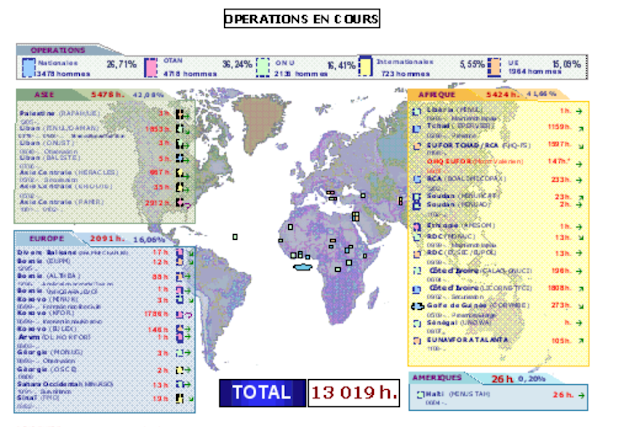La Radio TSF à Saint-Paul
Le radio de la première campagne est M. Lyssorgues, celui de la seconde campagne M. Gonthier.
Il n'y a pas de radio sur l'île durant la période d'hivernage. Le fournisseur de matériel Radio est M. Duguet. Mais il apparait que M. Duguet bien qu'ingénieur-constructeur et fabriquant de TSF n'a pas monté celui de l'île Saint-Paul (Ce serait M. Bertrand). Il a servi de courtier entre la Société de Pêche".
L'Antenne va interroger un ingénieur radio extérieur au débat qui va déclarer :
"Quand vous recevez chez vous un client qui arrive bien décidé à liliter sa dépense, qui s'est fixé une certaine somme, le laisserez vous repartir sans rien lui proposer qui rentre dans ses prix?... le laisserez vous partir sans rien lui proposer qui soit dans ses prix ... surtout si vous avez un appareil de nature à répondre aux besoins qu'il vous à fait connaître, et que vous pouvez lui céder dans les limites du prix qu'il vous a indiqué... Moi je vous réponds non"
La radio alimentée en électricité depuis l'usine pour charger les accus.
Plusieurs articles dans l'Antenne sous la plume de F. Soulier-Valbert évoque ce poste de radio.
"Un poste de radio avait été installé sur l'île pour maintenir le contact entre la petite colonie et la France. Ce poste qui connut de nombreux avatars , est la raison d'être de cet article. : j'y reviendrai tout à l'heure pour en parler plus longuement."Le journal donne souvent la parole à M. Gonthier ( T.S.F. de première classe de la Marine marchande) qui évoque d'abord son arrivée sur l'île.
" Je trouvais à mon arrivée à l'île Saint-Paul un poste type Mesny de 100 watts, puissance que je jugeais insuffisante pour la liaison bilatérale avec la France, que m'imposait mon contrat avec la société La Langouste Française."
René Mesny était officier de marine, professeur à l'École navale et pionnier de la radio. Il a découvert et développé l'utilisation des ondes métriques et a inventé un oscillateur symétrique à deux tubes pour ondes ultracourtes.
"J'avais monté une antenne Zeppelin de 54 mètres de long, plus deux "feeders" de 27 mètres . J'ai du ensuite monter par les moyens du bord un support Edison pour une de mes lampes car j'avais en tout un support Edison normal et un idem Goliath.
Parfois appelée "End Fed" par les anglo-saxons, elle fait partie de ces antennes alimentées par une extrémité. Elle tient son nom des fameux dirigeables pour l'équipement desquels elle fut mise au point. On la rencontre souvent dans les stations d'amateurs trafiquant sur bandes décamétriques et ne disposant que d'un espace réduit, le point d'alimentation étant proche de la station.
Elle est constituée d'un fil rayonnant d'une longueur égale à la demi-onde de la fréquence fondamentale pour laquelle l'antenne est taillée. L'alimentation de l'antenne est assurée par une ligne bifilaire d'impédance 300 à 600 ohms à une extrémité du fil, là ou se trouve un ventre de tension.
« Les scènes que je vais décrire se sont passées dans cette île au cours de l’année 1930… Le personnel fut recruté tant en France qu’à Madagascar ou à La Réunion et comprenait au début 108 personnes, dont 22 blancs et 6 blanches, 80 noirs originaires de Madagascar … »
« Toujours est-il qu’une première alerte fut donnée dans la presse française vers fin de 1929… Certains journaux annoncèrent que l’île Saint-Paul, victime d’une secousse sismique, s’était abimée dans les flots ».
« Saint-Paul se fit entendre à nouveau, avant de s’éteindre définitivement le 3 mars 1930. Ce jour là, presque toute la colonie fut embarquée à destination de la Réunion »
Sources
L'Antenne n° 434 L'Antenne n° 434 19 juillet 1931