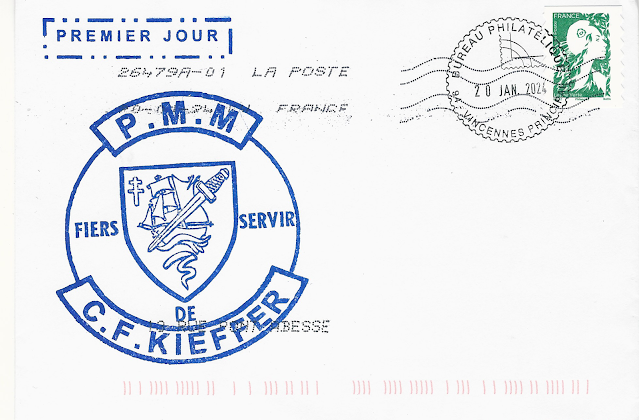Service de renseignementS aux familles Annecy Menthon St-Bernard Guerre 1939-1945 Marine
Déjà en 1914 un bureau de renseignements des familles centralise les informations relatives aux blessés, aux disparus et aux soldats français prisonniers.
La correspondance entre la zone occupée et la zone non-occupée sont interdites depuis l'armistice du 22 juin 1940. Les autorités allemandes fixent la reprise de la correspondance interzones au 1er août 1940, mais les modalités de la correspondance familiale ne sont pas encore en place.
utilisation de formulaires spécifiques exclusivement imprimés et mis en vente par l'administration.
interdiction d'ajouter des timbres-poste. interdiction d'ajouter des mentions en dehors de espaces prévus.
A partir du 2 juin 1941, les cartes postales ordinaires de type entier postal sont autorisées pour la correspondance interzones.
En France les entiers suivants seront successivement utilisés :
Iris 80c - Pétain 80c - Pétain 80c avec griffe encadrée complément de taxe perçue (changement de tarif du 5 janvier 1942) - Pétain 1F20
Le 11 novembre, à 4 h du matin Pierre Laval, en visite à Munich, est informé de la décision de Hitler de l’occupation totale de la France. Pétain en est également informé par une lettre personnelle du Führer. À 5 h 25, Hitler ordonne à ses troupes de traverser la France pour occuper la côte de la Méditerranée et participer avec les Italiens à la « protection » de la Corse.
À 7 h, Radio Paris diffuse « un message du Führer au peuple français » :
« […] L’Armée allemande ne vient pas en ennemie du peuple français, ni en ennemie de ses soldats. Elle n’a qu’un but : repousser, avec ses alliés, toute tentative de débarquement anglo-américain. Avec l’Armée française, ils entreprendront la défense des frontières françaises contre les attaques ennemies. »
Le 11 novembre 1942, le contre-amiral Gabriel Auphan avait donné l'ordre aux deux amiraux de Toulon de :
s'opposer, sans effusion de sang, à l'entrée des troupes étrangères dans les établissements, bases aériennes, ouvrages de la marine ;
s'opposer de même à l'entrée des troupes étrangères à bord des bâtiments de la flotte ; par des négociations locales, s'efforcer d'arriver à un accord ;
en cas d'impossibilité, saborder les bâtiments.
C'est cette dernière solution qui sera appliquée, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1942, les amiraux André Marquis et Jean de Laborde ayant appris que les Allemands étaient sur le point de tenter un coup de main sur la flotte.
11 novembre 1942 : A la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, invasion de la "zone non occupée" par les Allemands. Les Italiens occupent une grande partie du Sud-Est.
Les anciennes "zone occupée" et "zone non-occupée" porteront rapidement le nom de "Zone Nord" et de "Zone Sud".
Le courrier venant par l'étranger est censuré par les Allemands à Paris (censure "x"), à Lyon (censure "l") et à Bordeaux (censure "y").
1er janvier 1943 : L'Agence Économique des Colonies prend en charge le Service de Renseignements au Familles.
10 février 1943 : Accord des autorités allemandes pour la reprise du trafic de télégrammes familiaux entre les zones occupées et non-occupées d'une part et l'Indochine par voie radiophonique.
 |
| Carte Postale en FM - cachet sur 4 lignes Service des Renseignements aux familles Préfecture Maritime Flamme Toulon 8-V-1943 |
DÉBUT 1943 : L'envoi de télégrammes par la voie officielle est possible pour les civils par l'Agence Économique des Colonies, à raison d'un message trimestriel de sept mots et pour les militaires à raison d'un message mensuel par la Direction des Services Militaires à Chamalières.
 |
| Pli privé référence 169X destiné au sous-marin Protée ayant rallié la force X à Alexandrie |
1er Juillet 1943 : La population civile d'indochine est autorisée à expédier un télégramme par mois et par famille.
PAR LE SERVICE (MILITAIRE) DE RENSEIGNEMENTS AUX FAMILLES SITUÉ A TOULON
Les familles peuvent répondre par le même canal à raison d'un message de 10 mots par mois.
Les premiers messages de 1941 sont envoyés sur carte postale Iris avec texte "au tampon". Puis ce sera des cartes pré-imprimées en franchise militaire.
 |
| Verso référence S.1427 de l'ingénieur mécanicien de 1ere classe à Unité Marine Saïgon daté de Annecy le 22-12-43 |
 |
| Hôtel des Alpes Annecy |
 |
| message d'Emile Binois Ingénieur mécanicien à Saïgon Marine transmis par le service des renseignements aux familles replié à Menthon St-Bernard TàD 20-4-1944 |
 |
| Toulon rayé remplacé par Menthon message expédié le 5-4 référence S.376 |
Les messages télégraphiques et les messages radio
 |
| Toulon sur Mer 10-XII-1941 |
Outre les courriers échangés, les marins avaient la possibilité de communiquer avec leur famille par le biais de télégrammes et de messages radio.
 |
| Envoi de Toulon SRF Toulon Préfecture maritime 18-XI-1942 |
https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_051228