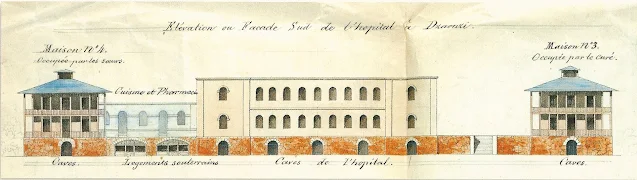Louis-Alexandre-Antoine Mizon
Des marins méconnus ou mal connus comme Mizon
Transport-écurie Corrèze
Né le 16 juillet 1853 à PARIS, Il entre dans la Marine en 1869 (port TOULON) . Il est aspirant le 2 octobre 1872 puis Enseigne de vaisseau le 27 avril 1875.Il est affecté le 1er janvier 1879, sur le transport "CORRÈZE", Service des transport réguliers (Cdt Auguste PELLISSIER-TANON).Au 1er janvier 1881, il est détaché en congé sans solde, Hors-cadre à/c du 28 juillet 1880
La prise de possession de Mayotte par le capitaine Pierre Passot s'effectue officiellement le 13 juin 1843 en application d'un traité conclu le 25 avril 1841 avec le sultan Andriantsoly.
L'île dépend initialement de l'autorité du commandant supérieur de Nosy Be en vertu d'une ordonnance du 29 août 1843 qui place Mayotte et Sainte-Marie de Madagascar sous sa direction.
 |
| Msindzano - masque à base de santal Mayotte photo JM Bergougniou |
La fonction de Commandant supérieur de Mayotte et ses dépendances est instituée en 1844 lorsque l'île est détachée de l'établissement de Nosy-Be.
Elle perd son autonomie pour être placée sous l'autorité du gouverneur de La Réunion en 1878.
La colonie de Mayotte et dépendances devient une entité administrative de plein droit dirigée par un gouverneur de plein exercice en 1886. Son premier gouverneur entre en fonction en 1887.
 |
| Cimetière chrétien de Pamandzi Sandavangeu Sous les frangipaniers- photo JM Bergougniou |
Un décret du 28 janvier 1896 supprime le gouvernement de Mayotte. La colonie est dès lors dirigée par des administrateurs supérieurs subordonnés au Gouverneur de La Réunion
À partir de 1908, les administrateurs supérieurs de Mayotte changent de tutelle. Ils dépendent désormais de l'autorité hiérarchique du Gouverneur général de Madagascar. Mayotte est incorporée à l'entité des Comores à compter du 25 juillet 1912.
Le territoire des Comores devient le 27 octobre 1946 un territoire d'outre-mer (TOM) administrativement détaché de Madagascar.


Cependant, la savane et la brousse lui manquent. Pendant trois ans, il va explorer l' Afrique centrale
10 août 1892, les membres de la seconde mission Mizon embarquent à Pauillac, à bord de la Ville-de-Céréa. La mission scientifique comprend, outre Mizon, l’enseigne de vaisseau Bretonnet, Albert Nebout, l’adjudant Chabredier, du 12e régiment d'infanterie, le chérif El-Hadj-Mahmed et letirailleur algérien Ahmed Mechkam. Pour la partie commerciale, Wehrlin a sous ses ordres Huntzbuchler et Félix Tréhot, qui avait déjà participé au premier voyage dans l’ Adamaoua.

 Le 29 septembre 1892 commence la remontée du Niger. Les deux navires atteignent Lukodja le 11 octobre 1892. Le 13 septembre, ils s’engagent sur la Bénoué .
Le 29 septembre 1892 commence la remontée du Niger. Les deux navires atteignent Lukodja le 11 octobre 1892. Le 13 septembre, ils s’engagent sur la Bénoué .
Le 25 octobre, après plusieurs échouages, le Sergent-Malamine résiste à toute tentative de remise à flot. L’expédition est condamnée à attendre la remontée des eaux, pendant les neuf mois que dure la saison sèche.
L’échouage s’est produit devant le village de Chirou, sur le territoire du sultan du Mouri, Mohamed-ben-Abn-Boubakar, qui accueille l’expédition avec chaleur. Il requiert son aide pour venir à bout de la tribu des Koâna qui entrave les échanges commerciaux empruntant la route de Kano à Baoutchi, Mouri, Tchomo, Gachka où les caravanes se divisent pour aller à Banyo, Tibati ou Ngaoubdéré.
Après une tentative improductive de conciliation auprès des Koâna, le lieutenant Mizon décide d’épauler le sultan du Mouri. Fin décembre 1892, les Koâna font leur soumission au sultan du Mouri.
À la fin du mois de février 1893, c’est l’émouvante rencontre des membres de la missionMaistre, en route vers la France après un long et fructueux périple dans la région du Congo.
Le territoire des Comores devient le 27 octobre 1946 un territoire d'outre-mer (TOM) administrativement détaché de Madagascar.
Le lieutenant de vaisseau MIZON vient de mourir en mer 43 ans tandis il se rendait de Mayotte Djibouti où il venait être nommé résident fin mars Mizon qui fut notre collaborateur nos lecteurs se rappellent ses intéressantes études sur les Royaumes Foulbès du Soudan Central est un des hommes qui avec BRAZZA et CRAMPEL ont joué le rôle initiateurs dans le réseau explorations qui vient aboutir occupation de Afrique Occidentale
On pas oublié son premier voyage de 1890-1892 sa navigation sur la Bénoué Yola malgré les obstacles multiples que lui opposaient les agents de la Compagnie du Niger son traité avec le sullan Zoubir et son retour par Ngaoundéré et la Kadéi affluent de la Sangha où il rencontra Brazza venu sa rencontre La sur prise et admiration furent on en souvient universelles en France Mizon devint subitement célèbre Depuis lors énergique voyageur pas cessé de se consacrer expansion française en Afrique On pas su malheureusement tirer tout le parti possible de ses travaux ni lui prêter une aide suffisante Son deuxième voyage en 1893 destiné établir des relations commerciales avec Adamaoua aboutit un échec et en -1894 le traité franco-allemand en cédant Adamaoua Allemagne consacra abandon de uvre politique de Mizon Ses derniers travaux ont consisté orga niser escale de Majunga Rendons hommage un de ceux qui ayant été en Afrique parmi les ouvriers de la première heure en va heure où uvre paraît définitivement affermi


De 1880 à 1882, Mizon collabore avec Pierre Savorgnan de Brazza et Jean-Noël Savelli au Congo. Puis il retourna travailler dans l'armée jusqu'en 1890 .
Le René Caillé mouilla sur le fleuve et on attendit. Mais à la fin de la nuit du 15 au 16 octobre, la petite expédition française fut assaillie par les Patanis. Le combat fut bref mais brutal. Mizon en a laissé le récit. Sept Patanis furent tués, de blessés. L'interprète arabe, Miloud Mohamed était gravement atteint de coups de sabres. Mizon avait reçu deux balles ; une dans le bras, une dans la cuisse et ses Laptots étaient tous plus ou moins touchés. Si les Patanis avaient battu en retraite, la zone restait dangereuse et la journée fut employée à s'éloigner et à donner des soins aux blessés. Le surlendemain de l'attaque, l'administrateur anglais du district de Ouaré qui semble avoir été vite informé, se présentait sur un navire de la R. N. C, prenait le René Caillé en remorque et redescendait l'expédition à Agbéri. La chaloupe et le de Mizon y furent confisqués. De là, Mizon et les blessés partirent le 18 octobre sur le Kouka, jusqu'à Akassa où se trouvait l'agent général de la R. N. C, Flint et y arrivèrent le 19 octobre.
Le René Caillé mouilla sur le fleuve et on attendit. Mais à la fin de la nuit du 15 au 16 octobre, la petite expédition française fut assaillie par les Patanis. Le combat fut bref mais brutal. Mizon en a laissé le récit. Sept Patanis furent tués, de blessés. L'interprète arabe, Miloud Mohamed était gravement atteint de coups de sabres. Mizon avait reçu deux balles ; une dans le bras, une dans la cuisse et ses Laptots étaient tous plus ou moins touchés. Si les Patanis avaient battu en retraite, la zone restait dangereuse et la journée fut employée à s'éloigner et à donner des soins aux blessés. Le surlendemain de l'attaque, l'administrateur anglais du district de Ouaré qui semble avoir été vite informé, se présentait sur un navire de la R. N. C, prenait le René Caillé en remorque et redescendait l'expédition à Agbéri. La chaloupe et le de Mizon y furent confisqués. De là, Mizon et les blessés partirent le 18 octobre sur le Kouka, jusqu'à Akassa où se trouvait l'agent général de la R. N. C, Flint et y arrivèrent le 19 octobre.
10 août 1892, les membres de la seconde mission Mizon embarquent à Pauillac, à bord de la Ville-de-Céréa. La mission scientifique comprend, outre Mizon, l’enseigne de vaisseau Bretonnet, Albert Nebout, l’adjudant Chabredier, du 12e régiment d'infanterie, le chérif El-Hadj-Mahmed et letirailleur algérien Ahmed Mechkam. Pour la partie commerciale, Wehrlin a sous ses ordres Huntzbuchler et Félix Tréhot, qui avait déjà participé au premier voyage dans l’ Adamaoua.
L’expédition comprend en outre le second-maître mécanicien Varé, le quartier-maître mécanicien Lambelin, le quartier-maître de manœuvre Jégou, le quartier-maître charpentier Camard, un mécanicien supplémentaire (civil), Henri Vaughan, et le docteur Ward qui a demandé à profiter de l’expédition pour enrichir ses collections d’histoire naturelle.
Le 21 août, l’expédition est à Dakar où elle s’adjoint dix-huit tirailleurs et quatre laptots .
Le 21 août, l’expédition est à Dakar où elle s’adjoint dix-huit tirailleurs et quatre laptots .

Arrivée le 3 septembre à Cotonou l'expédition embarque sur le sergent-Malamine alors qu'une partie du matériel est embarqué sur la Mosca
 Le 29 septembre 1892 commence la remontée du Niger. Les deux navires atteignent Lukodja le 11 octobre 1892. Le 13 septembre, ils s’engagent sur la Bénoué .
Le 29 septembre 1892 commence la remontée du Niger. Les deux navires atteignent Lukodja le 11 octobre 1892. Le 13 septembre, ils s’engagent sur la Bénoué .Le 25 octobre, après plusieurs échouages, le Sergent-Malamine résiste à toute tentative de remise à flot. L’expédition est condamnée à attendre la remontée des eaux, pendant les neuf mois que dure la saison sèche.
L’échouage s’est produit devant le village de Chirou, sur le territoire du sultan du Mouri, Mohamed-ben-Abn-Boubakar, qui accueille l’expédition avec chaleur. Il requiert son aide pour venir à bout de la tribu des Koâna qui entrave les échanges commerciaux empruntant la route de Kano à Baoutchi, Mouri, Tchomo, Gachka où les caravanes se divisent pour aller à Banyo, Tibati ou Ngaoubdéré.
Après une tentative improductive de conciliation auprès des Koâna, le lieutenant Mizon décide d’épauler le sultan du Mouri. Fin décembre 1892, les Koâna font leur soumission au sultan du Mouri.
À la fin du mois de février 1893, c’est l’émouvante rencontre des membres de la missionMaistre, en route vers la France après un long et fructueux périple dans la région du Congo.
Tombe de Mizon - photo JM Bergougniou
Au cours du mois de mars, la factorerie de Ménardville (appelée ainsi en souvenir du capitaine Ménard, mort au Soudan) commence à être installée. Après des débuts commerciaux prometteurs, il s’avère que les habitants, insoumis, du village de Deulti, situé sur un contrefort des montagnes séparant le Mouri du Bachama, a fermé la route de ce pays. Les marchands empruntant cet itinéraire sont invariablement pillés.
Au cours du mois de mars, la factorerie de Ménardville (appelée ainsi en souvenir du capitaine Ménard, mort au Soudan) commence à être installée. Après des débuts commerciaux prometteurs, il s’avère que les habitants, insoumis, du village de Deulti, situé sur un contrefort des montagnes séparant le Mouri du Bachama, a fermé la route de ce pays. Les marchands empruntant cet itinéraire sont invariablement pillés.
Le sultan du Mouri confirme l’insoumission irréductible de ce village. Et le 15 mai, une expédition se met en route vers Deulti. Le 18, après d’âpres combats, Deulti est réduite.
Le 2 juin 1893, retour à Chirou. La pluie a fait sa réapparition. Dans la nuit du 12 au 13 juillet, une pluie diluvienne produit une crue très forte ; en douze heures, l’eau monte de 30 centimètres ; le Sergent-Malamine flotte enfin.
Après une escale à Ménardville, les deux navires poursuivent leur remontée de la Bénoué vers Yola, atteinte le 19 août. Le 22 septembre 1893, dans un climat de tension avec Anglais et Allemands, la mission française redescend la Bénoué et s’embarque, le 12 octobre à Cotonou, à bord du Liban en partance pour Marseille.
Ensuite, il devint résident à Madagascar , puis administrateur-supérieur (subordonné au Gouverneur général de Madagascar) à Mayotte du 5 août 1897 au 11 mars 1899
Le 2 juin 1893, retour à Chirou. La pluie a fait sa réapparition. Dans la nuit du 12 au 13 juillet, une pluie diluvienne produit une crue très forte ; en douze heures, l’eau monte de 30 centimètres ; le Sergent-Malamine flotte enfin.
Après une escale à Ménardville, les deux navires poursuivent leur remontée de la Bénoué vers Yola, atteinte le 19 août. Le 22 septembre 1893, dans un climat de tension avec Anglais et Allemands, la mission française redescend la Bénoué et s’embarque, le 12 octobre à Cotonou, à bord du Liban en partance pour Marseille.
Ensuite, il devint résident à Madagascar , puis administrateur-supérieur (subordonné au Gouverneur général de Madagascar) à Mayotte du 5 août 1897 au 11 mars 1899
Le 7 mars 1899, il est nommé gouverneur de Djibouti . Cependant, le 11 mars 1899 à 9 heures du soir, dans l'océan indien, Antoine Mizon se suicide d'un coup de fusil en pleine tête, à l'âge de 45 ans. Les raisons de son geste ne semblent pas connues
Sources
BNF-Gallica
https://www.persee.fr/docAsPDF/outre_0399-1385_1954_num_41_143_1210.pdf
Le voyage du commandant Mizon. In: Manuel général de l'instruction primaire : journal hebdomadaire des instituteurs. 59e année, tome 28, 1892. pp. 274-276;
https://education.persee.fr/docAsPDF/magen_1257-5593_1892_num_59_28_49630.pdf
http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_mizon_louis.htm