Aviation Maritime en Algérie - Djidjeli 1918 - convoi - Guerre aux sous-marins
Comme nous l'avons vu dans les articles précédents concernant l'Aviation Maritime, l'activité de la Marine et des ses hydravions est limitée au début de la guerre par le nombre d'appareils et le nombre de pilotes -
Huit appareils de fabrications différentes, onze pilotes et un navire transporteur d’hydravions. Les choses évolueront vite, à la fin de la guerre l'Aviation maritime aura 702 pilotes et 1264 appareils.
 |
| Bases de l'Aviation Maritime en Afrique du Nord en 1918 - source ARDHAN |
A partir de 1917, devant l’accroissement considérable de la force sous-marine allemande, l’Aviation maritime se développe. L’organisation territoriale côtière comprend les secteurs partagés en 1916 en divisions de patrouilles aériennes.
 |
| Djidjeli |
 |
| Arzew Aviation Maritime |
Le 10 novembre 1916, la décision est prise de créer le centre d’aviation du port d’Alger, près de l’usine électrique, dans un étroit plan d’eau entre le quai de Sète, sur le Grand Môle, et le quai de Caen.
Les patrouilles aériennes d’Algérie-Tunisie dépendant du secteur de la Méditerranée, comportent d’ouest en est le centre d’Oran (dont dépendent les postes de combat de Nemours et Mostaganem, le centre d’ Arzew, poste de combat : Cherchell, le centre d’Alger, postes de combat : Ténès et Bougie, le centre de Djidjelli, le centre de Bône, postes de combat : Collo, le centre de Bizerte, postes de combat : Tabarka et Kélibia ; le centre de Sousse, postes de combat : Sfax et Lampedusa et le centre de Marsala.
Les postes de combat (également dénommés postes de relâche lorsqu’ils sont utilisés de façon temporaire) sont généralement équipés d’un hangar Bessonneau et d’un mât de mise à l’eau. L’activité des postes de relâche est assez irrégulière, elle dépend du passage des convois et des difficultés de mise en oeuvre qui demandent quelquefois des pilotes habiles. D’une manière générale, l’effectif complet des centres et des postes ne sera jamais atteint. Il n’y aura jamais guère plus de dix hydravions opérationnels à Alger et à Bône et deux à quatre à Cherchell, Ténès, Bougie et Djidjelli.
Des postes de combat provisoires, comme Béni-Saf, sont quelques fois activés. Le capitaine de vaisseau Favereau commande les patrouilles aériennes d’Algérie-Tunisie, suivi par le capitaine de frégate de Poyen Degrenand, le 10 mai 1917.
Les principales missions de l’Aviation maritime sont la surveillance des routes d’accès aux ports, l’escorte et l’éclairage des convois, reconnaissance, la recherche des mines et l’attaque des sous-marins. Des chalutiers et des «vedettes canadiennes» suivent les convois et secourent éventuellement les hydravions en panne. Ces petites embarcations sont chargées de la neutralisation des mines après qu’elles aient été repérées par les hydravions et marquées par des bouées à phosphore. La protection des convois à l’intérieur des ports échoit principalement aux ballons captifs, des Caquot type P de 930 m3 pour 25 m de long, chargés de détecter les mines.
 |
| Le courrier par lequel l'EV1 Marinier donne des informations sur son affectation et sur ses appareils |
A partir de novembre 1917, le centre d’Alger est agrandi afin de pouvoir abriter vingt-quatre hydravions (au lieu de douze) et neuf pilotes. Les hydravions arrivent en caisse à Bizerte où ils sont assemblés.
Sources:
Collections JMBL’AVIATION MILITAIRE EN ALGERIE (1912-1918) - Pierre Jarrige
ARDHAN

















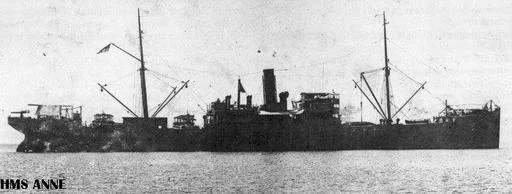
















 La Côte en est cependant peu favorable à cause du phénomène marin particulier à ces régions la barre qui route les flots en volutes et sans trêve les rejette avec fracas au rivage, les brise et les étale en nappes dentelées qui scintillent au soleil. Pour faciliter le débarquement, de grands wharfs sont jetés en pleine mer à Grand-Bassam et à Port-Bouët qui, sur le rivale même, forment de grands centres de transit.
La Côte en est cependant peu favorable à cause du phénomène marin particulier à ces régions la barre qui route les flots en volutes et sans trêve les rejette avec fracas au rivage, les brise et les étale en nappes dentelées qui scintillent au soleil. Pour faciliter le débarquement, de grands wharfs sont jetés en pleine mer à Grand-Bassam et à Port-Bouët qui, sur le rivale même, forment de grands centres de transit.
















