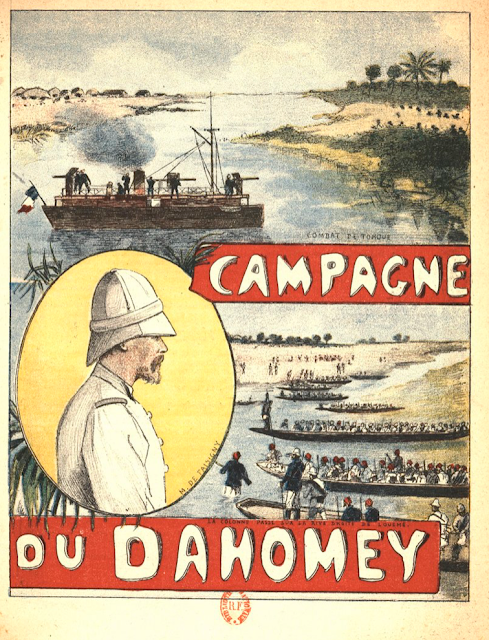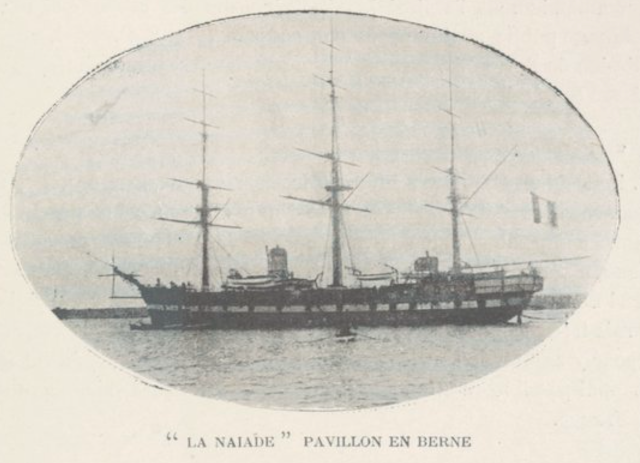FDA FORBIN la FDA fête ses 20 ans
 La frégate Forbin est une frégate de défense aérienne, navire-jumeau du Chevalier Paul de la classe Horizon de la Marine nationale, qui a été mise en service en 2010. Ce type de navire a pour principale mission l'escorte et la protection d'un groupe aéronaval constitué autour d'un porte-avions, généralement le Charles-de-Gaulle de la marine nationale ou l'un des porte-avions de l'US Navy ou d'une opération amphibie menée par des bâtiments de projection et de commandement.
La frégate Forbin est une frégate de défense aérienne, navire-jumeau du Chevalier Paul de la classe Horizon de la Marine nationale, qui a été mise en service en 2010. Ce type de navire a pour principale mission l'escorte et la protection d'un groupe aéronaval constitué autour d'un porte-avions, généralement le Charles-de-Gaulle de la marine nationale ou l'un des porte-avions de l'US Navy ou d'une opération amphibie menée par des bâtiments de projection et de commandement.  |
| FDA Forbin photo JM Bergougniou |
 |
| FDA Chevalier Paul - FDA Forbin photo JM Bergougniou |
Souvenirs de guerre

Par deux fois le « Forbin » allait y connaître l'ivresse d'une victoire totale.
LE FORBIN COULE TROIS SOUS-MARINS DE POCHE

Personne à bord ne voulait alors admettre que le sous- marin attaqué en février au large d'Ajaccio ait eu une chance de s'échapper. On ne parlait plus de cette affaire, mais chacun y pensait et attendait quelque chose. Cela vint brutalement à l'aube du 26 septembre 1944 et ce fut une revanche éclatante.

Comme d'habitude, officiers et équipage avaient passé la nuit aux postes d'alerte : une bordée de quart, l'autre au repos, à proximité immédiate des postes de combat, prête à bondir. Depuis l'appareillage de Saint-Tropez où, venant d'Oran, on avait ravitaillé en mazout le 24 septembre, personne n'avait couché dans les chambres ou les postes, personne ne s'était lavé.
En compagnie du destroyer américain « Madison », le « Forbin » avait, le 25, effectué des tirs contre la terre et coulé une mine dérivante, il avait patrouillé toute la nuit, faisant des lacets.
Le 26, un jour grisâtre se lève ; le « Forbin » vient de quitter la zone de patrouille de nuit et fait route, en se rapprochant de terre, pour gagner la zone de bombardement.

Tout à coup à 6 h 35, un veilleur de la passerelle supérieure crie : « Un mât sort de l'eau - gisement 40 », et presque aussitôt : « Le mât a disparu ». Pas de doute, c'est un périscope. Une question se pose : le sous-marin a-t-il lancé ? Le commandant a immédiatement réagi. Les rugissements du klaxon d'alerte rassemblent tout le monde aux postes de combat. Deux minutes après, l'asdic obtient un écho et le conserve malgré les manœuvres de dérobement et d'attaque.
 |
| USS Madison |
Dix minutes plus tard - à 6 h 45 - le « Forbin », qui est monté à 18 nœuds, lâche dix grenades à la position présumée du sous-marin. Sans doute est-il touché mais le contact est perdu ; il faut le retrouver. Un passage à l'endroit du grenadage ne donne pas de résultat et, le cœur gonflé d'espoir, on entame en diminuant la vitesse la procédure classique de la recherche en carré. Les minutes paraissent longues. Le lieutenant de vaisseau écouteur a pris le casque dans la cabine de l'asdic ; l'officier de manœuvre tient, penché sur la table à cartes, le graphique des routes ; en haut, l'officier de tir espère que l'on fera surgir de l'eau un but pour ses canons ; à l'arrière l'équipe des grenadeurs s'affaire à préparer un nouveau lancement.
A 7 h 29, alors que l'inquiétude commence à poindre, l'asdic croche l'écho tant désiré. Le « Forbin » augmente aussitôt de vitesse pour une nouvelle attaque. Une torpille manque de peu le bâtiment : dans cette aventure, on ne sait trop qui est gibier ou chasseur. A 7 h 33 le « Forbin » lance huit grenades. Deux minutes plus tard un périscope est aperçu sur l'arrière ; le bâtiment amorce une giration pour s'en rapprocher.
Cependant l'asdic a un écho dans une autre direction. Diable il n'y a pas qu'un seul sous-marin. A 7 h 49, un chapelet de dix grenades est lancé sur ce nouveau but. Et les événements se précipitent. Le canon de 40 et les 20 de l'arrière ouvrent un feu d'enfer sur les superstructures d'un sous-marin qui trouent la surface. Un homme se tient au massif du périscope et fait des gestes. Le commandant ordonne aussitôt de cesser le feu. Le sous-marin disparaît, cependant qu'à nouveau un sillage de torpille passe sur l'arrière du « Forbin ».
Au milieu d'épaves et de débris, le torpilleur repêche un premier maître allemand, commandant de sous-marin de poche armé par deux hommes ; son camarade a coulé avec le sous-marin avarié par l'explosion d'une grenade. De son côté le « Madison » recueille deux prisonniers. Mais il faut bientôt abandonner cette zone pour effectuer un tir sur des concentrations de troupes ennemies.
Le reste de la journée est occupé par d'autres interventions au profit des camarades qui se battent à terre on tire sur la voie ferrée, sur des batteries. Cela empêche le « Forbin » de récupérer un quatrième rescapé qui s'efforce de regagner la côte sur un radeau pneumatique.
sources
Cols bleus
Marine nationale