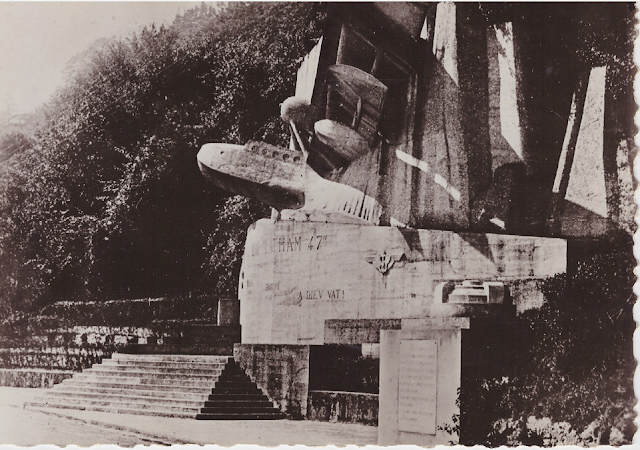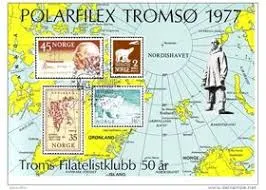L 'ARMISTICE EST SIGNE
Vive la France!
Il est midi.
Depuis une heure ou deux, la bonne, la joyeuse nouvelle s'est répandue. C'est d'abord un bruit qui court, léger comme !'espérance. Puis, il s'affermit. Rien d'officiel encore, mais tous les visages rayonnent et l'on croise, dans les rues, des gens pressés qui rentrent chez eux avec des drapeaux tout neufs.
Et soudain, voici les cloches .
Leur voix n'a plus le même accent, (Ce n'est pas, comme écrivait l'héroïque Péguy dans son admirable Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, ce « son lointain des cloches calmes » qui berçaient, au temps de la grande pitié », la prière suppliante de la Sainte de la Patrie c'est quelque chose de beaucoup plus fort et de triomphal. La voix de bronze vibre dans l'air pur comme un prélude des magnificences du Te Deum, et son allégresse fleurit aussitôt des trois couleurs enfin victorieuses toutes les fenêtres des maisons.
Ah ! Sonnez, cloches de France Sonnez sur nos villes et nos campagnes Sonnez cloches fidèles, voix de Dieu et voix du peuple, messagères de tout ce qui est grand dans nos joies ou nos douleurs. Sonnez, non plus a coups rapides, comme au jour tragique, où votre tocsin nous ralliait pour des sacrifices sanglants, mais a larges coups profonds dont l'harmonie de gloire et le bonheur va déferler partout sur le libre sol gaulois et partout faire éclater l'enthousiasme de la Grande Revanche
Ô morts sacrés de la douce France, grands morts chéris dont les os sont dispersés sur tous les fronts de l'immense mêlée, morts de Morhange et de Charleroi, de la Marne et de la Somme. de la Champagne. de l'Artois, des Flandres et de la Picardie morts de Verdun, morts des DardaneJles, morts de Macédoine, soldats sublimes, marins stoïques ensevelis dans l'abîme avec vos pavillons, c'est vers vous d'abord que se tournent nos âmes car nous savons bien que notre délivrance est faite de votre oblation magnanime nous savons bien que la victoire de la Patrie, c'est vous qui l'avez faite, ô morts vénérés, quand aux heures les plus sombres, et sous un ciel fermé d'où ne filtrait aucune lueur d'espoir, vous jetiez, malgré tout, votre cri suprême d'amour et de foi « Vive la France ».
Une lettre du Président de la République à M. Clemenceau
Paris, Il novembre. Le président de la République a adressé à M. G. Clemenceau la lettre suivante
Mon cher Président,
Au moment où s'achève, par la capitulation de l'ennemi. la longue série dc victoires auxquelles votre patriotique énergie a si largement contribué, laissez-moi vous adresser à vous-même et vous prier aussi de transmettre AU MARECHAL FOCH, commandant en chef des armées alliées
AU GENERAI. PETAIN, commandant en chef de l'armée française
A TOUS LES GENERAUX, OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
l'expression de ma reconnaissance et de mon admiration.
Depuis le 15 juillet. la France a suivi atvec une émotion haletante les éclatants succès quotidiens qu'ont remportés les armées alliées et qui ont même précipité la retraite de l'armée allemande.
Les populations captives ont été rendues à la liberté.
L'ennemi, déconcerté, a laissé derrière lui des quantités énormes d'armes et de matériel, et le bilan des prises dépasse le chiffre le plus élevé qu'ait jamais connu l'histoire.
Ce matin fut signé un armistice qui délivre l'Alsace-Lorraine et qui permet aux armées alliées d'occuper, cn garantie des droits à exercer, une vaste zone du territoire allemand.
A ces heures de joie et de fierté nationales. ma pensée se reporte successivement vers les héros qui, dans l'enthousiasme du départ, sont tombés sur les champs de bataille de Namur et de Charleroi, vers ceux qui, sur les rives de la Marne, ont victorieusement arrêté et refoulé l'invasion, vers ceux qui, dans les lentes et dures journées de la guerre le tranchées, ont montré une si confiante opiniâtreté, vers les intrépides défenseurs de Verdun, vers les soldats de Yser, de laSomme de l'Aisne de la Champagne, des Vosges, vers ceux qui ont donné leur vie, à la patrie, vers ceux que leurs blessures ont rendus invalides, vers tous ceux qui aujourd'hui encore sous les armes sont maintenant récompensés de leurs infatigables efforts et de leur bravoure indomptable...
Ils ont tous été des ouvriers de la victoire finale. Ils ont tous apporté leur port au magnifique arc de triomphe sous lequel passeront bientôt les vainqueurs.
J'envoie aux morts un souvenir respectueux et attendri.
Je vous prie de Vouloir bien communiquer aux vivant les félicitations qu'au nom de la France, je leur adresse du fond du cœur, R. Poincaré