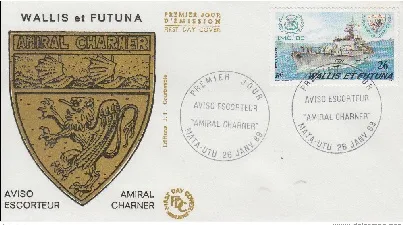Blocus de l'Adriatique Cattaro 1914 Amiral Grellier
Nous venons de consacrer un article sur l'hôpital maritime de Corfou (l'Achilleion), nous allons l'évoquer aujourd'hui par le décès de l'amiral Jean Grellier en août 1918 alors qu'il était en service sur le cuirassé Provence.
Né le 25 août 1867 à Lauzun (Lot-et-Garone) - Décédé le 2 août 1918 à l'Hôpital de l'Achilleïon à CORFOU.
Jean Grellier entre dans la Marine en 1884, il suit le cursus habituel; Aspirant le 5 octobre 1887; Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1889.
Aux 1er janvier 1892, 1894, sur l'aviso "ALOUETTE" puis Second, Station locale de l'ANNAM et du TONKIN (Cdts Edgard RATOMSKI puis Émile VEDEL).
Lieutenant de vaisseau le 27 janvier 1894; Au 1er janvier 1896, port ROCHEFORT; Au 1er janvier 1897, Officier-Élève sur l'ALGÉSIRAS, École des torpilles.
Officier breveté torpilleur.
Au 1er janvier 1899, sur le croiseur "PASCAL", Division navale de l'Extrême-Orient (Cdt Charles MOTET).
Le 8 octobre 1899, Commandant un torpilleur de la Défense mobile du 2ème arrondissement maritime à BREST.
Chevalier de la Légion d'Honneur le 24 décembre 1899.
Au 1er janvier 1901, Officier stagiaire sur le "COURONNE", École de canonnage (Cdt Jules KRANTZ).
Officier breveté Canonnier.

Aux 1er janvier 1902, 1903, sur le cuirassé "CHARLEMAGNE", Escadre de Méditerranée (Cdt Paul CHOCHEPRAT).
Au 1er janvier 1904, Archiviste sur le "COURONNE", École de canonnage (Cdt Charles MOTET).
Le 16 mars 1905, Commandant la canonnière "OLRY", Escadre d'Extrême-Orient.
Au 1er janvier 1908, en service à terre, Professeur à l'École des Officiers canonniers à TOULON. Capitaine de frégate le 12 octobre 1908.
Au 1er janvier 1909, port TOULON.
Au 1er janvier 1911, sur le cuirassé "PATRIE", Adjoint au Chef d'État-Major pour le service de l'Artillerie auprès du Vice-amiral Jean BELLUE, Commandant en chef la 1ère Escadre.
Le 15 mars 1912, en mission hydrographique, Commandant l'aviso-transport "VAUCLUSE" et la Marine à MADAGASCAR. Idem au 1er janvier 1914.
En 1914, Chef de la mission française au MONTÉNÉGRO, il est cité à l'ordre de l'Armée navale : "Chef de la mission française au Monténégro. Pour les services qu'il a rendus dans l'organisation de la mission et dans l'utilisation du matériel de guerre mis à sa disposition." et promu Officier de la Légion d'Honneur le 2 décembre.
Capitaine de vaisseau le 27 avril 1915.
En mai, sur le cuirassé "PATRIE", Chef d'État-Major auprès du Vice-amiral Ernest NICOL, Commandant en chef l'Escadre des Dardanelles.
De janvier à mars 1917, Commandant le cuirassé "DÉMOCRATIE".
Croix de Guerre.
Au 1er janvier 1918, port TOULON
 |
| Carte postale serbe |
Nommé Contre-amiral, en service sur le cuirassé "PROVENCE", il décède le 2 août 1918 des suites de troubles cardiaques (asystolie) à l'Hôpital de l'Achilleïon.
La Mission au Monténégro
Le ministère de la marine s'interrogea sur le moyen de tenir un blocus de l'Adriatique, rendu possible par la neutralité italienne. L'amiral Boué de Lapeyrère qui avait été chargé de faire un rapport sur la stratégie navale à appliquer en Méditerranée préconisait ceci: "pour tenir le blocus de l'Adriatique, il n'y a que deux solutions: s'installer dans une baie des îles ioniennes appartenant à la Grèce ou s'emparer d'une base ennemie" .
 |
| Kotor ou Cattaro |
Dans le même temps, le roi du Monténégro proposait au gouvernement français la conquête de la base la plus méridionale de l'Autriche; Cattaro, en coordination avec la flotte et les troupes françaises.
Le ministère opta donc pour la seconde solution. À cet effet la France envoya donc 8 canons et 140 marins sous les ordres du capitaine de frégate Grellier.
En septembre 1914, le capitaine de frégate Grellier débarqua à Antivari (Montenegro) avec un détachement de canonniers marins
Le manque de moyen et de stratégie conduira cette expérience à l'échec, malgré des débuts prometteurs. Les canons ne purent rien contre les fortifications tandis que les navires étaient hors de portée. La poudre noire utilisée par ces vieux canons les rendit vulnérables (au 27 octobre déjà deux pièces détruites et 21 morts).
Les conditions climatiques sur le mont Lovtchen à plus de 1700m aidant, les effectifs déclinèrent rapidement et le 23 novembre 1914 les troupes françaises réembarquaient.
L'échec était retentissant et le journal italien "Corriere della Serra" parlait d'inaction de la flotte française qui permettait à l'Autriche-Hongrie de faire de l'Adriatique sa propriété.
 |
| Mont Lovtchen la chapelle |