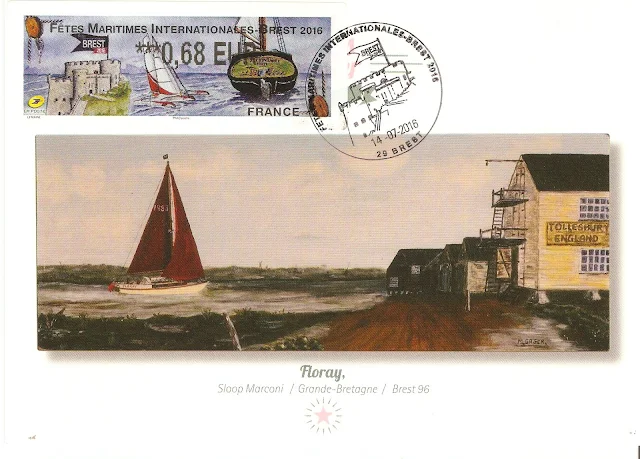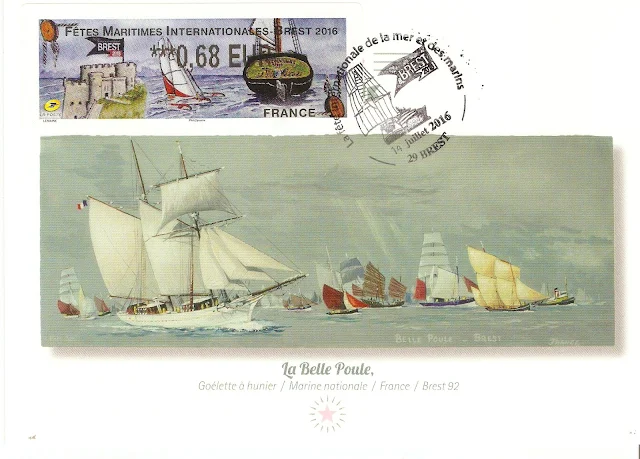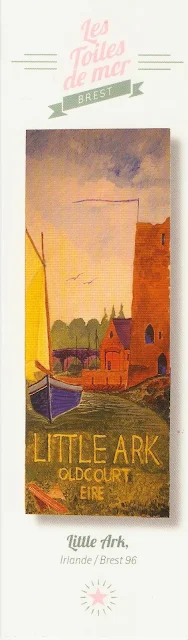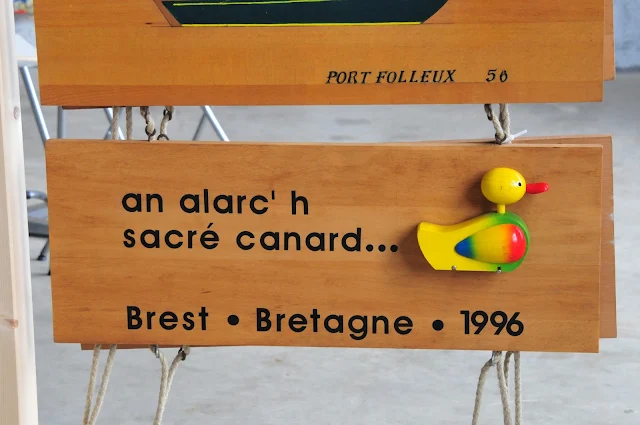cartophilie aéronautique navale aéronefs avions Rochefort ANAMAN
P2V7

Le Lockheed P-2 Neptune (P2V Neptune avant 1962) est un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine américain. Il fut utilisé par l'United States Navy entre 1947 et 1978 où il remplaça le PV-1 Ventura et le PV-2 Harpoon. Il fut lui-même remplacé par le Lockheed P-3 Orion.
Le gouvernement français fit l'acquisition auprès des Etats Unis de 33 Lockheed P2V-7 Neptune, livrés au titre des « Foreign Military Sales ». La totalité des Neptune sera livrée entre 1958 et 1961 et comprend les serials suivants : 144685 à 144692, 146431 à 146438, 147562 à 147571, 148330 à 148336.
Au terme d'un périple qui l'a mené de Norfolk (USA) en France, en passant par les Bermudes et les Açores, le premier appareil arrive à Lann Bihoué le 2 juin 1958. Il s'agit du numéro 146432 convoyé par l'EV Joubert et son équipage. Il devient lors de son intégration dans la flottille le 25F-2.
Aussitôt commence l'entraînement sur Neptune, tant pour les volants que pour le personnel au sol. Le 1er juillet 1958, la flottille fait des adieux émouvants à son dernier Lancaster, son premier appareil moderne de lutte anti-sous-marine. Grâce à un nouveau personnel judicieusement choisi (anciens membres des flottilles de P2V-6 et détachement de deux équipages de l'ERC) la flottille s'initie peu à peu aux secrets de son nouvel avion d'armes. La livraison progressive d'outillage spécial et de matériels de servitude n'empêcheront pas l’unique 25F-2 d'effectuer en deux semaines 342 tours de piste et 112 atterrissages.
L'un après l'autre, les avions sont affectés à la flottille, du second le 21 août, au huitième et dernier le 14 octobre. C'est à cette date que la 25F peut reprendre l'alerte SAR (Search And Rescue) avec les premiers équipages formés.
Octobre 1962 voit la naissance en juillet du GAN 7 (Groupement Aéronaval) réunissant sous sa tutelle les trois flottilles de P2V7 de Lann Bihoué (23F, 24F, 25F). Un GAN 6 est crée à Nimes-Garons pour les flottilles équipées de P2V6 (21F, 22F). Le GAN 7, alors commandé par le CC Barthélémy, est chargé d'organiser et d'uniformiser les procédures d'entraînement, de veiller à l'application des règles de sécurité et d'analyser les résultats des exercices.
L'un après l'autre, les avions sont affectés à la flottille, du second le 21 août, au huitième et dernier le 14 octobre. C'est à cette date que la 25F peut reprendre l'alerte SAR (Search And Rescue) avec les premiers équipages formés.
La flottille se déplace à nouveau Lartigue en janvier et février 1961, Kinloss en novembre et Montijo en décembre.... La suite sur :
BREGUET 1050 ALIZE

Le Breguet Alizé, avion embarqué de sûreté, fut construit à la suite d'une demande de la Marine nationale dans les années 50. Prévu pour être un monoplace d'attaque équipé d'un système de propulsion combinant turboréacteur et turbopropulseur, il devint un triplace avec un seul turbopropulseur plus puissant, un radar de recherche maritime repoussant le moteur dans la partie arrière du fuselage.
Construit en 75 exemplaires pour la Marine et entré en service en 1959, le Breguet Alizé à, au fil du temps, vue ses missions evoluer. Conçu à l'origine pour l'offensive anti-sous-marine, l'appareil s'est consacré par la suite principalement à la détection aérienne et de surface. L'avion entra, à la fin des années 50, en service dans trois flottilles.
BREGUET 1050 ALIZE

Le Breguet Alizé, avion embarqué de sûreté, fut construit à la suite d'une demande de la Marine nationale dans les années 50. Prévu pour être un monoplace d'attaque équipé d'un système de propulsion combinant turboréacteur et turbopropulseur, il devint un triplace avec un seul turbopropulseur plus puissant, un radar de recherche maritime repoussant le moteur dans la partie arrière du fuselage.
Construit en 75 exemplaires pour la Marine et entré en service en 1959, le Breguet Alizé à, au fil du temps, vue ses missions evoluer. Conçu à l'origine pour l'offensive anti-sous-marine, l'appareil s'est consacré par la suite principalement à la détection aérienne et de surface. L'avion entra, à la fin des années 50, en service dans trois flottilles.
Au 1er janvier 2000 : 7 appareils étaient encore en ligne au sein de la 6F basé à Nimes-Garons.
Un programme de modernisation en 1980 mit en oeuvre le radar Iguane, plus efficace, le système de navigation Omega Equinox, un nouveau système de communication et un équipement de guerre électronique. De récentes modifications dans les années 90 améliorèrent encore les communications et apportèrent de meilleures capacités de brouillage et d'autres améliorations lui permettant de prolonger une activité largement étendue.
Avec l'arrivée de l'E2C Hawkeye, l'Alizé a été retiré du service actif au mois de septembre 2000. La cérémonie d'adieu à l'Alizé a eu lieu à BAN Nîmes Garons le vendredi 15 septembre 2000.
La flottille 4F est la descendante directe de l'aviation d'escadre née en 1918 et de flottille du Béarn. La 4F inscrit ses premières heures de gloire dans le sang avec le sacrifice de ses équipages pendant la bataille de France en 1940. Elle est ensuite de toutes les campagnes comme l'indique l'engagement de son personnel sur les théâtres de Hollande, d'Italie, de Gibraltar, d'Algérie, du Maroc, de Syrie, de la libération de la France en 1940-45 et d'Indochine en 1947-48. Elle est transformée sur TBM Avenger en 1950.
Dotée d'Alizé à partir de 1960, elle participera aux déploiements Saphir, Olifan, Prométhée, Salamandre et Balbuzard, dans lesquelles les groupes aériens des porte-avions Clemenceau et Foch ont été engagés. Du ponton expérimentalBapaume aux Béarn, Dixmude, La Fayette, Bois Belleau, Arromanches, Clemenceau et Foch, la 4F aura embarqué sur tous les porte-avions de la Marine nationale. Son fanion porte la croix de guerre 1939-45 avec 7 citations, et la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec palmes et 3 citations.
En 1997, la 4F avait été mise en sommeil. La Formation "Avions de Guet Embarqué" (FAGE) est créée et détachée aux Etats-Unis en vue d'acquérir une compétence technique et aéronautique sur E2C Hawkeye. Cette période américaine s'est terminée par la qualification à l'appontage de jour comme de nuit à bord du porte-avions USS John F.Kennedy.
La flottille 6F était stationnée à Nîmes Garons et armée d'avions de sûreté Breguet Alizé BR 1050 qui embarquaient sur les porte-avions Arromanches, Foch et Clemenceau.
La flottille 6F a été dissoute le 15 septembre 2000 au cours d'une cérémonie sur la BAN Nîmes-Garons présidée par le CA Louis Dubessey de Contenson, Alavia, en présence notamment du VA (2S) Michel Mosneron Dupin, ancien Alpatmar et pilote d'essai de l'Alizé.
RAFALE M
 Entré en service en 2002, le Rafale Marine, aujourd'hui au standard F3, est l'avion de combat le plus moderne en service en France. Avion polyvalent avec une capacité d'intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, un outil adaptable destiné à une grande diversité de missions :
Entré en service en 2002, le Rafale Marine, aujourd'hui au standard F3, est l'avion de combat le plus moderne en service en France. Avion polyvalent avec une capacité d'intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, un outil adaptable destiné à une grande diversité de missions :
Grâce à la liberté des mers et à la mobilité conférées par un porte-avions, le Rafale Marinereprésente un outil majeur de projection de puissance. Sa plate-forme navale pouvant s’affranchir des frontières et parcourir jusqu’à 1000 km/j, elle lui permet d’agir en tout point du globe, sous faible préavis, en s’exonérant des contraintes diplomatiques ou géographiques.
La Marine nationale possède 40 Rafale Marine dont 28 en ligne.
Un programme de modernisation en 1980 mit en oeuvre le radar Iguane, plus efficace, le système de navigation Omega Equinox, un nouveau système de communication et un équipement de guerre électronique. De récentes modifications dans les années 90 améliorèrent encore les communications et apportèrent de meilleures capacités de brouillage et d'autres améliorations lui permettant de prolonger une activité largement étendue.
Avec l'arrivée de l'E2C Hawkeye, l'Alizé a été retiré du service actif au mois de septembre 2000. La cérémonie d'adieu à l'Alizé a eu lieu à BAN Nîmes Garons le vendredi 15 septembre 2000.
La flottille 4F est la descendante directe de l'aviation d'escadre née en 1918 et de flottille du Béarn. La 4F inscrit ses premières heures de gloire dans le sang avec le sacrifice de ses équipages pendant la bataille de France en 1940. Elle est ensuite de toutes les campagnes comme l'indique l'engagement de son personnel sur les théâtres de Hollande, d'Italie, de Gibraltar, d'Algérie, du Maroc, de Syrie, de la libération de la France en 1940-45 et d'Indochine en 1947-48. Elle est transformée sur TBM Avenger en 1950.
Dotée d'Alizé à partir de 1960, elle participera aux déploiements Saphir, Olifan, Prométhée, Salamandre et Balbuzard, dans lesquelles les groupes aériens des porte-avions Clemenceau et Foch ont été engagés. Du ponton expérimentalBapaume aux Béarn, Dixmude, La Fayette, Bois Belleau, Arromanches, Clemenceau et Foch, la 4F aura embarqué sur tous les porte-avions de la Marine nationale. Son fanion porte la croix de guerre 1939-45 avec 7 citations, et la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec palmes et 3 citations.
En 1997, la 4F avait été mise en sommeil. La Formation "Avions de Guet Embarqué" (FAGE) est créée et détachée aux Etats-Unis en vue d'acquérir une compétence technique et aéronautique sur E2C Hawkeye. Cette période américaine s'est terminée par la qualification à l'appontage de jour comme de nuit à bord du porte-avions USS John F.Kennedy.
La flottille 6F était stationnée à Nîmes Garons et armée d'avions de sûreté Breguet Alizé BR 1050 qui embarquaient sur les porte-avions Arromanches, Foch et Clemenceau.
La flottille 6F a été dissoute le 15 septembre 2000 au cours d'une cérémonie sur la BAN Nîmes-Garons présidée par le CA Louis Dubessey de Contenson, Alavia, en présence notamment du VA (2S) Michel Mosneron Dupin, ancien Alpatmar et pilote d'essai de l'Alizé.
RAFALE M
 Entré en service en 2002, le Rafale Marine, aujourd'hui au standard F3, est l'avion de combat le plus moderne en service en France. Avion polyvalent avec une capacité d'intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, un outil adaptable destiné à une grande diversité de missions :
Entré en service en 2002, le Rafale Marine, aujourd'hui au standard F3, est l'avion de combat le plus moderne en service en France. Avion polyvalent avec une capacité d'intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, un outil adaptable destiné à une grande diversité de missions :- défense et supériorité aérienne
- pénétration et attaque au sol par tous les temps
- capacité de ravitailleur
- attaque à la mer par tous temps et à distance de sécurité
- reconnaissance tactique et stratégique
- dissuasion nucléaire
Grâce à la liberté des mers et à la mobilité conférées par un porte-avions, le Rafale Marinereprésente un outil majeur de projection de puissance. Sa plate-forme navale pouvant s’affranchir des frontières et parcourir jusqu’à 1000 km/j, elle lui permet d’agir en tout point du globe, sous faible préavis, en s’exonérant des contraintes diplomatiques ou géographiques.
La Marine nationale possède 40 Rafale Marine dont 28 en ligne.
Le Rafale Marine au standard F3 a vécu son premier déploiement opérationnel lors de la mission Agapanthe 2010 puis lors de l’opération Harmattan au large de la Libye où, avec le Super Étendard modernisés de la flottille 17F, ils ont pleinement contribué à près de 1 400 missions de guerre, 4 000 heures de vol du Groupe aérien embarqué à bord du porte-avionsCharles de Gaulle.
Le 19 septembre 2011 la flottille 11F est passée sur Rafale Marine représentant ainsi un nouveau jalon de la montée en puissance du Rafale dans la Marine.
pour lire la suite :
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/aeronefs/rafale-marine
http://www.meretmarine.com/fr/content/44-rafale-marine-auront-ete-livres-fin-2015
décollage par mauvais temps
https://www.youtube.com/watch?v=rQPXFKmQA8U
ETENDARD IVP

En juillet 1955, la Marine nationale demande à Dassault d'étudier une version navalisée du Mystère XXII-01propulsée par deux SNECMAR-105 et il s'en faut de peu qu'elle ne commande un prototype. Cependant, séduite par les performances de l'Etendard IV, la Marine passe commande d'un prototype navalisé en décembre 1956 (contrat n°4410/56).
La conception de l'avion est confiée au bureau d'étude de Mérignac. L'appareil ressemble certes beaucoup à l'Etendard IV-Air mais, en fait, il s'agit d'une machine totalement nouvelle. La structure est renforcée pour recevoir plus de carburant et absorber les efforts d'appontage. Le fuselage abrite le nouveau réacteur SNECMA Atar 08, de 4400 kg de poussée qui offre une consommation spécifique inférieure de 7% par rapport au SNECMA 101E de 3500 kgp. Ce gain de poussée est obtenu par l'introduction d'un étage supplémentaire dans le compresseur et une augmentation des températures d'entrée de turbine. Enfin, le nouveau fuselage respecte la loi des aires ce qui lui confère la fameuse "taille de guêpe".
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/aeronefs/rafale-marine
http://www.meretmarine.com/fr/content/44-rafale-marine-auront-ete-livres-fin-2015
décollage par mauvais temps
https://www.youtube.com/watch?v=rQPXFKmQA8U
ETENDARD IVP

En juillet 1955, la Marine nationale demande à Dassault d'étudier une version navalisée du Mystère XXII-01propulsée par deux SNECMAR-105 et il s'en faut de peu qu'elle ne commande un prototype. Cependant, séduite par les performances de l'Etendard IV, la Marine passe commande d'un prototype navalisé en décembre 1956 (contrat n°4410/56).
La conception de l'avion est confiée au bureau d'étude de Mérignac. L'appareil ressemble certes beaucoup à l'Etendard IV-Air mais, en fait, il s'agit d'une machine totalement nouvelle. La structure est renforcée pour recevoir plus de carburant et absorber les efforts d'appontage. Le fuselage abrite le nouveau réacteur SNECMA Atar 08, de 4400 kg de poussée qui offre une consommation spécifique inférieure de 7% par rapport au SNECMA 101E de 3500 kgp. Ce gain de poussée est obtenu par l'introduction d'un étage supplémentaire dans le compresseur et une augmentation des températures d'entrée de turbine. Enfin, le nouveau fuselage respecte la loi des aires ce qui lui confère la fameuse "taille de guêpe".
la suite :
http://www.netmarine.net/aero/aeronefs/etend4p/histoire.htm
SUPER ETENDARD

Le Dassault Super-Étendard est un avion d'attaque et de chasse français construit par Dassault, destiné à être embarqué à bord de porte-avions. Successeur de l'Étendard IV, il a été produit à 85 exemplaires mis en service par la Marine nationale française et l'Argentine.
La version initiale du Super-Étendard est parfois désignée de façon abrégée SUE (pour SUper-Étendard), tandis que la version modernisée apparue à la fin des années 1980 est désignée SEM (pour Super-Étendard modernisé).
Les premières missions de guerre des Super-Étendard français furent conduites au-dessus du Liban dans le cadre de l'opération Olifant au début des années 1980. Ainsi, le 22 septembre 1983 ils attaquèrent avec succès des batteries d'artillerie de l'armée syrienne qui avaient tiré sur les positions du contingent français, tandis que le 17 novembre de la même année ils effectuèrent, lors de l'opération Brochet, un raid contre un camp terroriste près de Baalbeck en représailles à l'attentat du Drakkar à Beyrouth.
Les Super-Étendard modernisés (SEM) participèrent ultérieurement à des frappes aériennes lors des guerres de Bosnie-Herzégovine, opérations Balbuzard du début 1993 et puis en 1994, 1995, 1996 sur les porte-avions Clemenceau et Foch, puis durant la guerre du Kosovo dans le cadre de l’opération Trident II à partir du 26 janvier 1999, ils participent aux frappes de l’OTAN.
Quatre cent quinze sorties de combat sont effectuées par les Super-Étendard pour 202 missions et 127 attaques. 85 objectifs ont été traités au Kosovo et en Serbie. Avec 9 % des moyens français engagés, la flottille 11F effectue33 % des sorties, délivre 39 % des munitions guidées, détruit 45 % des objectifs assignés à la France, avec un pourcentage de coup au but de 73 %, soit le meilleur de l’alliance.
La flottille 11F des Super-Étendard se verra décerner la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures....