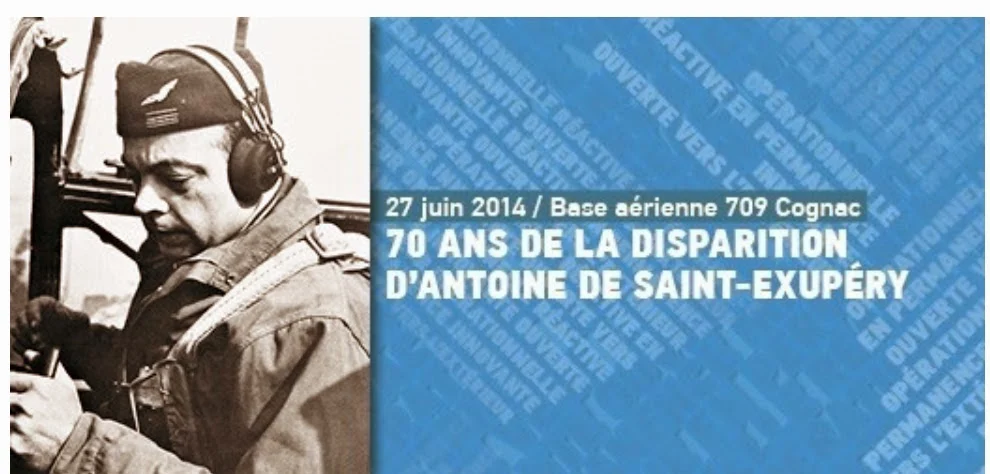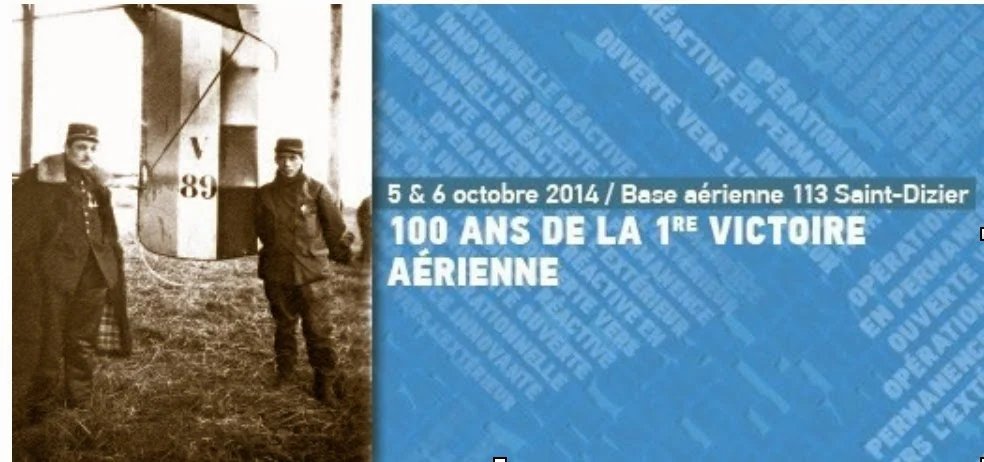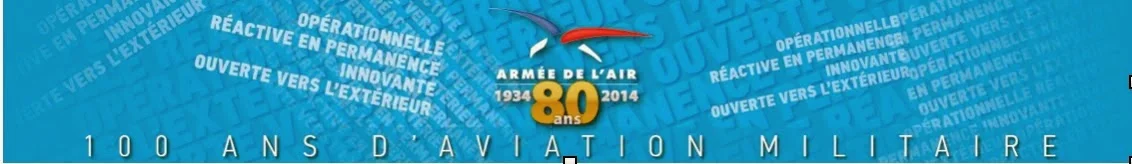L'affaire n'est dans la poche que le 8 mai 1945 Saint-Nazaire
La poche de Saint-Nazaire (Festung St. Nazaire — c'est-à-dire la forteresse de Saint-Nazaire) est, du mois d'août 1944 au 11 mai 1945, une zone de repli des troupes allemandes de Loire-Inférieure (actuelle Loire-Atlantique) constituée au moment de la libération du département par les forces alliées. Elle se forme autour du port et de la base sous-marine de Saint-Nazaire ; elle s'étend à l'est jusqu'à Saint-Omer de Blain et de La Roche-Bernard au nord à Pornic au sud.
 |
| Carte américaine de 1944 au 1/200000e de Vannes à Angers |
Isolé du reste du pays depuis le 19 Août 1944, l'Ilot de Saint-Nazaire ne disposait que d'un stock réduit de timbres-poste.
Ces timbres s'épuisant rapidement, le service postal fut dans l'obligation de prendre, au début de 1945, plusieurs dispositions qui, toutes, présentent un certain intêret philatélique.
Pour suppléer à l'absence de timbre on se servit de différents moyens de fortune. Les timbres à 1Fr50 furent utilisés au-delà de la date de démonétisation (1/11/44).
 |
| photo JM Bergougniou |
Après la dure bataille de Normandie et la percée d'Avranches, les Alliés libèrent très rapidement l'ouest de la France pendant la première quinzaine d’août 1944 (Rennes le 6 août, Nantes le 12, Rezé le 29). Des poches de résistance se forment alors sur la façade atlantique à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan.
Hitler tient à préserver ces zones stratégiques : par ses instructions du 31 juillet 1944 aux généraux Jodl et Warlimont, il demande à ses troupes de « les défendre jusqu’au dernier homme ». Constituées en forteresses, elles pourraient redevenir des points d’appui non négligeables sur l’Atlantique dans l’hypothèse où les armes secrètes (Wunderwaffen) seraient mises au point à temps pour retourner la situation en faveur du Reich.
Laissant de côté ces ports en eau profonde qui vont pourtant leur faire gravement défaut, les Anglo-Américains qui viennent de piétiner trop longtemps en Normandie, privilégient la poursuite de l’offensive vers l'Allemagne. Ils laissent cependant des troupes pour contrôler les limites des poches, assistées par l'armée française et par des bataillons des Forces françaises de l'intérieur.

La poche de Brest tombe le 18 septembre 1944 après de durs combats, les quatre autres durent jusqu'à la capitulation du 8 mai 1945, voire un peu au delà.

La poche de Brest tombe le 18 septembre 1944 après de durs combats, les quatre autres durent jusqu'à la capitulation du 8 mai 1945, voire un peu au delà.
La poche de Saint-Nazaire est centrée sur la ville et la Base sous-marine de Saint-Nazaire. Au nord de la Loire, la ligne de front suit la rive gauche de la Vilaine, puis de l'Isac (c'est-à-dire, ici, le canal de Nantes à Brest), jusqu'au niveau de Blain (la partie de la commune située à l'ouest du canal) ; elle descend ensuite vers le sud-ouest jusqu'à Cordemais en passant entre Bouvron, Fay-de-Bretagne et Le Temple-de-Bretagne. Au sud de la Loire, elle inclut les communes de Frossay, Saint-Viaud, Paimbœuf, Arthon-en-Retz (La Sicaudais), Saint-Père-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine, Sainte-Marie-sur-Mer et Pornic. Le secteur défensif côtier de la poche s'étire sur 50 km environ de littoral.
Pour assurer la défense de l'embouchure de la Loire, les Allemands ont mis en place de puissantes batteries d'artillerie. Au nord, près de Batz-sur-Mer, une batterie constituée de deux canons d'origine française de 240 mm de calibre. On trouve une batterie similaire au sud de la Loire près sur la pointe Saint-Gildas. Entre ces deux batteries, se trouvent d'autres pièces de calibre plus modeste, notamment à la pointe de Chemoulin avec quatre canons de 170 mm et quatre canons de 105 mm, ou encore, sur la rive sud, à Mindin et au Pointeau sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
Le 11 mai, la cérémonie de la reddition se déroule à l'hippodrome du Grand Clos à Bouvron. Au cours de cette cérémonie, le général Junck remet son arme au général américain Kramer en présence du général Chomel, du préfet de Loire-Inférieure, Alexandre Vincent, et de détachements français et américains.
Pour assurer la défense de l'embouchure de la Loire, les Allemands ont mis en place de puissantes batteries d'artillerie. Au nord, près de Batz-sur-Mer, une batterie constituée de deux canons d'origine française de 240 mm de calibre. On trouve une batterie similaire au sud de la Loire près sur la pointe Saint-Gildas. Entre ces deux batteries, se trouvent d'autres pièces de calibre plus modeste, notamment à la pointe de Chemoulin avec quatre canons de 170 mm et quatre canons de 105 mm, ou encore, sur la rive sud, à Mindin et au Pointeau sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
Après plusieurs raids lancés en septembre et octobre contre les troupes FFI de l'autre côté de la Vilaine, les Allemands effectuent au début du mois de novembre un nouveau coup de main dans le secteur oriental.
À part un petit débarquement effectué en décembre à la pointe de Pen Lan en Morbihan, les opérations les plus importantes sont menées en Pays de Retz dans le Sud Loire, où s'étendent des terres fertiles pouvant être utiles pour le ravitaillement.
Les Allemands s'emparent de Frossay en octobre et fin décembre, à la suite de violents combats, du village de La Sicaudais. Ils s'opposent au 2e bataillon FFI de la Vienne qui cèdent une bande de près de 100 km2. Le front se stabilise grâce à l'intervention du 8e régiment de cuirassiers.
Les Américains, quant à eux, délogent les Allemands de la forêt du Gâvre, les forçant à repasser sur l'autre rive du canal de Nantes à Brest et s'emparent du bourg de Blain.
 En février 1945, grâce à des agents secrets vivant à l'intérieur de la forteresse, la Résistance avertit le commandement de l'imminence d'une attaque allemande près du canal de Nantes à Brest.
En février 1945, grâce à des agents secrets vivant à l'intérieur de la forteresse, la Résistance avertit le commandement de l'imminence d'une attaque allemande près du canal de Nantes à Brest.
Au cours du mois de mars, l'artillerie américaine parvient à couler plusieurs cargos qui font la navette entre les forteresses de Lorient et de Saint-Nazaire, posant ainsi des problèmes de ravitaillement aux Allemands.
En avril, les Allemands redoublent d'agressivité et harcèlent sans cesse les positions alliées avec leur puissante artillerie. Ainsi, le 19 avril des accrochages se produisent entre trois patrouilles franco-américaines et les Allemands causant 3 morts et plus d'une vingtaine de blessés (et la perte de 3 chars) côté allié et la perte de 33 hommes (morts ou blessés) côté allemand10 (à cette même période, sur le front de l'Ouest, les troupes anglo-américaines ont déjà largement envahi l'Allemagne et atteint l'Elbe).
La signature de la reddition de la poche a lieu dans la maison de Francis Moisan, au lieu-dit « Les Sables » à Cordemais, le 8 mai 1945 à 13 h, le jour même de la capitulation de l'Allemagne.À part un petit débarquement effectué en décembre à la pointe de Pen Lan en Morbihan, les opérations les plus importantes sont menées en Pays de Retz dans le Sud Loire, où s'étendent des terres fertiles pouvant être utiles pour le ravitaillement.
Les Allemands s'emparent de Frossay en octobre et fin décembre, à la suite de violents combats, du village de La Sicaudais. Ils s'opposent au 2e bataillon FFI de la Vienne qui cèdent une bande de près de 100 km2. Le front se stabilise grâce à l'intervention du 8e régiment de cuirassiers.
Les Américains, quant à eux, délogent les Allemands de la forêt du Gâvre, les forçant à repasser sur l'autre rive du canal de Nantes à Brest et s'emparent du bourg de Blain.
 En février 1945, grâce à des agents secrets vivant à l'intérieur de la forteresse, la Résistance avertit le commandement de l'imminence d'une attaque allemande près du canal de Nantes à Brest.
En février 1945, grâce à des agents secrets vivant à l'intérieur de la forteresse, la Résistance avertit le commandement de l'imminence d'une attaque allemande près du canal de Nantes à Brest.Au cours du mois de mars, l'artillerie américaine parvient à couler plusieurs cargos qui font la navette entre les forteresses de Lorient et de Saint-Nazaire, posant ainsi des problèmes de ravitaillement aux Allemands.
En avril, les Allemands redoublent d'agressivité et harcèlent sans cesse les positions alliées avec leur puissante artillerie. Ainsi, le 19 avril des accrochages se produisent entre trois patrouilles franco-américaines et les Allemands causant 3 morts et plus d'une vingtaine de blessés (et la perte de 3 chars) côté allié et la perte de 33 hommes (morts ou blessés) côté allemand10 (à cette même période, sur le front de l'Ouest, les troupes anglo-américaines ont déjà largement envahi l'Allemagne et atteint l'Elbe).
Le 11 mai, la cérémonie de la reddition se déroule à l'hippodrome du Grand Clos à Bouvron. Au cours de cette cérémonie, le général Junck remet son arme au général américain Kramer en présence du général Chomel, du préfet de Loire-Inférieure, Alexandre Vincent, et de détachements français et américains.
Pour les habitants de la Poche de Saint-Nazaire, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) avait obtenu un arrêt des combats à un point précis où une fois par semaine avait lieu l'échange du courrier entre la "Poche" et le restant de la France.
Pour affranchir ce courrier la Chambre de Commerce de Saint-Nazaire avait obtenu de la Sous-Préfecture de Saint-Nazaire l'autorisation tout à fait exceptionnelle (arrêté du 30 mars 1945) de tirer deux vignettes d'affranchissement : une (avec inscriptions en couleur rouge) à deux francs et l'autre (avec inscriptions en couleur verdâtre) à cinquante centimes.
Il fut émis 50.000 timbres (dont 35.000 furent effectivement vendus) montrant une nef et sur la voile était dessinée la clef symbolique de la ville de Saint-Nazaire.
30.000 timbres à deux francs furent émis, et 19.000 furent vendus ; 20.000 timbres à 50 centimes furent émis, et 16.000 furent vendus. La première journée de mise en vente de ces timbres fut le 9 avril 1945, ils furent vendus jusqu'au 9 mai 1945.
Pour la petite histoire, cette émission de deux timbres en dehors de l'administration des PTT était une conséquence inattendue du décret n° 45.289 du 22 février 1945 (avec application au 1er mars 1945), qui avait augmenté le prix des tarifs postaux : le prix d'affranchissement d'une lettre du 1er échelon de poids (jusqu'à 20 grammes) passant de 1,50 franc à 2,00 francs.
Ce décret avait interdit tout affranchissement, à compter du 1er mars 1945, avec des timbres à l'effigie du Maréchal Pétain. Or, le bureau de poste de Saint-Nazaire n'avait que des "timbres officiels" à cette effigie. L'administration des PTT a donc autorisé (via le CICR), à titre tout à fait provisoire et exceptionnel, leur utilisation jusqu'à la libération de cette malheureuse cité…
C'est le 8 Janvier 1945 que la poste de LA BAULE, et sur les ordres de la Direction départementale, eut recours à l'emploi d'une machine à affranchir appartenant aux Chantiers de Penhoët .
Celle ci fonctionna jusqu'au 23 Mai 1945.
A La Baule, " La Centralisation du Livre ", une Librairie Imprimerie, possédait un rayon philatélie tenu par Monsieur Roger Blachère.
C'est le 8 Janvier 1945 que la poste de LA BAULE, et sur les ordres de la Direction départementale, eut recours à l'emploi d'une machine à affranchir appartenant aux Chantiers de Penhoët .
Celle ci fonctionna jusqu'au 23 Mai 1945.
A La Baule, " La Centralisation du Livre ", une Librairie Imprimerie, possédait un rayon philatélie tenu par Monsieur Roger Blachère.
Celui-ci effectua, pendant toute cette période trouble, de très nombreuses lettres de complaisance, adressées soit à la Centralisation du Livre (Rayon Philatélique), soit à lui-même dans différentes postes restantes de la région (La Turballe, Guerande, Batz sur Mer, Ferel, Saint Gildas des Bois, Piriac sur Mer, etc. et même Guenrouet, bureau fermé par suite des bombardements, pour avoir des "RETOUR A L'ENVOYEUR").
A toutes les combinaisons possibles de vignettes et de timbres (et même de demi-timbres), furent rajoutées de nombreuses griffes et signatures...:
sources :
http://www.postiers.net/t4618-la-poste-et-les-empoches-de-saint-nazaire-en-1944-1945
Voir le site très complet et très documenté de :
http://1f50bersier.free.fr/st-naz.html