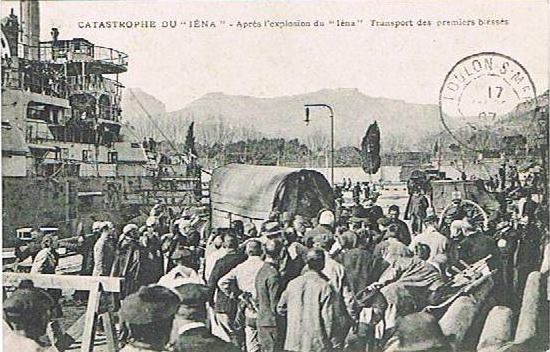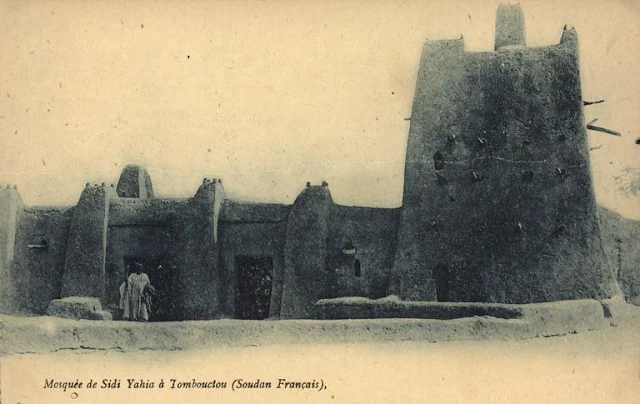"... voici quelques clichés du Beautemps Beaupré qui a effectué un carénage dans les formes du ports. ... Je sais juste qu'il a appareillé aujourd'hui à 16H, malheureusement je n'avais pas mon appareil photo quand je l'ai vu en Loire..."
 |
| Lorient Armées 11-2-2003 Prise d'armement pour essais |
"Bon courage et bravo pour tous les sujets qui sont publiés."
Amicalement
Yves-Laurent COUEDEL
 |
| Paris Tri Interarmées 05-03-2010 Zone de la Ligne |
Arrivé mercredi 5 décembre dans l’estuaire de la Loire, le bâtiment hydro-océanographique Beautemps-Beaupré est entré en cale sèche. Le BHO de la Marine nationale va rester un mois et demi à Saint-Nazaire pour son Indisponibilité Périodique pour Entretien et Réparations (IPER). Cet arrêt technique majeur sera mené à bien par Eiffel Industries, qui travaillera sous la maîtrise d'oeuvre de la société nantaise LGM, qui a remporté en 2008 le contrat de maintien en condition opérationnelle du Beautemps-Beaupré pour une période de cinq ans.

Long de 80.6 mètres et affichant un déplacement de 3300 tonnes en charge, ce bâtiment a été livré en 2003 par les chantiers STX de Lorient. Armé par deux équipages se relayant afin d’augmenter sa disponibilité, le Beautemps-Beaupré doit pouvoir réaliser jusqu’à 330 jours de mer par an.
Il a repris la mer hier.
Lu dans Ouest-France Entreprise
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/saint-nazaire-navire-militaire-chez-eiffel-industrie-marine-24-12-2012-79692
La gestion de son arrêt technique a été confiée à la société nantaise LGM qui assure, dans le cadre d'un contrat, le maintien en condition opérationnelle du navire. A charge pour elle de trouver des entreprises pour réaliser les travaux nécessaires. « Eiffel industrie marine a remporté ce contrat », se félicite Romuald Poirat, directeur régional d'Eiffel industrie. « C'est une satisfaction de revoir des navires militaires en escale technique dans nos bassins », ajoute Mathieu Wibaux, responsable de l'activité réparation navale d'Eiffel industrie marine, filiale d'Eiffel industrie.
Lu dans Ouest-France Entreprise
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/saint-nazaire-navire-militaire-chez-eiffel-industrie-marine-24-12-2012-79692
Entreprise du jour
Lundi 24 décembre 2012
Saint-Nazaire. Un navire militaire chez Eiffel industrie marine
En décrochant le contrat d'arrêt technique du BHO Beautemps-Beaupré, Eiffel industrie marine s'ouvre la voie des navires militaires. 10 000 heures de travail en tout.
En cale sèche, le « Beautemps-Beaupré », navire hydrographique et océanographique pour la Marine nationale,est en arrêt technique. Il sera remis à flot à la fin du mois, avant de repartir vers la Mauritanie pour effectuer ses missions.
 |
| Paris Tri Interarmées 19-01-2008 Madagascar |
Bon retour de pêche pour l'entreprise Eiffel industrie marine de Saint-Nazaire. Elle a ramené dans ses filets un gros poisson : un navire hydrographique et océanographique, le BHO Beautemps Beaupré. Un bâtiment destiné à l'étude des fonds marins construit en 2002 par STX Lorient pour la Marine nationale.
La gestion de son arrêt technique a été confiée à la société nantaise LGM qui assure, dans le cadre d'un contrat, le maintien en condition opérationnelle du navire. A charge pour elle de trouver des entreprises pour réaliser les travaux nécessaires. « Eiffel industrie marine a remporté ce contrat », se félicite Romuald Poirat, directeur régional d'Eiffel industrie. « C'est une satisfaction de revoir des navires militaires en escale technique dans nos bassins », ajoute Mathieu Wibaux, responsable de l'activité réparation navale d'Eiffel industrie marine, filiale d'Eiffel industrie.
 |
| Paris Tri Interarmées 10-03-2011 Mission Océan Indien 2011 |
Maintenance préventive
Le Beautemps-Beaupré est arrivé à Saint-Nazaire le 6 décembre. Il sortira de cale sèche le 31 décembre et restera à flot dans le bassin jusqu'au 15 janvier 2013 avant de repartir en mission sur tous les océans du monde. Navire spécifique de par ses fonctions, sa mise sur cale a demandé de multiples précautions et une très grande précision avec une réhausse des tins sur lesquels sa coque repose. « Ce navire est doté de nombreux apparaux de mesure fixés sous la coque. Il a fallu, avec les équipes du Grand port maritime, veiller à leur protection lors de la mise en cale sèche », confie Mathieu Wibaux.
Opération réussie, les travaux ont pu commencer. « Un contrat d'environ 10 000 heures de travail pour l'ensemble des équipes qui vont travailler dessus, qu'elles soient de Eiffel industrie marine ou de sociétés sous-traitantes. » Ces travaux vont de la refonte du système de propulsion, avec sortie de la ligne d'arbre, du safran, pour les contrôler, jusqu'à différents entretiens de pièces mécaniques, en passant par le carénage, des travaux de peinture sur la coque et sur le château...
 |
| Mission Océan Indien 2011 Escale à Djibouti 13-3-2011 |
| Photo Ouest-France |
Elle l'a confié à son agence nantaise chargée d'assurer « la disponibilité opérationnelle du bâtiment. Deux types d'intervention : la maintenance préventive lors des arrêts techniques et la maintenance corrective. Là, nous intervenons pendant les missions du navire, là où il se trouve en faisant travailler des entreprises voisines du port d'accueil, en envoyant des pièces à bord ou, pour des opérations plus délicates, en envoyant des équipes depuis la France. » Pour Mickaël Rebuffey, chef de projet chez LGM, « le suivi du Beautemps-Beaupré est le deuxième contrat le plus important de notre groupe ».
Photos Yves-Laurent Couedel