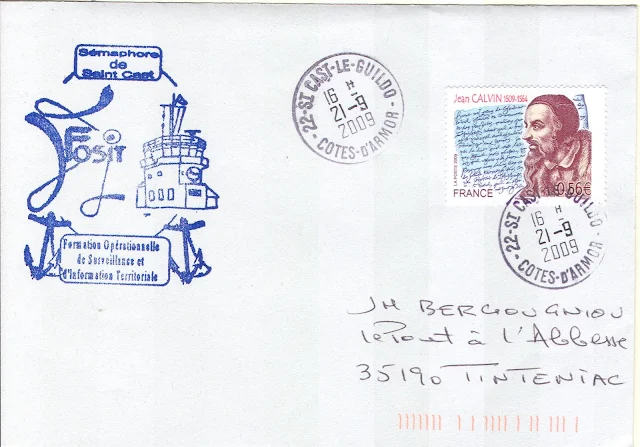La Force de réaction met à l'épreuve ses capacités amphibies
La Force de réaction de l'OTAN a testé les moyens dont elle dispose pour conduire des opérations complexes depuis une base à la mer au cours du plus grand exercice amphibie jamais organisé par l'OTAN. La Force de réaction de l'OTAN a testé les moyens dont elle dispose pour conduire des opérations complexes depuis une base à la mer au cours du plus grand exercice amphibie jamais organisé par l'OTAN. http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news.htm
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=111253&u=6833
Exercices “Train as we fight”
Les exercices jouent un rôle important car ils permettent à l’Alliance de tester et de valider ses concepts, ses procédures, ses systèmes et sa tactique. Ils contribuent aussi à l’interopérabilité et à la réforme de la défense.
Alors que les pays de l'OTAN à titre individuel organisent des exercices dans le cadre de leur préparation normale aux opérations, ils participent aussi à des exercices à l’échelle de l’Alliance. L’organisation d’exercices fréquents permet de s’assurer que les forces sont capables de mener des opérations de manière efficiente et efficace dans des situations de crise exigeantes. Les exercices permettent aussi d’accroître l’interopérabilité et d’oeuvrer à la réforme de la défense avec les Partenaires. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Les exercices contribuent aux objectifs ci-après : Entraînement et expérience. Les exercices permettent aux forces de mettre en pratique la formation reçue antérieurement, augmentant ainsi leur niveau d’efficacité dans un domaine déterminé. Ils partent du principe que la formation de base est acquise, sans qu’elle soit obligatoire, ou qu’un personnel suffisamment formé/expérimenté est disponible. Mise à l’épreuve et validation des structures. Les exercices sont conçus pour mettre à l’épreuve les structures et le personnel.
Une structure est faite de nombreuses composantes – des concepts, une doctrine, des procédures, des systèmes et une tactique – qui doivent fonctionner de concert. Les structures d’approvisionnement, par exemple, nécessitent un entraînement, des équipements et des procédures de fonctionnement spécialisées, qui doivent se combiner pour assurer un soutien efficace des objectifs d’une mission.
Mettre ces structures en pratique permet de les tester et, au besoin, de les perfectionner. Interopérabilité. Les forces dirigées par l’OTAN doivent être en mesure de travailler ensemble efficacement en dépit des différences de doctrine, de langue, de structures, de tactique et d’entraînement. L’interopérabilité est due en partie à la coopération pratique entre le personnel des pays OTAN, partenaires, ICI (Initiative de coopération d’Istanbul) et de pays de contact sélectionnés. Réforme de la défense.
La participation à des exercices de l'OTAN est l’une des options ouvertes aux Partenaires, le but étant de les aider à réformer leur défense. Les exercices permettent aux pays partenaires de s’insérer dans les structures en place dans les pays membres de l’Alliance et de les observer. Scénarios d’exercices Au cours d’un exercice, les forces doivent réagir à un scénario fictif qui est proche de ce qui pourrait exister dans la réalité. Les exercices portent sur la gamme complète des opérations militaires, allant du combat à la stabilisation et à la reconstruction en passant par le secours humanitaire. Leur durée peut aller d’un jour à plusieurs semaines et leur portée peut varier, allant de quelques officiers traitant un problème isolé à des scénarios de combat complets faisant intervenir en nombre des avions, des bâtiments de la marine, des pièces d’artillerie, des véhicules blindés, et des milliers d’hommes. Les exercices de l’Alliance bénéficient du soutien des pays (et, souvent aussi, de pays partenaires), qui fournissent des troupes, des équipements ou d’autres types de soutien. Les pays apportent généralement des contributions financières.
Chaque exercice répond à des objectifs définis au préalable, qui orientent le choix des activités à mener. Il peut s’agir de développer des aptitudes et des connaissances, de mettre en pratique des mécanismes de coordination ou de valider des procédures. À la fin d’un exercice, les commandants et, dans de nombreux cas, les troupes procèdent collectivement au bilan de leurs activités. Ils peuvent ainsi recenser les domaines qui fonctionnent bien (les « meilleures pratiques ») et ceux qui sont susceptibles d’être améliorés (« enseignements tirés »). De cette façon, les exercices facilitent l’amélioration constante de l’interopérabilité, de l’efficacité et de la performance.
Le programme d'entraînement et d'exercices militaires Les programmes d'entraînement et d'exercices de l'OTAN sont élaborés à la fois par le Commandement allié Opérations et par le Commandement allié Transformation. Ce processus conduit à la publication du programme d'entraînement et d'exercices militaires (MTEP) annuel.
Le MTEP fournit des informations détaillées sur l’entraînement, les exercices et les activités connexes prévus pour les deux premières années calendrier et donne des informations générales sur les activités d’entraînement et les exercices prévus pour les quatre années suivantes. Le document se fonde sur les priorités et les intentions des commandants stratégiques, ce qui inclut généralement des domaines tels que les opérations en cours et à venir, la Force de réaction de l'OTAN, la pratique de la transformation et les programmes de coopération militaire de l'OTAN. Les besoins de l'OTAN en matière d’exercices sont coordonnés au cours de trois réunions du comité de programmation du MTEP au moins (qui sont ouvertes aux représentants des pays partenaires), dont la première a lieu au moins dix-huit mois avant le début du cycle suivant.
L’aboutissement de la planification préliminaire est la Conférence OTAN sur la formation et les exercices (NTEC), au cours de laquelle les commandements de l'OTAN, les pays OTAN et partenaires et d’autres invités procèdent à la coordination finale des exercices et apportent leur soutien au MTEP annuel. Le MTEP 2006, parallèlement à d’autres activités de formation (séminaires, formation des commandants et de l’état-major de combat) comporte onze exercices réels et trente exercices informatisés de poste de commandement. Participation des pays partenaires Les Partenaires organisent régulièrement des exercices OTAN et y participent. Le but visé est d’accroître l’interopérabilité et cette participation s’inscrit dans le processus de réforme de la défense. En 2004, l’Alliance a créé un cadre plus vaste et plus ambitieux pour le Dialogue méditerranéen, dont l’un des objectifs est de promouvoir la coopération entre militaires et, par là, d’accroître l’interopérabilité au moyen d’exercices militaires choisis et d’activités connexes de formation et d’entraînement. Les pays ICI (Initiative de coopération d’Istanbul) et les pays de contact peuvent aussi participer, en qualité d’observateurs, à certains exercices ou participer activement à des activités d’entraînement avec l’approbation du Conseil de l’Atlantique Nord.
Quelque 40% des exercices de l'OTAN sont ouverts aux pays partenaires. En 2005 et en 2006, le taux moyen de participation des Partenaires à des exercices de paix conjoints OTAN-Partenaires a été de dix partenaires par exercice, alors que le taux moyen de participation aux « exercices OTAN ouverts aux Partenaires » a été de cinq pays par exercice. Exercices politiques Les exercices sont organisés au sein des structures militaires et civiles de l'OTAN. En tant qu’alliance politique, l’OTAN met en pratique ses arrangements, concepts et procédures politiques afin de s’assurer que les structures et les moyens de consultation et de prise de décisions de l’Alliance sont mis au point, et que les conseillers de première ligne – responsables politiques de haut niveau non élus et commandants militaires dans les capitales et au sein des structures de l'OTAN – ne perdent pas de vue la complexité du fonctionnement d’organisations multinationales telles que l’OTAN.
Étant donné que de nombreux Partenaires peuvent être engagés dans des opérations dirigées par l’OTAN, mener des exercices avec eux à ce niveau donne en outre aux conseillers de première ligne et aux responsables internes de la gestion des crises dans les pays non membres de l'OTAN la possibilité de saisir le mode de fonctionnement de l'OTAN. Que signifient les intitulés d’exercices ? En 2006, les intitulés des exercices ont fait l’objet d’une nouvelle convention. Chaque exercice OTAN est identifié par deux mots. La première lettre du premier mot indique le commandement OTAN responsable de la programmation de l’exercice. S Grand Quartier général des puissances alliées en Europe B Commandement des forces interarmées de Brunssum N Commandement des forces interarmées de Naples L Commandement interarmées de Lisbonne
La première lettre du second mot précise l’élément ou les éléments concernés.
A Air
L Terre
M Mer
J Interarmées
Par exemple, l’exercice NOBLE MARLIN est un exercice maritime organisé et dirigé par le Commandement des forces interarmées de Naples
Quels organismes de l'OTAN jouent un rôle central ?
Le Commandement allié Opérations est le principal responsable des exercices militaires de l'OTAN. Il travaille en étroite coopération avec le Commandement allié Transformation, qui apporte son soutien en matière de planification, d’exécution et d’évaluation des exercices. L’un et l’autre sont aidés par le réseau d’instituts de formation, d’entraînement et d’évaluation de l’Alliance et par les structures existant au niveau national.
Comment la situation a-t-elle évolué ? Des exercices à l’échelle de l’Alliance sont organisés depuis 1951, c’est-à-dire depuis plus de vingt-cinq ans. Au début, ces exercices devaient renforcer la capacité des forces de l'OTAN de se préparer à la défense collective. En d’autres termes, ils devaient permettre de s’assurer que les forces étaient préparées à faire face à une attaque.
Une force intégrée sous un commandement centralisé a été préconisée en septembre 1950.
Le premier Commandant suprême des Forces alliées en Europe (SACEUR), le général américain Dwight D. Eisenhower, a été nommé en décembre 1950. Suite à la nomination du général Eisenhower, les forces nationales ont été placées sous commandement centralisé. Les premiers exercices de l’Alliance ont eu lieu à l’automne 1951. En 1953, les commandants de l'OTAN ont mené environ 100 exercices de types variés. À partir de ce moment, les forces de l'OTAN ont cessé d’être un rassemblement d’unités nationales et ont commencé à gagner en cohésion. Un an après que le Commandement allié Europe était devenu opérationnel, le général Eisenhower a déclaré que la préparation au combat de nos troupes s’était fortement améliorée.
En 1994, l’Alliance a lancé l’initiative du Partenariat pour la paix, dont l’un des objectifs est de promouvoir le renforcement de la coopération et de l’interopérabilité militaires. Depuis lors, les membres du Partenariat pour la paix peuvent participer à des exercices de maintien de la paix sur le terrain. En 2002, la Force de réaction de l'OTAN (NRF) a été créée. Plus récemment, l’accent a été mis sur les exercices menés à l’appui de cette Force. Cet entraînement doit garantir que la NRF peut se déployer rapidement et mener des opérations avec efficacité dans diverses situations.
Au Sommet d'Istanbul en 2004, les dirigeants de l’Alliance ont élevé le Dialogue méditerranéen au rang de partenariat à part entière, ce qui inclut une participation accrue à des exercices et à un entraînement individuel dans les instituts de l'OTAN. En même temps, l’Initiative de coopération d'Istanbul (ICI) a été prise, ouvrant la voie à la coopération entre l’OTAN et les pays du Moyen-Orient élargi dans des domaines tels que la formation et l’entraînement, et comportant des dispositions qui permettent aux Partenaires de s’engager dans un entraînement conjoint à la lutte contre le terrorisme et de s’entraîner conjointement avec la NRF.




+Le+T%C3%A9l%C3%A9gramme+30-09-09.jpg)






 Le Laplace venait de déclencher l'explosion d'une mine qui avait sans doute échappé aux dragages effectués apès la guerre. La rapidité de l'engloutissement ne permettant pas de mettre des embarcations à l'eau, de nombreux hommes se retrouvaient bientôt à la mer, munis seulement de gilets de sauvetage. Durant toute la nuit, ils allaient dériver dans un sens puis dans l'autre sous l'effet des courants de marée.
Le Laplace venait de déclencher l'explosion d'une mine qui avait sans doute échappé aux dragages effectués apès la guerre. La rapidité de l'engloutissement ne permettant pas de mettre des embarcations à l'eau, de nombreux hommes se retrouvaient bientôt à la mer, munis seulement de gilets de sauvetage. Durant toute la nuit, ils allaient dériver dans un sens puis dans l'autre sous l'effet des courants de marée. Quatre hommes pourtant réussissaient à prendre pied au Cap Fréhel où ils furent recueillis par un paysan. Epuisés et supposant que l'alerte avait été donnée par le bruit de l'explosion, ils négligèrent malheureusement de s'en assurer. Or ce n'était pas le cas et de ce fait, la catastrophe ne fut découverte que le lendemain matin lorsque le bateau-pilote vint prendre en charge leLaplace dont il ne retrouva qu'une large nappe de mazout et de nombreuses épaves avant de repérer un premier groupe de rescapés.
Quatre hommes pourtant réussissaient à prendre pied au Cap Fréhel où ils furent recueillis par un paysan. Epuisés et supposant que l'alerte avait été donnée par le bruit de l'explosion, ils négligèrent malheureusement de s'en assurer. Or ce n'était pas le cas et de ce fait, la catastrophe ne fut découverte que le lendemain matin lorsque le bateau-pilote vint prendre en charge leLaplace dont il ne retrouva qu'une large nappe de mazout et de nombreuses épaves avant de repérer un premier groupe de rescapés.  Dès lors, d'importants moyens de sauvetage furent mis en oeuvre mais c'était trop tard pour 51 marins qui avaient déjà succombé.
Dès lors, d'importants moyens de sauvetage furent mis en oeuvre mais c'était trop tard pour 51 marins qui avaient déjà succombé.