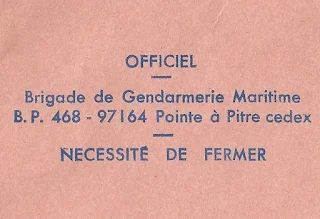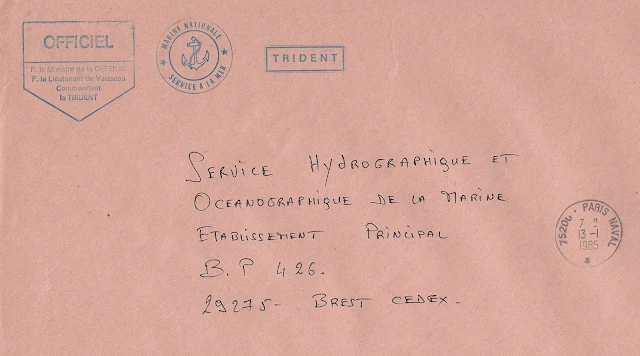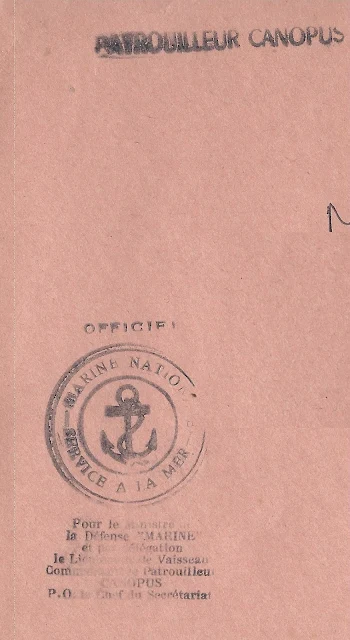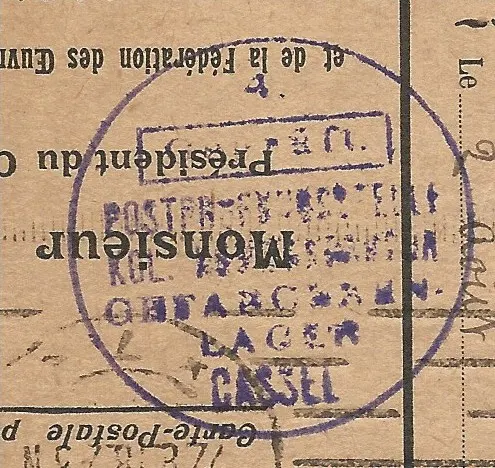L'HERMIONE de retour à Rochefort
17 juin 2018
En janvier dernier, L’Hermione quittait Rochefort, son port d’attache, pour mettre le cap sur son Voyage 2018 « Libres Ensembles de l'Atlantique à la Méditerranée », en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie.
 |
| L'Hermione photo (c) JM Bergougniou |
Pendant quatre mois et demi, la réplique de la frégate de La Fayette a navigué entre Atlantique et Méditerranée, faisant escale à La Rochelle, Tanger, Sète, Toulon, Marseille, Nice, Port-Vendres, Bastia, Portimao, Pasaia, Saint-Jean-de-Luz et Bordeaux.
 |
| à boulets rouges photo (c) JM Bergougniou |
Dimanche 17 juin, le navire fera son retour dans son port d’attache. Des retrouvailles qui donneront lieu à une grande fête populaire.
 |
| Bras, grelins, bitord, drisses, merlin, luzin, photo (c) JM Bergougniou |
- L'Hermione sera au mouillage à l'île d'Aix dès le 15 juin.
- Le dimanche 17 juin à 5h : l'Hermione quitte son mouillage pour se diriger vers Rochefort.
- 5h30 : Passage devant Fouras et Port des Barques.
- 6h15 : Le navire longe Port neuf. Quartier des pêcheurs d'Islande, Rochefort.
- 6h30 : L'Hermione se présente devant Soubise
- 7h : La frégate entre dans la forme de radoub Napoléon IIII, arsenal maritime de Rochefort.
 |
| aux bancs (des accusés?) photo (c) JM Bergougniou |
Les flancs joufflus sont bordés par les joncs et les pâturages où batifolent chevaux et vaches. Le jour n’est pas encore levé que l’imposante étrave de L’Hermione s’est déjà engouffrée dans l’estuaire de la Charente. Ce dimanche matin, la réplique de la frégate qui emmena Lafayette en Amérique quitte le mouillage de l’île d’Aix pour rentrer au bercail. Poussé par la marée haute, le navire propulsé au moteur chemine dans les méandres du fleuve, cap sur son port d’attache Rochefort(Charente-Maritime).
 |
| Peu ou proue photo (c) JM Bergougniou |
Ambiance fin de croisière pépère à bord du trois-mâts – le plus complexe à manœuvrer au monde – sous les ordres du commandant en second en grand uniforme d’apparat XVIIIe. Service minimum pour les quatre-vingts gabiers plus ou moins barbus, professionnels et amateurs, dont certains bouclent une aventure de cinq mois dans la Méditerranée, via Tanger (Maroc), Barcelone (Espagne) Marseille, Bastia, puis le Portugal, dans des conditions parfois très rudes.
merci à René
sources
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/l-hermione-a-bon-port