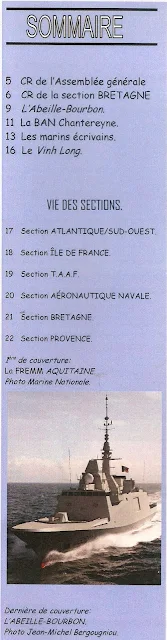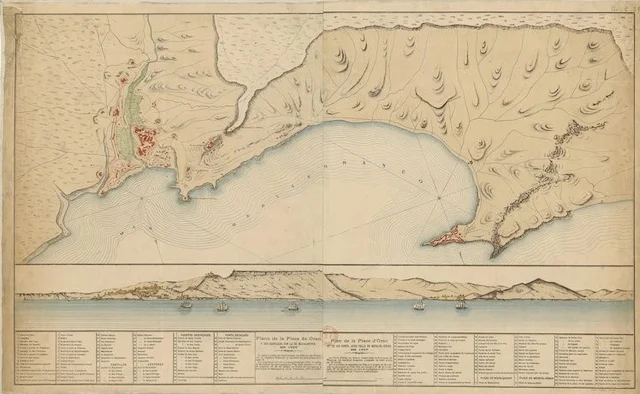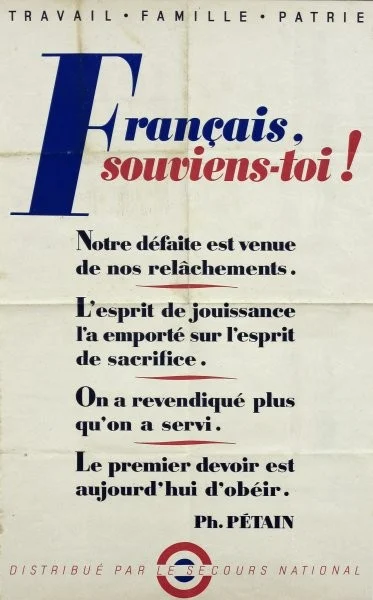Mise en sommeil de la Poste aux Armées Vincennes 22 mai 2015
La cérémonie à Vincennes a précédé la clôture effective qui a eu lieu le 30 juin 2015.
Une cérémonie officielle de "mise en sommeil" du service de la poste interarmées s'est déroulée le vendredi 22 mai 2015 au Fort Neuf de Vincennes, où était implanté le Département central du service de la poste interarmées.
C'est donc une page qui se tourne puisqu'il n'y a plus de personnel à ce jour tous les services ont cessé toutes activités. Je garde de bons souvenirs du temps passé avec le personnel de Diderot et de Vincennes et des contacts avec le lieutenant-colonel Xavier Rommel qui a soutenu à plusieurs reprises la Marcophilie Navale." Joël Moreau
Le château de Vincennes est une forteresse située sur la commune de Vincennes, à l’est de Paris, en France, érigé du 14e siècle au 17e siècle. Il est le plus vaste château fort royal français subsistant et, par la hauteur de son donjon, 52 mètres, il est une des plus hautes forteresses de plaine d’Europe avec celui de Crest. Son donjon est le plus haut d'Europe.
Le château de Vincennes est le siège du service historique de la Défense.
Cette forteresse a plus l'apparence d'une vaste cité fortifiée ou d'une « résidence royale fortifiée » que d'un château fort. Si ce château n'est à l'origine qu'un simple manoir, il a très tôt vocation à abriter, pendant de longues périodes, la famille royale avec toute sa domesticité, une partie de l'administration du royaume et l'armée nécessaire pour sa défense. Il est composé d'un long mur d'enceinte, flanqué de trois portes et de six tours de 42 mètres de hauteur, qui se développe sur plus d'un kilomètre et qui protège un espace rectangulaire de plusieurs hectares (330 x 175 m). La place ainsi protégée est occupée par le donjon haut de 50 mètres au-dessus du sol de la cour, des bâtiments civils, administratifs et militaires et une chapelle. Au Moyen Âge, l'ensemble permettait de vivre sur place à plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Le donjon fut aménagé en prison d'État (pour les prisonniers de haute naissance). Sa capacité ne lui permettait pas d'héberger plus de quatorze détenus. Le cardinal de Retz alla y méditer sur la Fronde dans l'ancienne chambre de Charles V. Nicolas Fouquet, qui avait lancé l'architecte Le Vau, eut également droit aux honneurs de la prison de Vincennes, à la suite à son procès de trois ans (1664) et avant son transfert dans la place forte royale de Pignerol.
Le château fut définitivement délaissé comme résidence royale lorsque le Roi s'installa à Versailles (vers 1670). Louis XV n'y séjourna que quelques mois (il y fut envoyé à la mort de son arrière-grand-père Louis XIV, en septembre 1715, l'air y était jugé plus sain qu'à Versailles ; le régent – Philippe d'Orléans – l'emmena ensuite à Paris). Louis XVI n'y fit aucun séjour.
Le château de Vincennes relève à la fois du ministère de la Culture (le site est classé monument historique en 1993 et 1999, et le Service départemental de l'architecture et du patrimoine y est situé), et du ministère de la Défense (le château abrite le Service historique de la défense, SHD).
Depuis 1988, un vaste programme de rénovation a été entrepris. Menacé de ruine, le donjon est fermé en 1995, et après d'importants travaux de consolidation générale de sa structure, le donjon avec ses appartements royaux rouvre au public en 2007. En 2008-2009, la chapelle royale a également subi une importante restauration, nécessitée par la tempête de 1999.
Sources
photos Joël Moreau
Marcophilie navale Ile de France (Joël Moreau)
La poste aux Armées
http://poste-aux-armees.blogspot.fr/2015/05/la-ceremonie-de-mise-en-sommeil-du.html