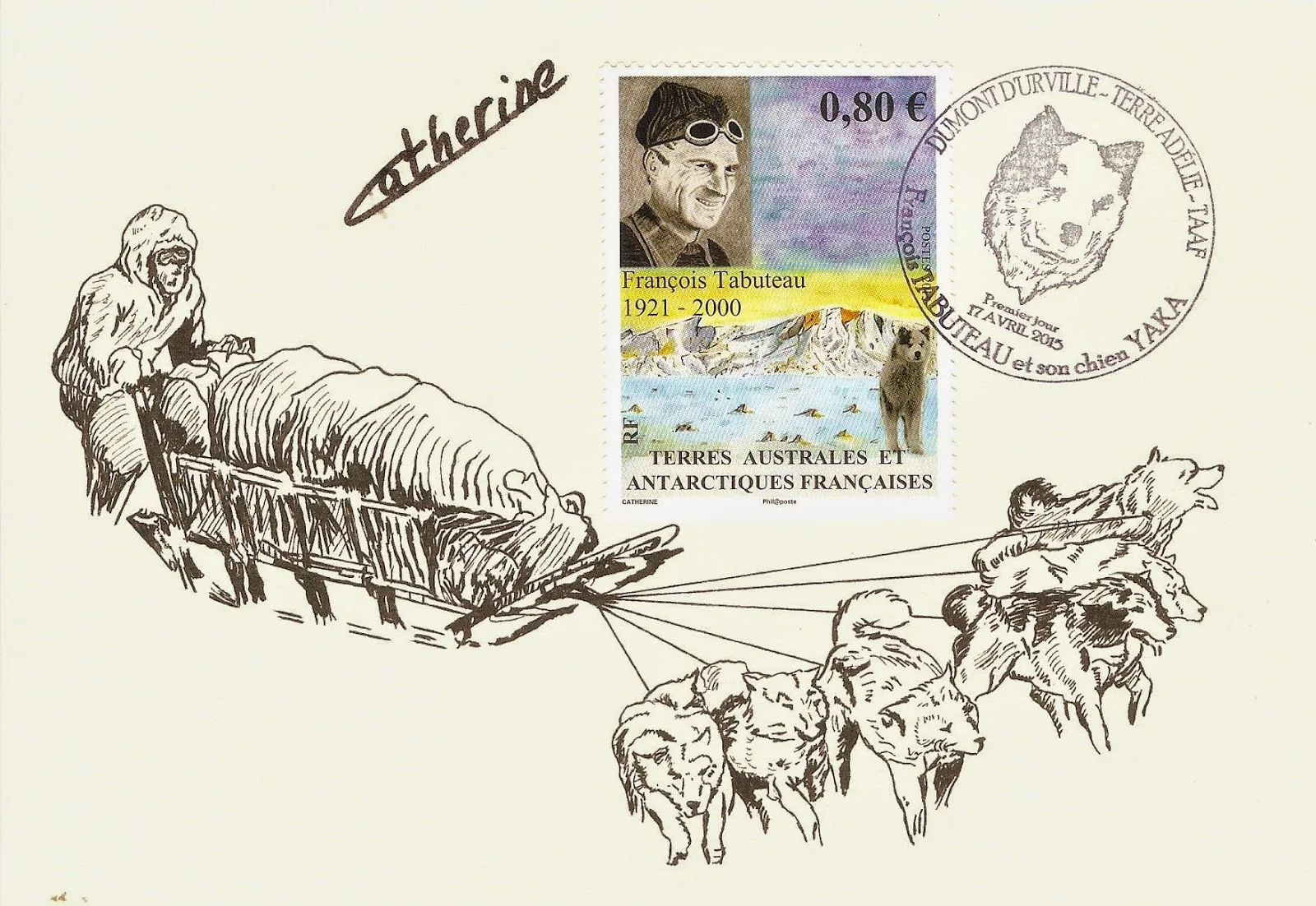La BAN Landivisiau
L’implantation d’une base aéronavale (BAN) à Landivisiau, dans le Finistère, est décidée en 1962 pour répartir plus équitablement les forces de l’aviation embarquée entre les façades atlantique et méditerranéenne.
Inaugurée en 1965, la base accueille ses premières flottilles en 1967. La BAN fête donc cette année ses 45 ans d’activité opérationnelle, occasion de faire découvrir les archives photographiques conservées à l’ECPAD consacrées à la base et aux formations qui y sont affectées successivement.
Suite au développement de l'aviation embarquée à réaction et face à la "surpopulation" de la base varoise de Hyères, l'État-major décide de construire une base d'aéronautique navale en Bretagne où l'essentiel de la chasse à réaction de l'Aéronautique navale serait basée ; ainsi est née la B.A.N. Landivisiau.
Elle s'étend sur 370 hectares répartis sur cinq communes (Bodilis, Plougar, Plounéventer, Saint-Derrien, et Saint-Servais). Landivisiau étant le nom de la ville la plus importante à proximité de la plate-forme militaire. La construction de la piste démarre en 1963 et s'achève deux ans plus tard. Le 1er février 1965, le Général de Gaulle inaugure la nouvelle base. Le 1er septembre 1965, son premier commandant, le CV Roger Jacquin prend officiellement ses fonctions.
L'achèvement de la tour de contrôle permit d'accueillir, pendant 3 mois, le trafic civil à destination de Brest, l'aérodrome de Guipavas étant en réfection. Le 2 mai 1967, la flottille 11.F équipée d'Étendard IVM est la première flottille à être affectée à la B.A.N. Elle est rejointe par la flottille 15.F,
à suivre ...
sources ECPA-D







.JPG)