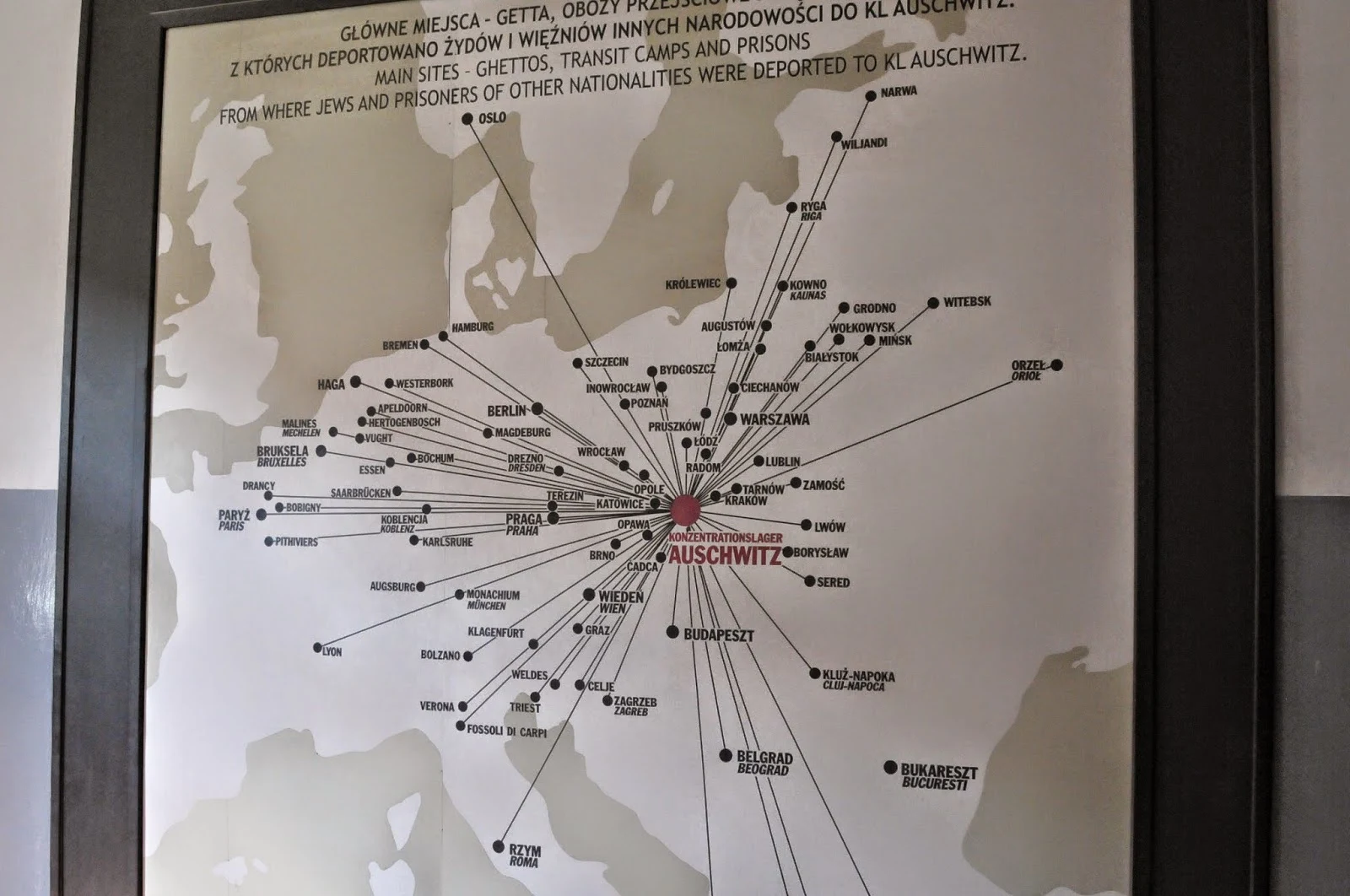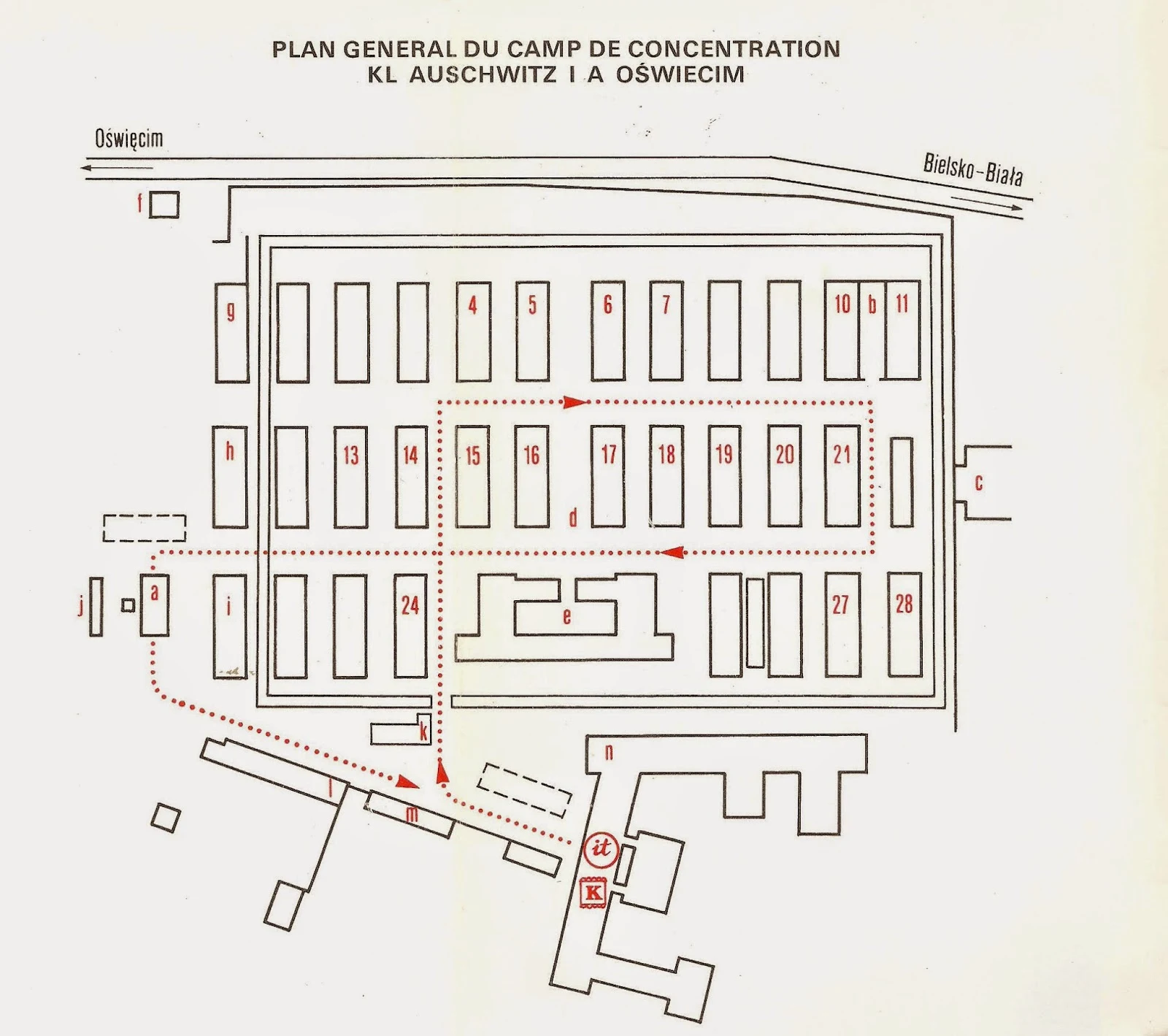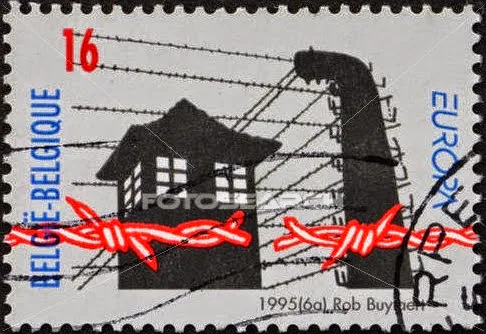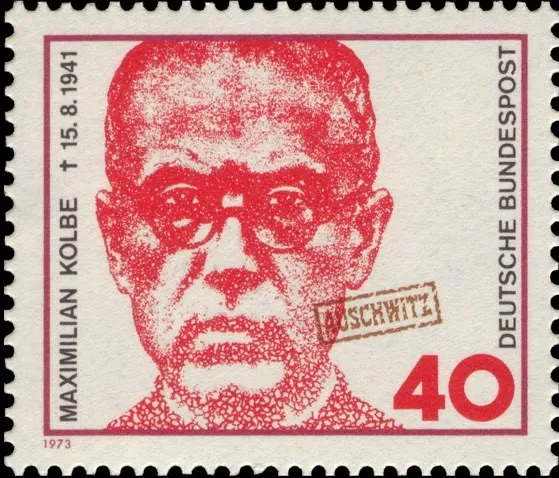Premières Rencontres Philatéliques Rennaises
Espace des deux Rives,
4 rue Georges Palante, 35000 Rennes
24 Janvier 2015
En guise d’introduction….
Il y a trois ans, j’ai rencontré, pour la première fois, Mr Henk SLABBINCK (alors Président de l’Académie Européenne de Philatélie) en Angleterre à Charlecote (près de Stratford-upon-Avon, la ville où est né Shakespeare) lors de la rencontre annuelle de la société anglaise France and Colonies Philatelic Society. Ce jour-là, il présentait sa collection sur le French-Shore. Ce fut un festival de lettres rares ! Et, en particulier, celles allant de France vers des havres comme PORT-SAUNDERS. Il obtint le prix de la meilleure présentation, ce qui n’avait rien d’étonnant.

Henk est d’un naturel agréable et ouvert. Le courant passa tout de suite entre nous deux, et il me proposa, spontanément, de venir à Rennes nous présenter sa collection. Je ne pouvais refuser une telle offre. Passé cette agréable surprise, je me suis inquiété et me disant ‘est-ce possible’?
Les contacts pris avec les différentes organisations philatéliques de Rennes et de son agglomération ont tous été positifs sans réserves.
J’ai ressenti auprès de tous un réel intérêt, et je n’ai pas eu de difficultés pour avoir suffisamment de présentateurs. Les collections présentées lors de ces premières rencontres, d’un excellent niveau philatélique, couvrent une grande partie des différents domaines philatéliques et nous permettront de voyager à travers le monde.

Nous découvrirons ainsi, outre la Grande Pêche, les îles Kerguelen, les « oubliés de St Paul », l’histoire postale du Finistère, de Marseille, la censure au cours da première guerre mondiale, les réformes monétaires en Allemagne après la seconde guerre mondiale, plusieurs collections sur l’Ille et Vilaine (Rennes jusqu’en 1918, les relations internationales de St Malo, un survol en ballon des bureaux de poste de l’Ille et Vilaine), la Révolution dans le Grand-Ouest, les bateaux avions et une collection de papillons afin d’encourager une jeune philatéliste pleine d’espoir.
J’espère que ce programme copieux plaira à tous, et pouvoir continuer les années suivantes avec l’aide de tous.
André MÉTAYER

PRESENTATIONS
Invité d’honneur
H. SLABBINCK (AEP) : La Grande Pêche. Le French-shore
D. ANDRIVON (ARP) : Le courrier à Marseille, des origines à 1876
J.M. BERGOUGNIOU (Philapostel) Les oubliés de Saint Paul
S. CHOISY (ARP) Un droit de regard : la censure militaire française
durant la Première Guerre Mondiale
P. COUESNON (AEP) Les Iles Kerguelen, 1908-1956
F. HENRY (Philapostel) Vignettes et essais expérimentaux
J.R. HAMELOT (SPR) Sélection de lettres de l’Ille et Vilaine
Mlle S. HERY (ARP) Les papillons
G. LEGENDRE (Philapostel & SPR) La Poste à Rennes, des origines à 1914
Dr Y.C. LE VERN (AEP & SPR) Les bateaux-avion
A. METAYER (ARP & SPR) Les relations internationales de St Malo jusqu’à la
fin du 19ème siècle
A. MILONE (ARP) Les conséquences philatéliques de la réforme
monétaire du 21 juin 1948 en Allemagne D. MINGANT (Philapostel) La Poste de l’Ancien régime au département du
Finistère (XVème siècle jusqu’au tarif de
janvier 1849)
Dr C. ROBERT (SPR) Les années de la Révolution dans le Grand-Ouest,
1793-1803

Les associations rennaises participantes
Amicale Rennaise Philatélique
Président :
Réunion : le 3è Dimanche de chaque mois, à 10 h
Salle du Cercle Paul Bert, Rue des Longs Prés, Rennes
Site web : HYPERLINK "
http://philapostelbretagne.wordpress.com
Société Philatélique de Rennes
Président : Jean-René Hamelot
Réunions : le deuxième dimanche de chaque mois
maison de Quartier “la Touche”, 6 rue du Cardinal Paul Gouyon, Rennes.
Site web : HYPERLINK "
http://www.spr.asso.fr/crbst_3.html" http://www.spr.asso.fr/crbst_3.html
Avec le concours du :
Groupement Régional des Associations Philatéliques de Bretagne
Président : Alain Milone
Et l’appui de :
Association Grégorienne de Philatélie
Président : Gérard Jaffray
Réunions : 1er et 3è mardis de chaque mois,
Club Philatélique de Vern
Président : J. Combault
Réunions :
Comité d’organisation
Président : André MÉTAYER
Secrétaire : Stéphane CHABOT
Plaquette et documents: Didier ANDRIVON
Communication: Robert MARQUET et André MÉTAYER
Photographie : Jean-Michel BERGOUGNIOU
Informatique et audio-visuel: André LE TOQUIN et Robert MARQUET
Assistance pause café : Alain MILONE
***************************************