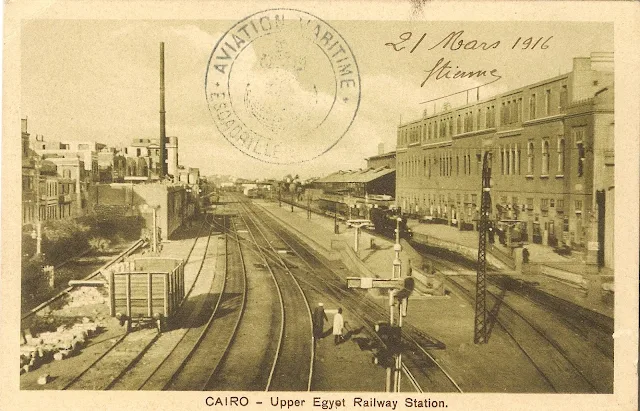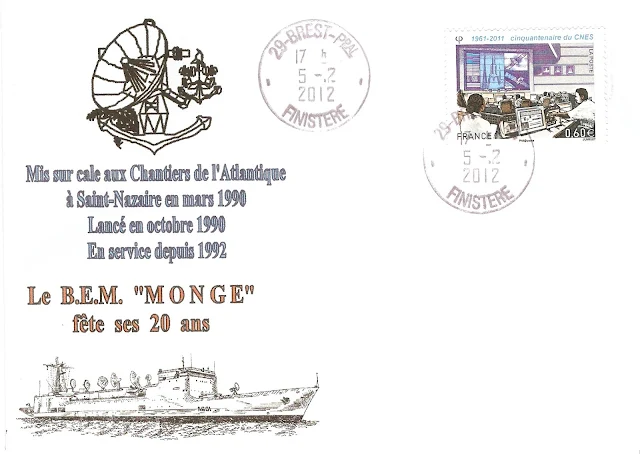Les Corsaires entre Mythe et Réalité
Cherbourg 2013
Le cercle naval de Cherbourg organise du 17 au 23 janvier, une exposition "Les Corsaires entre mythe et réalité"
 |
| Enveloppe en provenance du Cercle de la base de défense de Cherbourg EMA BCRM Cherbourg |
L'exposition est accessible gratuitement à tout public de 14h00 à 17h30 excepté le samedi 19, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Le cercle de la base de défense de Cherbourg organise une exposition intitulée "Les Corsaires : entre Mythe et Réalité" au cercle naval de Cherbourg, place de la République, du 17 au 23 janvier.
Les Corsaires sont évoqués à travers deux aspects : historique et artistique. Pour la partie historique le public pourra consulter une expo traitant des épaves corsaires de la Natière avec une analyse des différents thèmes de la vie des Corsaires du XVIIIème siècle(expo prêtée par le conseil général d'Ille et Vilaine), ainsi que des panneaux consacrés aux corsaires qui vivaient à Cherbourg et à St Vaast La Hougue du XVIIème au XIXème siècle (expo prêtée par le musée de L'ile de Tatihou).
Pour la partie artistique, seront exposées des planches orginales de la bande dessinée l'Epervier, dont le héros est un corsaire du roi Louis XV. sur Cherbourg 1803 - 2012
L'exposition à Rennes présentait 26 documents d'archives, 27 planches et dessins de Patrice Pellerin, 28 photographies d'archéologie sous-marine de Teddy Seguin et 54 objets archéologiques remontés des épaves malouines de la Natière.
Une muséographie originale avec des silhouettes, des fresques, une maquette de bateau et 2 vitrines illustrant le travail du dessinateur et du plongeur archéologue sous-marin viennent enrichir l’exposition.
 |
| Patrick Jusseaume, Patrice Pellerin, Christian Gine en dédicace à bord du TCD Foudre |
L'exposition à Rennes présentait 26 documents d'archives, 27 planches et dessins de Patrice Pellerin, 28 photographies d'archéologie sous-marine de Teddy Seguin et 54 objets archéologiques remontés des épaves malouines de la Natière.
Une muséographie originale avec des silhouettes, des fresques, une maquette de bateau et 2 vitrines illustrant le travail du dessinateur et du plongeur archéologue sous-marin viennent enrichir l’exposition.
- Perdues au pied des roches de la Natière, à l'entrée du port de Saint-Malo, les deux épaves de la Natière ont fait l'objet, de 1999 à 2008, d'une importante fouille archéologique sous-marine.
Avec plus de 3000 objets et fragments significatifs découverts, elles offrent à ce jour la matérialité archéologique la mieux conservée des frégates marchandes et corsaires qui sillonnaient les eaux malouines dans la première moitié du XVIIIe siècle. L’étude de leur charpente révèle ainsi les méthodes et techniques de construction utilisées dans les chantiers royaux et privés, tandis que les objets retrouvés lèvent le voile sur le quotidien des marins et la vie à bord, les circuits économiques et l’équipement des navires.

Déposée par l’État auprès du musée de Saint-Malo, la collection archéologique des objets de la Natière a fait l’objet de longs traitements en laboratoires spécialisés pour être préservée et présentée au public. Elle est dorénavant la plus importante collection archéologique française sur la période et son potentiel muséographique est exceptionnel : des souliers des marins aux canons sur affût placés aux sabords, de la cuisine du bord à la reconstitution des haubans et du gréement..., c’est tout l’armement d’une grande frégate océanique qui peut dorénavant être présentée au public.
Sources
http://www.epaves.corsaires.culture.fr/flash/fr/uc/05_08_02#/fr/uc/05_08_02/t=L’avenir%20d’un%20site