Doryphore,Marcophilie,à vos vaporisateurs!
Même si la ville de Brunswick a été détruite en 1944, je ne suis pas particulièrement admirateur du clocher de St André et la carte ne présente pas un intérêt particulier sur son recto sauf que si on regarde le verso...
de cette carte en franchise militaire (Feldpost) du 1er juillet 1943 présente une oblitération bien frappée présentant un ...doryphore. avec le texte "Lutte contre le Doryphore"
Rappel le Doryphore est un prédateur de la pomme de terre...
L'adulte est un insecte de 10 à 12 mm de long, de forme ovale, fortement bombé sur le dessus. La tête jaune porte une tache frontale en forme de V. Le thorax, brun roux, présente quelques taches noires. Les élytres jaune clair ont chacune cinq bandes noires caractéristiques.
Quand on sait que durant la Seconde Guerre mondiale, dans le France occupée, les soldats allemands étaient surnommés les « doryphores » en raison de leur nombre, cette flamme ne manque pas d'être cocasse...
01 juin 2011
Exposition antibolchévique LYON Mai 1943
Exposition antibolchévique LYON Mai 1943
Ce matin on est un peu loin de la Marine mais toujours en vidant mes soutes j'ai retrouvé ce pli
La propagande est mise au service de l’exclusion de ceux qui sont considérés par le régime comme étant responsables de la défaite de 1940. Cette dernière n’est pas attribuée aux chefs politiques, mais à la Troisième République et au prétendu complot des « forces anti-France » : les étrangers, les communistes, les Francs-maçons et, bien sûr, les Juifs, coupable d’un profond délitement de la société. Les accabler de la responsabilité de la défaite permet au régime de justifier leur arrestation et leur internement. Des expositions anti-Juifs et anti-bolcheviques sont inaugurées par les responsables politiques.
Ma curiosité, lors de l'achat de ce pli, a été attirée par la date de mai 1943 et surtout par le nom de cette rue de Bordeaux qui fait, en pleine occupation et en ce début de déportation des juifs, un magnifique pied de nez au régime de collaboration de l'Etat Français et à Maurice Papon, préfet de Bordeaux depuis 1942.
Beaucoup de ville de France ont une rue faisant référence à l'implantation ancienne des Juifs en France, bien antérieure à leur expulsion au XIV siècle du Royaume de France.
Bordeaux est l'une de ces villes.
Rapide histoire de la rue :
La rue Judaïque tire son nom du « Mont Judaïque », ce modeste monticule de 18 mètre d’altitude qui domine les rives de la Garonne. Pourquoi « Judaïque » ? Parce que jusqu’au début du XIVe siècle, y existait un cimetière dépendant de l’église Saint-Martin où étaient enterrés les juifs de Bordeaux
La partie la plus ancienne de la rue actuelle a été tracée à l’époque romaine, probablement entre le premier et le troisième siècle de notre ère.
Du Ve siècle au milieu du XVIIIe siècle, la rue change de nature, elle devient une partie du chemin qui relie la ville de Bordeaux, enserrée dans ses murailles, au bourg Saint-Seurin qui s’est établi autour de l’église du même nom. La zone est rurale avec de rares maisons, des champs, des établissements religieux et des cimetières . Ce chemin se poursuit au-delà de l’église Saint-Seurin par l’actuelle rue Capdeville vers le Médoc
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population s’accroît rapidement ; de grands travaux d’urbanisme sont entrepris par les intendants du Roi, en particulier Tourny, qui donnent un nouveau visage à Bordeaux... et au faubourg Saint-Seurin qui forme désormais un prolongement continu de la ville
L’urbanisation progresse par étapes alliant initiatives publiques et privées. Les particuliers n’hésitent pas à lotir de nouveaux terrains en respectant l’axe est-ouest prédéfini.
Ainsi, en 1785, Marie Brizard, la créatrice de la célèbre anisette et son neveu Roger, divisent leur propriété en rues publiques et parcelles adjacentes privées en tenant compte du tenant compte du tracé de la future rue Judaïque. C’est l’origine du secteur de la place Dutertre, rues Brizard, Chauffour…
Les parties les plus proches du centre-ville sont les plus densément peuplées et bâties . Les maisons ont façade sur rue ; à l’arrière, elles donnent sur un jardin plus ou moins vaste ; l’ensemble des jardins formant un îlot de verdure qui est une des originalités de l’urbanisme bordelais.
Plus loin s’installent des activités de loisirs ou de services ayant besoin d’espace : manège à chevaux (dont le nom subsiste dans la rue du Manège, école de dressage (1862, à l’emplacement de la piscine Judaïque, ), cimetière protestant (1825-1826), usine à gaz (1825, aujourd’hui remplacée par la gendarmerie nationale). Au niveau de l’actuelle place Dutertre commence alors la commune de Caudéran.
La rue Judaïque finit de s’allonger lorsque les limites de Bordeaux sont enfin fixées par les boulevards en 1865. La décision est prise dès 1853 mais les tractations sont longues car il faut que la commune de Caudéran cède une partie de son territoire. Cette frontière est administrative mais aussi économique : toute marchandise pénétrant en ville doit acquitter une taxe de péage. L’octroi se paye à la barrière Judaïque. Cette zone se construit de la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres . Les parcelles sont plus petites et l’habitat relativement dense.
sources :
http://www.ruejudaique.com/histoire.html
Ce matin on est un peu loin de la Marine mais toujours en vidant mes soutes j'ai retrouvé ce pli
La propagande est mise au service de l’exclusion de ceux qui sont considérés par le régime comme étant responsables de la défaite de 1940. Cette dernière n’est pas attribuée aux chefs politiques, mais à la Troisième République et au prétendu complot des « forces anti-France » : les étrangers, les communistes, les Francs-maçons et, bien sûr, les Juifs, coupable d’un profond délitement de la société. Les accabler de la responsabilité de la défaite permet au régime de justifier leur arrestation et leur internement. Des expositions anti-Juifs et anti-bolcheviques sont inaugurées par les responsables politiques.
Ma curiosité, lors de l'achat de ce pli, a été attirée par la date de mai 1943 et surtout par le nom de cette rue de Bordeaux qui fait, en pleine occupation et en ce début de déportation des juifs, un magnifique pied de nez au régime de collaboration de l'Etat Français et à Maurice Papon, préfet de Bordeaux depuis 1942.
Beaucoup de ville de France ont une rue faisant référence à l'implantation ancienne des Juifs en France, bien antérieure à leur expulsion au XIV siècle du Royaume de France.
Bordeaux est l'une de ces villes.
Rapide histoire de la rue :
La rue Judaïque tire son nom du « Mont Judaïque », ce modeste monticule de 18 mètre d’altitude qui domine les rives de la Garonne. Pourquoi « Judaïque » ? Parce que jusqu’au début du XIVe siècle, y existait un cimetière dépendant de l’église Saint-Martin où étaient enterrés les juifs de Bordeaux
La partie la plus ancienne de la rue actuelle a été tracée à l’époque romaine, probablement entre le premier et le troisième siècle de notre ère.
Du Ve siècle au milieu du XVIIIe siècle, la rue change de nature, elle devient une partie du chemin qui relie la ville de Bordeaux, enserrée dans ses murailles, au bourg Saint-Seurin qui s’est établi autour de l’église du même nom. La zone est rurale avec de rares maisons, des champs, des établissements religieux et des cimetières . Ce chemin se poursuit au-delà de l’église Saint-Seurin par l’actuelle rue Capdeville vers le Médoc
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population s’accroît rapidement ; de grands travaux d’urbanisme sont entrepris par les intendants du Roi, en particulier Tourny, qui donnent un nouveau visage à Bordeaux... et au faubourg Saint-Seurin qui forme désormais un prolongement continu de la ville
L’urbanisation progresse par étapes alliant initiatives publiques et privées. Les particuliers n’hésitent pas à lotir de nouveaux terrains en respectant l’axe est-ouest prédéfini.
Ainsi, en 1785, Marie Brizard, la créatrice de la célèbre anisette et son neveu Roger, divisent leur propriété en rues publiques et parcelles adjacentes privées en tenant compte du tenant compte du tracé de la future rue Judaïque. C’est l’origine du secteur de la place Dutertre, rues Brizard, Chauffour…
Les parties les plus proches du centre-ville sont les plus densément peuplées et bâties . Les maisons ont façade sur rue ; à l’arrière, elles donnent sur un jardin plus ou moins vaste ; l’ensemble des jardins formant un îlot de verdure qui est une des originalités de l’urbanisme bordelais.
Plus loin s’installent des activités de loisirs ou de services ayant besoin d’espace : manège à chevaux (dont le nom subsiste dans la rue du Manège, école de dressage (1862, à l’emplacement de la piscine Judaïque, ), cimetière protestant (1825-1826), usine à gaz (1825, aujourd’hui remplacée par la gendarmerie nationale). Au niveau de l’actuelle place Dutertre commence alors la commune de Caudéran.
La rue Judaïque finit de s’allonger lorsque les limites de Bordeaux sont enfin fixées par les boulevards en 1865. La décision est prise dès 1853 mais les tractations sont longues car il faut que la commune de Caudéran cède une partie de son territoire. Cette frontière est administrative mais aussi économique : toute marchandise pénétrant en ville doit acquitter une taxe de péage. L’octroi se paye à la barrière Judaïque. Cette zone se construit de la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres . Les parcelles sont plus petites et l’habitat relativement dense.
sources :
http://www.ruejudaique.com/histoire.html
31 mai 2011
Croiseur Ecole Jeanne d'Arc 1935
Croiseur Jeanne d'Arc Escale à Seattle 4 janvier 1935
Trouvée sur le site DELCAMPE, cette enveloppe portant le TAD hexagonal du croiseur école Jeanne d'Arc en date du 4 janvier 1935. Ce timbre à date est apposé sur un timbre américain à 3 cents représentant le mont Rainier (Mirror lake at Mount Rainier FDC 3 août 1934)
le croiseur est arrivé à Seattle en provenance de San Francisco le 30 décembre 1934 et a quitté le port le 5 janvier 1935 pour Vancouver. Le timbre à date est donc concordant avec l'escale. Le nom de l'expéditeur au verso domicilié à Seattle est différent de celui du destinataire domicilié dans l’Oregon. On peut penser que ce pli à circulé.
Construit à Saint Nazaire à partir d'août 1928, ce croiseur entre en service le le 6 octobre 1931. C'est le premier bâtiment dédié spécialement à la formation des élèves-officiers de Marine, tout en restant un bâtiment militaire aux qualités reconnues.
Bâtiment de prestige, voué au bals, aux fastueuses réceptions et aux visites de hautes personnalités, le croiseur Jeanne d'Arc fut l'ambassadeur de la France autour du monde.
Basé à Brest, il prend la relève des croiseurs cuirassés Edgar Quinet (1908-1930) et Jeanne d'Arc (1903 - 1933). Ainsi, entre 1931 et 1964, la « Jeanne » reçoit et forme, au cours de 26 campagnes d'application et 751 escales, des milliers d'officiers de Marine et des différents corps.
Du fait des hostilités de la seconde guerre mondiale, le bâtiment connaîtra toutefois une interruption dans le rythme des croisières. En juin 1940, il effectue le convoyage d'une partie des réserves d’or de la Banque de France à Halifax, puis est engagé aux côtés des Alliés à partir de 1943, participant aux opérations en Corse puis en Italie.
sources :
http://www.netmarine.net/bat/croiseur/jeannedarc/index.htm
30 mai 2011
Dernières cérémonies des couleurs La Boudeuse L'Audacieuse
Dernières cérémonies des couleurs P400 L'Audacieuse - La Boudeuse
Les bâtiments désarmés sont des navires dont la Marine n'a plus l'emploi et qui n'ont plus de potentiel. Les navires les plus anciens sont essentiellement des escorteurs d'escadre, des avisos escorteurs, des bâtiments de débarquement de chars, des navires qui constituaient l'ossature de la Marine dans les années 1970.

Jusqu'au début des années 2000, les coques de la Marine, devenues sans emploi , servaient de cibles de tirs pour l'entraînement des forces et la mise au point des systèmes d'armes. Avec une vision volontariste et innovante, la Marine a souhaité inscrire le démantèlement de ses navires dans une perspective de développement durable et de respect de l'environnement. C'est donc aujourd'hui, l'option privilégiée de la Marine. Les métaux qui constituent les coques, acier et cuivre principalement, sont indéfiniment recyclables.
Il y a principalement trois étapes. La première, le désarmement du navire, est une phase de préparation. Un certain nombre d'équipements, de matériels sont retirés du bord. Ensuite, il y a, «l'expertise», une phase comprenant inventaire et cartographie de la coque pour repérer les éventuelles traces d'amiante ou de peintures au plomb. Ceci, afin que la Marine ait l'assurance a l'assurance que le chantier retenu pour la déconstruction, a la capacité de traiter les polluants à bord, et qu'il n'exposera pas son personnel par méconnaissance. Ce qui nous amène à la dernière étape, le démantèlement proprement dit par appel d'offres par bateau ou groupe de bateaux.
http://www.defense.gouv.fr/marine/enjeux/environnement/deconstruction-des-batiments/approche-de-la-marine-pour-le-demantelement-des-batiments-retires-du-service-actif
Missions de protection :
- Patrouille
- Contrôle d'embargo
- Action de souveraineté
- Transport de commandos
- Missions de service public :
- Secours en mer
- Police de la navigation
- Police des pêches
- Assistance aux zones isolées
- Transports légers inter-insulaires
- Lutte contre les trafics
- Lutte antipollution
 |
| L'Audacieuse Dernière cérémonie des couleurs photo PSB Claude Bélec |
L'Audacieuse est le prototype de la série des dix patrouilleurs de la Marine nationale du type P 400 destinés aux tâches de protection des zones économiques exclusives ou de service public.- Mis en chantier le 11 avril 1983
- Lancé le 21 mars 1984
- Admis au service actif le 18 septembre 1986.
- Il est affecté en Guyanne à Dégrad des Cannes de l'été 2003 à l'été 2005
 |
| L'Audacieuse Dernière cérémonie des couleurs photo PSB Claude Bélec |
Les bâtiments désarmés sont des navires dont la Marine n'a plus l'emploi et qui n'ont plus de potentiel. Les navires les plus anciens sont essentiellement des escorteurs d'escadre, des avisos escorteurs, des bâtiments de débarquement de chars, des navires qui constituaient l'ossature de la Marine dans les années 1970.

- La Boudeuse est la 2ème unité de la série des dix patrouilleurs de la Marine nationale du type P 400 destinés aux tâches de protection des zones économiques exclusives ou de service public.
- Mis en chantier le 15 juin 1983
- Lancé le 29 mai 1984
- Admis au service actif le 15 janvier 1987
- De 1998 à 2010 Elle est affectée à La Réunion (Ports-des-Galets). Le 31 août 2010, La Boudeuse rallie Brest pour y entamer les opérations de désarmement. Elle est mise en complément le 1er septembre 2010.
 |
| La Boudeuse dernière cérémonie des Couleurs photo Yann Le Ny |
Jusqu'au début des années 2000, les coques de la Marine, devenues sans emploi , servaient de cibles de tirs pour l'entraînement des forces et la mise au point des systèmes d'armes. Avec une vision volontariste et innovante, la Marine a souhaité inscrire le démantèlement de ses navires dans une perspective de développement durable et de respect de l'environnement. C'est donc aujourd'hui, l'option privilégiée de la Marine. Les métaux qui constituent les coques, acier et cuivre principalement, sont indéfiniment recyclables.
 |
| La Boudeuse photo MP Yann Le Ny |
Il y a principalement trois étapes. La première, le désarmement du navire, est une phase de préparation. Un certain nombre d'équipements, de matériels sont retirés du bord. Ensuite, il y a, «l'expertise», une phase comprenant inventaire et cartographie de la coque pour repérer les éventuelles traces d'amiante ou de peintures au plomb. Ceci, afin que la Marine ait l'assurance a l'assurance que le chantier retenu pour la déconstruction, a la capacité de traiter les polluants à bord, et qu'il n'exposera pas son personnel par méconnaissance. Ce qui nous amène à la dernière étape, le démantèlement proprement dit par appel d'offres par bateau ou groupe de bateaux.
http://www.defense.gouv.fr/marine/enjeux/environnement/deconstruction-des-batiments/approche-de-la-marine-pour-le-demantelement-des-batiments-retires-du-service-actif
B.E.M. MONGE Mission Coriolis
B.E.M. MONGE Mission Coriolis
Pourquoi les nuages s'enroulent-ils toujours dans le même sens autour des cyclones ? Les lavabos se vident-ils dans des sens opposés à l'Hémisphère Nord et à l'Hémisphère Sud ? Et à l'équateur ? Le nom de « force de Coriolis » est généralement associé à ces problèmes, mais les mécanismes détaillés de ces phénomènes restent la plupart du temps méconnus.
pour comprendre ce qu'est l'effet de CORIOLIS, vous pouvez aller sur le site ci-dessous qui est plus clair que Wikipédia
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/vent/p_vent2_corio.htm
photos JM Bergougniou
Pourquoi les nuages s'enroulent-ils toujours dans le même sens autour des cyclones ? Les lavabos se vident-ils dans des sens opposés à l'Hémisphère Nord et à l'Hémisphère Sud ? Et à l'équateur ? Le nom de « force de Coriolis » est généralement associé à ces problèmes, mais les mécanismes détaillés de ces phénomènes restent la plupart du temps méconnus.
pour comprendre ce qu'est l'effet de CORIOLIS, vous pouvez aller sur le site ci-dessous qui est plus clair que Wikipédia
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/vent/p_vent2_corio.htm
photos JM Bergougniou
PA Charles De Gaulle
PA Charles de Gaulle 10 ans d'opérations
Il y a 10 ans en 2001
L'agence postale ouverte le 1er février 1997 (date du TAD) était dotée d'une machine pour les oblitérations mécaniques le 18 avril 2001
 |
| 10 ans d'opérations |
Il y a 10 ans en 2001
 |
| Carte chinoise présentant le Charles de Gaulle. |
 |
| premier jour de la flamme rectifié |
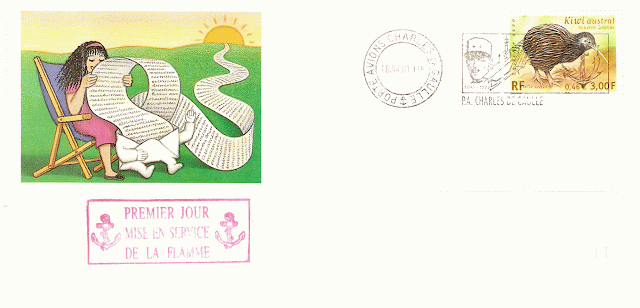 |
| montage erroné de la couronne de la flamme, on dira rien! |
 |
| admission au service actif le 18 mai 2001 |
Chroniques Aéro
Gazette N° 78
Section Aéronautique Navale du 1er juin 2011 par Olivier
Section Aéronautique Navale du 1er juin 2011 par Olivier
100.000 heures de vol de la Flottille 34 F
L’information m’avait été communiquée par l’Officier communication de la B.A.N. de Lanvéoc Poulmic. Après plusieurs contacts avec la Flottille, l’Officier chargé de la manifestation m’a indiqué que cette manifestation reste d’ordre privée et qu’elle est destinée uniquement aux anciens de la Flottille.
Les Rafolies
J’ai découvert ces cartes dans la Gazette « ARDHAN » diffusée par son Secrétaire Général Monsieur FEUILLOY, QU’EN PENSEZ-VOUS ??????
Guy VAUGEOIS
Jean Pierre BOESPFLUG
150.000 heures de vol de l’Escadrille 22 S
De nombreuses personnes ont reçu les enveloppes avec le cachet spécial et l’oblitération de Lanvéoc.
Le cachet spécial a été utilisé par le Commandant de l’Escadrille pour le courrier d’invitations à la manifestation ce cachet a été également utilisé pour les badges destinés aux visiteurs.
Pour la manifestation l’Escadrille a fait réaliser un « Patch couleur », j’en ai donc profité pour faire imprimer des enveloppes avec le « Patch couleur »
L’enveloppe imprimée est vendue 3,00 Euros + le port. Commande à LAUDRIN Olivier 7- Chemin du Grand Kervao 29200 BREST. Chèque au nom de la Marcophilie Navale.
Pour l’occasion une Alouette III de l’Escadrille avait été mise aux couleurs de la fête. Photo O. LAUDRIN
Prochaine Gazette le 1er juillet
Bien amicalement
O. LAUDRIN
Inscription à :
Commentaires (Atom)
Tromelin Marion Dufresne OP4 2025 30-11-2025 T.A.A.F. Îles Eparses
Tromelin, un îlot stratégique au coeur des enjeux géopolitiques français OP4 2025 30-11-2025 Perdue dans l’immensité de l’océan Indien, l’î...

-
Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...
-
le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...
-
L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...





















