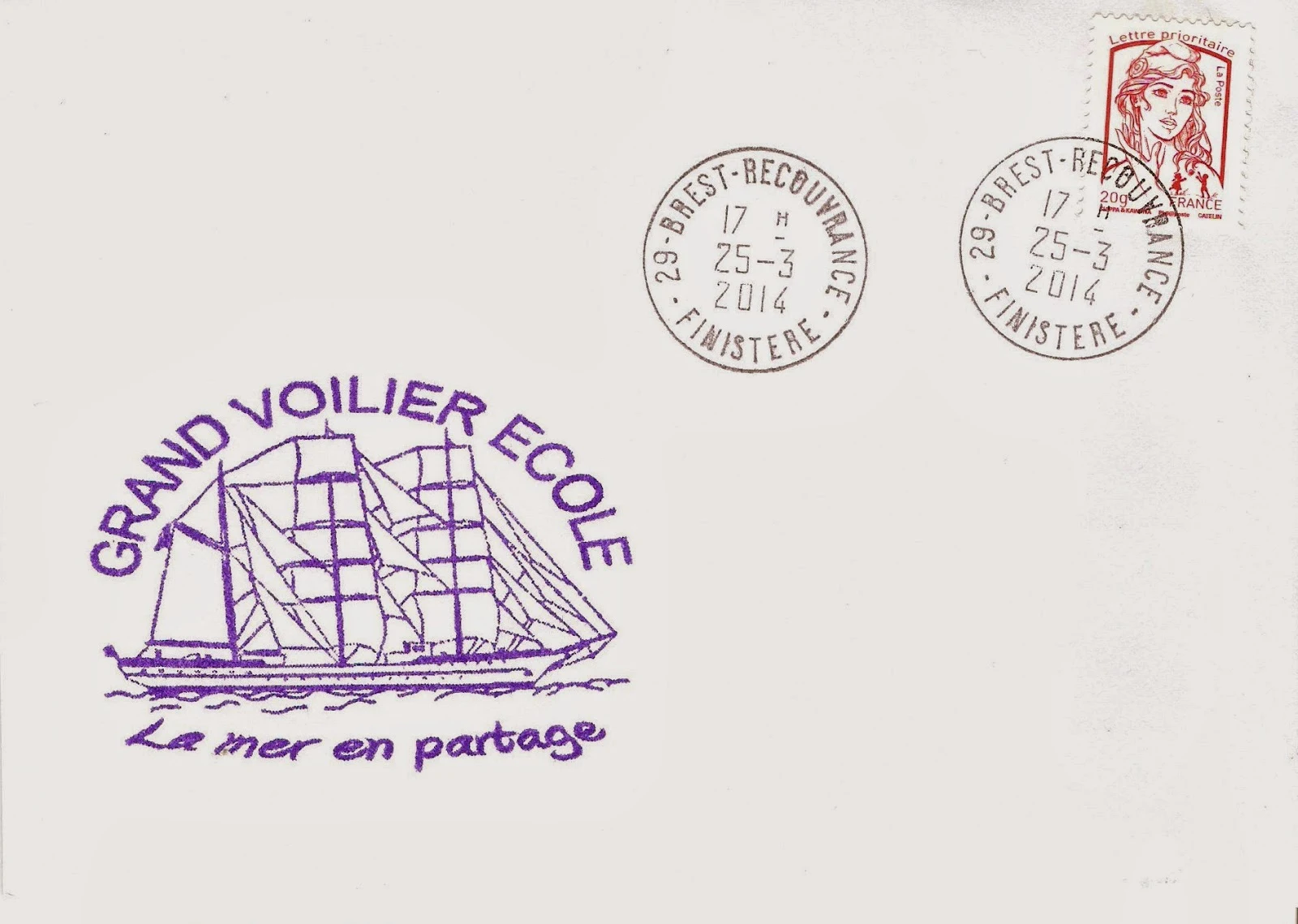Les 60 ans de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Information provenant du CDT BOHLY Jean-Louis de PARIS
C'est le 22 novembre 1954 qu'une instruction ministérielle décide de la création d'un commandement de l'aviation légère de l'armée de Terre "dans le but de coordonner les doctrines d'instruction et d'emploi des formations d'aviation légère de terre ".
L'ALAT souffle donc cette année 2014 ses 60 bougies. En fait, c'est depuis plus de 60 ans qu'avions, puis hélicoptères se sont rendus indispensables à l'armée de Terre et à notre pays. Plus que jamais, les hélicoptères jouent un rôle majeur dans les crises et les conflits modernes. Leurs capacités intrinsèques, celle en particulier de s'affranchir des obstacles, leur don d'ubiquité, la performance et la précision de leurs armements en font une arme redoutable et redoutée, mais aussi souvent le dernier espoir de tous ceux qui sont en détresse. Comme je n'ai jamais cessé de le répéter dans ma carrière, tout ceci ne s'est pas fait tout seul. C'est surtout en particulier le résultat de la clairvoyance et de la ténacité des premiers chefs de l'ALAT, comme les généraux Paul Lejay et Jacques Navelet, et aussi bien sûr de tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi et donné leur vie sous le "béret bleu".
En 1977, le général Lejay écrivait dans un article : "Je sais cependant qu'elle (l'ALAT) a acquis une sécurité et une importance qui contrastent heureusement avec les conditions dans lesquelles elle a dû si longtemps frayer sa voie, sous la menace constante d'une remise en cause de son existence même".
En 2011, le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général d'armée Ract-Madoux, avait dit dans son ordre du jour, en parlant des médailles qu'il venait de décerner à des étendards et des personnels de l'ALAT : "Elles mettent en valeur la justesse des choix faits par nos anciens en termes d'équipements, de tactique et de doctrine, ainsi que la qualité de la préparation opérationnelle de nos armées, conduite ici même, en métropole, notamment dans nos centres de formations et dans nos régiments. C'est grâce à ce travail rigoureux et minutieux qu'a pu se forger cet outil de combat efficace et redoutable, apte à faire face d'emblée aux situations les plus exigeantes et à les dominer dans la durée."

De nombreuses manifestations sont programmées cette année :
04 mai 2014
Semi-marathon DAAT Dét. Avions de l’Armée de Terre - Rennes
14 et 15 juin 2014
14 et 15 juin 2014
J Portes Ouvertes 1er Rég. d’Hélicoptères de Combat - Phalsbourg
15 au 21 juin 2014
15 au 21 juin 2014
Salon Aéronautique Le Bourget
28 et 29 juin 2014
28 et 29 juin 2014
Meeting des 60 ans EALAT – BEGL Le Cannet des Maures
28 et 29 juin 2014
28 et 29 juin 2014
Fête de l’Hélicoptère EALAT – BEGN Dax
14 juillet 2014
14 juillet 2014
Scénographies Les Invalides
20 et 21 sept. 2014
20 et 21 sept. 2014
J Portes Ouvertes 5ème Rég. d’Hélicoptères de Combat - Pau
28 sept. 2014 J Portes Ouvertes GAMSTAT – Valence
28 sept. 2014 J Portes Ouvertes GAMSTAT – Valence
L'ALAT est devenue au fil des années et de l'histoire militaire de notre pays une composante indispensable et incontournable de l'armée de Terre. Les opérations récentes en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Lybie (lire"De la terre, par le ciel" éd. Economica), celles antérieures au Kosovo, en ex-Yougoslavie ou encore au Tchad, et bien sûr, celles en cours au Mali et en République Centre-Africaine, ont démontré et démontrent tous les jours la pertinence de détenir un tel outil de combat. Cette composante "aérocombat" est enviée par de nombreux pays dans le monde entier et sert de modèle pour un certain nombre d'entre eux.
Dans les pas de leurs Anciens, les bérets bleus continuent à être présents là où le devoir les appelle. Que ce soit dans la fournaise des combats, celle des incendies de forêts l'été, lors de catastrophes naturelles comme le terrible drame de Draguignan en juin 2010, les femmes et les hommes de l'ALAT seront toujours fidèles au refrain de leur chant de tradition, "L'azur de nos bérets".
Secourir, appuyer, en toutes circonstances,
Equipages de l'ALAT,
Au service de la France,
Sur les têtes alignées, évoquant son appel,
L'azur de nos bérets nous dévoile le ciel.
O, Sainte Clotilde, du péril garde nous,
Demeure notre guide, du trépas
Défend-nous.
GDI (2s) Yann Pertuisel
Ancien commandant de l’ALAT
Tiré de l’Epaulette n° 184 - Mars 2014
www.lepaulette.com
texte intégral de l'article
L'ALAT, 1954-2014, fête ses 60 bougies
une composante indispensable de l'armée de Terre
C'est le 22 novembre 1954 qu'une instruction ministérielle décide de la création d'un commandement de l'aviation légère de l'armée de Terre "dans le but de coordonner les doctrines d'instruction et d'emploi des formations d'aviation légère de terre ".
L'ALAT souffle donc cette année 2014 ses 60 bougies. En fait, c'est depuis plus de 60 ans qu'avions, puis hélicoptères se sont rendus indispensables à l'armée de Terre et à notre pays. Plus que jamais, les hélicoptères jouent un rôle majeur dans les crises et les conflits modernes. Leurs capacités intrinsèques, celle en particulier de s'affranchir des obstacles, leur don d'ubiquité, la performance et la précision de leurs armements en font une arme redoutable et redoutée, mais aussi souvent le dernier espoir de tous ceux qui sont en détresse. Comme je n'ai jamais cessé de le répéter dans ma carrière, tout ceci ne s'est pas fait tout seul. C'est surtout en particulier le résultat de la clairvoyance et de la ténacité des premiers chefs de l'ALAT, comme les généraux Paul Lejay et Jacques Navelet, et aussi bien sûr de tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi et donné leur vie sous le "béret bleu".
En 1977, le général Lejay écrivait dans un article : "Je sais cependant qu'elle (l'ALAT) a acquis une sécurité et une importance qui contrastent heureusement avec les conditions dans lesquelles elle a dû si longtemps frayer sa voie, sous la menace constante d'une remise en cause de son existence même".
En 2011, le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général d'armée Ract-Madoux, avait dit dans son ordre du jour, en parlant des médailles qu'il venait de décerner à des étendards et des personnels de l'ALAT : "Elles mettent en valeur la justesse des choix faits par nos anciens en termes d'équipements, de tactique et de doctrine, ainsi que la qualité de la préparation opérationnelle de nos armées, conduite ici même, en métropole, notamment dans nos centres de formations et dans nos régiments. C'est grâce à ce travail rigoureux et minutieux qu'a pu se forger cet outil de combat efficace et redoutable, apte à faire face d'emblée aux situations les plus exigeantes et à les dominer dans la durée."
Au commencement
Depuis très longtemps déjà, les militaires avaient cherché à se doter de moyens "plus légers que l'air" pour améliorer leurs capacités de combat. C'est lors de la bataille de Fleurus, le 26 juin 1794, que, pour la première fois dans l'histoire, un ballon d'observation ("l'Entreprenant") est utilisé pour renseigner sur le dispositif adverse. Cet aérostat, avec à son bord le capitaine Coutelle, permet de connaître parfaitement le dispositif ennemi et, de plus, affecte sérieusement son moral. Avec l'avènement de l'ALOA (Aviation Légère d'Observation d'Artillerie), plus de deux siècles après, dénommée un peu plus tard ALAT, et surtout les progrès de la technique, cette troisième dimension du combat prendra son véritable envol et donnera naissance à l'aérocombat d'aujourd'hui.
On pourrait encore citer comme référence historique le siège de Paris en 1870 et cette fois-ci l'utilisation d'un ballon pour "l'extraction" de Léon Gambetta. Nos forces spéciales et son 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces Spéciales ne font-ils pas la "même chose" aujourd'hui lorsqu'ils évacuent une très haute personnalité dans des situations de crise ? Le Caracal a remplacé le ballon...
Utilisés massivement pendant la Première Guerre mondiale, les ballons seront progressivement remplacés par des "aéroplanes", puis des avions, aux capacités nettement supérieures. Là encore, le souci du renseignement et de l'observation pour le réglage des tirs d'artillerie est permanent et ces "drôles de machines volantes" sont d'un précieux secours pour ceux qui combattent au sol. Ce besoin n'ira qu'en s'amplifiant lors de la Seconde Guerre mondiale.
Les pionniers
C'est ainsi qu'à partir de 1943 les forces françaises sont progressivement équipées par l'allié américain. Les premiers avions Piper Cub sont mis en service dans les groupes d'artillerie au sein de SOAA (Section d'Observation d'Aviation d'Artillerie). Ils sont alors pilotés par des aviateurs qui sont rapidement renforcés par quelques "biffins" titulaires de brevets civils. les missions d'observation et de réglage des tirs à bord des appareils sont exclusivement réservées à des officiers d'artillerie. Environ 150 avions participent ainsi en particulier à la campagne d'Italie et aux combats des Vosges et d'Alsace.
A la fin de la guerre naissent alors des "tiraillements" entre l'armée de l'Air et l'armée de Terre car les premiers demandent que ces unités soient confiées à des aviateurs, alors qu'elles accomplissent des missions exclusivement au profit des seconds. A la fin de la guerre, les "éléments air" de l'aviation d'observation d'artillerie sont répartis entre la France, l'Afrique du Nord, l'Allemagne et l'Indochine. En général, à cette époque, le personnel de l'AOA porte l'insigne du régiment ou du groupe d'artillerie auquel il est rattaché, à l'exception de quelques-uns qui en font réaliser un distinctif.
L'Indochine
C'est à l'été 1945 qu'il est décidé que l'artillerie du corps expéditionnaire en Indochine sera dotée d'une "aviation légère" équipée de Piper L4 et de Morane 500 Criquet, (appelé "Trapanelle" et version du célèbre avion allemand Fieseler Storch), principalement regroupés en groupes aériens d'observation d'artillerie (GAOA). Le 1er GAOA arrive en février 1946 au Tonkin. Le 2e GAOA rejoint quant à lui la Cochinchine en mars de la même année. C'est en 1947 que le peloton de la 9e division d'infanterie coloniale devient le 3eGAOA, stationné à Haïphong. Malheureusement, le mauvais état général des avions à leur arrivée sur le territoire et un usage intensif les clouent rapidement au sol.
En 1949, la direction du service de santé demande des hélicoptères pour assurer les évacuations sanitaires. Ainsi, deux Hiller UH 12 sont livrés et marquent le tout début de l'emploi opérationnel des hélicoptères. Comme aujourd'hui sur les théâtres d'opérations le font leurs fiers "descendants" Puma, Cougar ou Caracal(et demain Caïman), ils contribuent fortement au moral des combattants au sol.
En 1952, les GAOA prennent les numéros 21, 22 et 23 et sont composés d'une vingtaine d'appareils. Cette même année, le 3 mars, est créée officiellement l'ALOA et dès l'année suivante les premiers pilotes et mécaniciens de l'armée de Terre remplacent progressivement ceux de l'armée de l'Air. Le 1er janvier 1954, les GAOA sont entièrement pris en compte par les forces terrestres. Dans le courant de cette année, lesCessna L19 A arrivent en Indochine avant d'être rapatriés, avec le reste des formations, en métropole et enAfrique du Nord après le cessez-le-feu.
L'Algérie
C'est en Algérie que va véritablement naître et se développer le concept d'aéromobilité qui deviendra quelques années plus tard celui d'aérocombat. Face à l'augmentation rapide des opérations, de nouveaux pelotons d'avions sont créés au sein des divisions, en complément des GAOA déjà déployés. Ces pelotons, avec leurs Piper L18, L19 et L21, sont désignés en particulier à l'observation et au guidage de la Chasse.
Mais c'est leur besoin de mobilité et de transport des unités terrestres qui va surtout marquer une évolution importante de l'emploi des hélicoptères. C'est le célèbre groupe d'hélicoptères N° 2 (GH2) du chef de bataillon Crespin qui va prendre cette mission à son compte avec les non moins célèbres "Bananes" (Vertol H21).
1957 voit la conception de deux hélicoptères français, le Djinn et l'Alouette II. En 1959, des pelotons mixtes avions-hélicoptères sont constitués au sein des divisions. Des pilotes formés en métropole rejoignent les artilleurs qui composaient majoritairement les unités. Fantassins et cavaliers arrivent donc dans l'ALAT, mais aussi des appelés du contingent, détenteurs du "deuxième degré" civil, et chargés, quant à eux, des liaisons avec desL18.
En 1961, ce sont près de 700 avions et hélicoptères qui servent en Algérie et plus de 570 en France...
La Guerre froide
Les années 60-70 vont être celles de la montée en puissance de la lutte anti-char avec le développement des missiles filoguidés.
Les unités rentrées d'Algérie forment désormais des GALDIV (Groupe d'aviation légère divisionnaire) regroupant une vingtaine d'avions et autant d'hélicoptères. Progressivement, lesAlouette III équipent les unités, armées de missiles anti-char SS11. Pour ce qui est des hélicoptères de transport, les Puma vont remplacer quant à eux les fameuses "Bananes" et les bons vieux Sikorski (les "Siko").
Les avions NC 856 et Piper L21B sont retirés du service en 1970, année qui voit le virage définitif vers une ALAT principalement dotée de "voilures tournantes". Mais quelques "voilures fixes" seront encore mises en œuvre dans certaines unités, lesGALREG (Groupe d'aviation légère régionale) par exemple, comme le célèbre (lui aussi)Broussard, ou encore des L19E.
Après le Puma, "bête de somme" de l'ALAT qui vole encore aujourd'hui, ce sont les Gazelle qui entrent en service, en remplacement des Alouette III.
Une adaptation permanente
1977 marque un nouveau tournant dans l'histoire de l'ALAT avec la création des régiments d'hélicoptères de combat (RHC) à partir des GALCA et GALDIV. Les GALREG, quant à eux, deviennent des GHL (Groupe d'hélicoptères légers), chargés en particulier d'assurer les missions d'aide au commandement.
En 1983, l'ALAT engage une trentaine d'appareils au Tchad dans l'opération "Manta". A la même époque, une "brigade aéromobile expérimentale" (BAE) est mise sur pied avec les 1er et 3e RHC, ainsi que le 1er RI. Cette expérimentation donnera naissance à la 4e DAM le 1er juillet 1985, qui intégrera en plus le 5e RHC et le 4e RHCMS, puis le 9e RSAM (régiment de soutien aéromobile) de Phalsbourg et le 1er RI (régiment d’infanterie) de Sarrebourg. C'est donc une formidable force de frappe anti-char qui est capable de s'opposer aux unités blindées du Pacte de Varsovie, avec 360 missiles HOT en ordre de tir simultanément ! Dans le même temps, le GRICA (Groupement de reconnaissance et d'intervention du 1er corps d'armée), puis le GISCA (Groupement d'intervention et de sûreté du 3e corps d'armée), constitués respectivement des 7e RHC et 8e RH (Régiment de hussards), et des 6e RHC et 2e RH, sont créés. Ce sont alors quelque 700 hélicoptères qui sont mis en œuvre dans l'ALAT, que ce soit au sein des forces ou pour la formation.
Les appareils sont sans cesse modernisés et de nouveaux armements voient le jour, comme le missile air-airMistral.
La BAM succédera à la DAM et sera engagé au sein de la division Daguet pendant la guerre du Golfe. 60 Gazelle HOT participeront en particulier à l'offensive terrestre, détruisant plus de 120 objectifs.
Enfin, les années 90 voient le développement du vol de nuit avec des moyens de vision nocturne, les "jumelles de vision nocturne". Là aussi, couplé au VOLTAC, le vol avec JVN va devenir une "seconde nature" pour tous les équipages de l'ALAT qui vont véritablement pouvoir combattre la nuit comme le jour.
L'ALAT aujourd'hui
L'ALAT, c'est aujourd'hui trois RHC, le 1er à Phalsbourg, le 3e à Etain, le 5e à Pau et le 4e RHFS à Pau également. Mais l'ALAT, c'est aussi une école, l'EALAT, répartie sur deux sites, à Dax et au Cannet des Maures. A cette école, il faut ajouter, pour la formation des pilotes de Tigre, l'école franco-allemande (EFA), avec son pendant en Allemagne à Fassberg où sont formés les mécaniciens, et le centre de formation interarmées (CFIA) pour l'ensemble du personnel de mise en œuvre du Caïman, tous deux au Cannet des Maures. L'ALAT, c'est encore une unité chargée d'expérimenter et de qualifier tous les nouveaux équipements, le GAMSTAT, à Valence. Sans oublier un bataillon de soutien aéromobile, le 9e BSAM implanté à Montauban et dont la mission est le soutien opérationnel des appareils.
Alors que les avions étaient largement majoritaires au tout début, il en reste quand même un tout petit nombre avec 8 TBM 700 basés à Rennes et 5 PC6 Pilatus à Montauban.
Les bérets bleus sont aujourd'hui environ 5 000 hommes et femmes, dont seulement un cinquième est "personnel navigant". Car, faut-il le préciser, l'ALAT ce n'est pas seulement des pilotes, mais c'est aussi des mécaniciens, des contrôleurs de la circulation aérienne, des météorologistes, des instructeurs simulation, des pompiers et bien sûr, du personnel administratif.
C'est une flotte d'environ 300 appareils qu'elle met en œuvre, appareils encore d'ancienne génération pour une bonne partie comme la Gazelle ou le Puma, de génération "intermédiaire" avec le Cougar et le Caracal, et bien sûr de nouvelle génération avec le Tigre et la Caïman. S'agissant du Tigre, la version HAD (Hélicoptère d'appui destruction) va prochainement être livrée au 1er RHC pour commencer. Cette version diffère principalement du HAP (Hélicoptère d'appui protection) par la présence de missile air-sol Hellfire. Ce sont au total 60 Tigre qui équiperont l'ALAT.
Arme à part entière de l'armée de Terre (comme l'Infanterie, la Cavalerie, le Génie,...) depuis maintenant une dizaine d'années, l'ALAT, comme les autres Armes, a son "Père de l'Arme", le général COMALAT, garant de sa cohésion et gardien de ses traditions. Sa devise, "De la terre, par le ciel", rappelle que c'est à l'armée de Terre qu'elle est viscéralement attachée (au sens propre comme au sens figuré) et que c'est bien sûr par les airs qu'elle combat aux côtés de ses frères d'armes. Comme les autres Armes également, l'ALAT a un Saint-Patron, en l'occurrence, une Sainte-Patronne : Sainte Clotilde.
Bien qu'Arme jeune, elle cultive son histoire (pour en savoir plus, lire "L'histoire de l'ALAT 1794-2014" par le général André Martini - éd. Lavauzelle - ou le site 3w.alat.fr de M. Christian Malcros) et son patrimoine, en particulier par l'intermédiaire de son magnifique "Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère" à Dax (3w.museehelico-alat.com). Ses Vétérans sont réunis au sein de l'UNAALAT (3w.unaalat.fr) et son association d'Entraide, l'Entraide ALAT (3w.entraidalat.fr), est une des six associations d'Entraide de l'armée de Terre.
L'ALAT est devenue au fil des années et de l'histoire militaire de notre pays une composante indispensable et incontournable de l'armée de Terre. Les opérations récentes en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Lybie (lire"De la terre, par le ciel" éd. Economica), celles antérieures au Kosovo, en ex-Yougoslavie ou encore au Tchad, et bien sûr, celles en cours au Mali et en République Centre-Africaine, ont démontré et démontrent tous les jours la pertinence de détenir un tel outil de combat. Cette composante "aérocombat" est enviée par de nombreux pays dans le monde entier et sert de modèle pour un certain nombre d'entre eux.
Dans les pas de leurs Anciens, les bérets bleus continuent à être présents là où le devoir les appelle. Que ce soit dans la fournaise des combats, celle des incendies de forêts l'été, lors de catastrophes naturelles comme le terrible drame de Draguignan en juin 2010, les femmes et les hommes de l'ALAT seront toujours fidèles au refrain de leur chant de tradition, "L'azur de nos bérets".
Equipages de l'ALAT,
Au service de la France,
Sur les têtes alignées, évoquant son appel,
L'azur de nos bérets nous dévoile le ciel.
O, Sainte Clotilde, du péril garde nous,
Demeure notre guide, du trépas
Défend-nous.
GDI (2s) Yann Pertuisel
Ancien commandant de l’ALAT
Tiré de l’Epaulette n° 184 - Mars 2014
3w.lepaulette.com