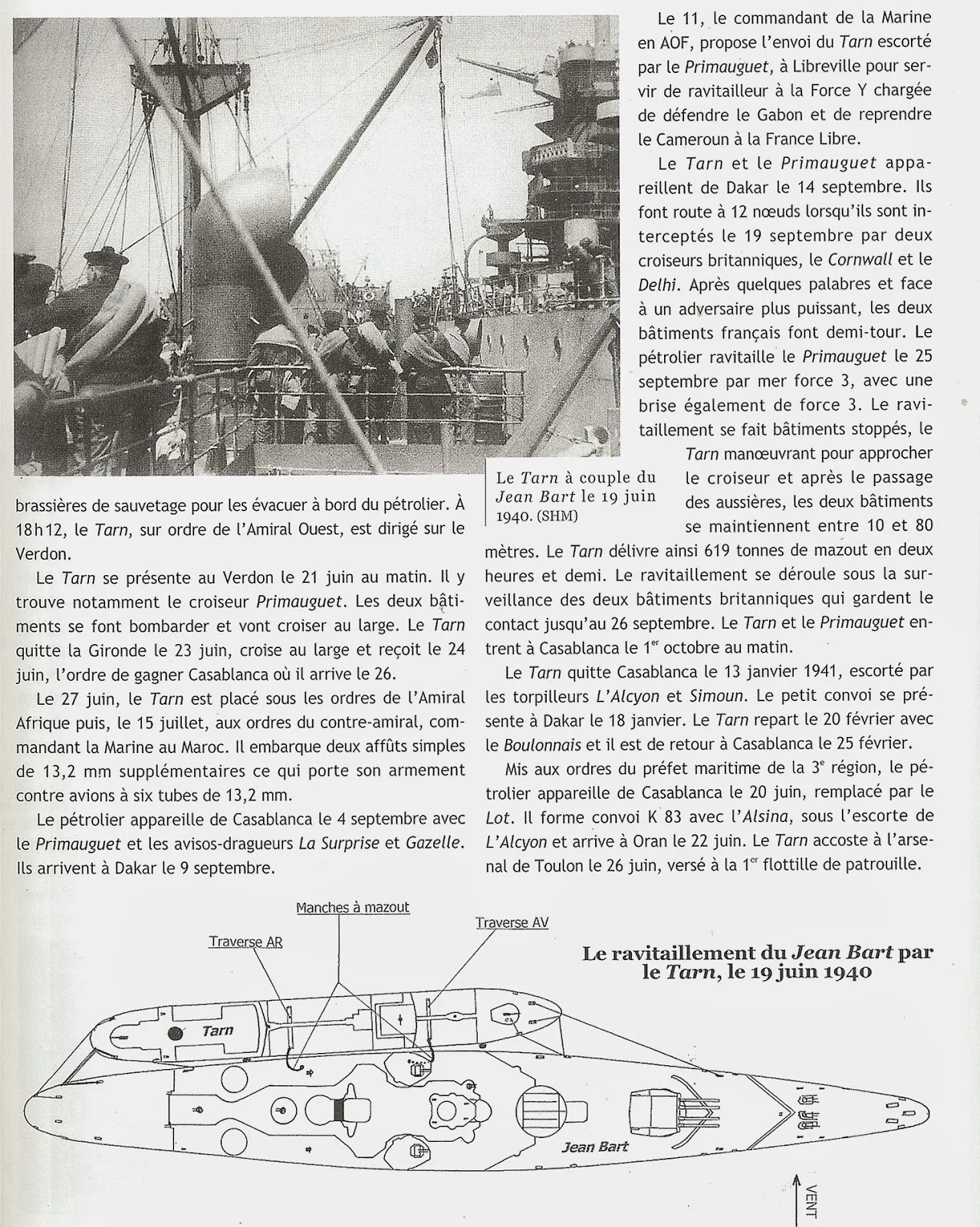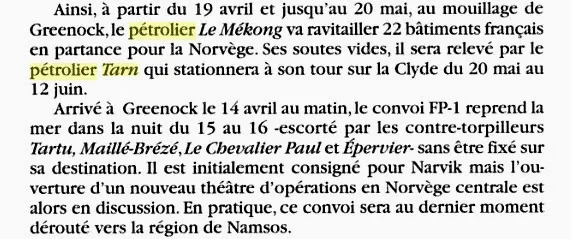TAAF CROZET
La gérance postale d'ALFRED FAURE
Le blog du chef de district de CROZET présente la gérance postale de Crozet.
Patrick est un homme très sollicité. Chef du Bureau Communications Réseaux (BCR), il est également le Gérant Postal (GP) de la base Alfred Faure.
 |
| Patrick, le Gérant postal - photo Serge FUSTER |
Dans ce cadre, il assure la vente de tous les produits nécessaires aux activités postales.

Ainsi, à chaque OP, il reçoit une dizaine de sacs (entre 10 et 20 kg chacun) de courriers et de colis et il en expédie cinq ou six selon la période.

 |
| Les casiers de stockage des plis en attente |
Des philatélistes du monde entier font parvenir à la Gérance Postale des courriers pré-timbrés, pour que le GP y applique les tampons des hivernants, le timbre à date correspondant au passage d'un bateau particulier et le cachet de positionnement (coordonnées géographiques de la base). Certains plis attendent pendant des mois, dans les casiers dédiés, le passage du bateau souhaité afin d'être tamponnés par le cachet du capitaine ou du commandant.
 |
| Patrick conserve sur son bureau les différents tampons personnalisés des hivernants |
Le Gérant Postal accueille les marins, les passagers et les touristes de passage sur Crozet, qui souhaitent acheter des timbres, des cartes postales ou des enveloppes illustrées.
La collection de timbres est renouvelée chaque année.
Les 1500 lettres qui sont déposées en moyenne chaque mois à la Gérance Postale sont oblitérées à l'aide de deux machines : un ancien modèle manuel de machine SECAP et une machine électrique plus récente de marque SATAS.
 |
| L'ancienne machine à oblitérer SECAP |
 |
| Flamme de l'ancienne machine manuelle SECAP |
A l'occasion d'évènements particuliers, le Gérant Postal édite des enveloppes spéciales, avec des photos imprimées illustrant l'actualité concernée.
Ces plis, en quantité limitée, sont très prisés des collectionneurs.

Enfin, de temps en temps, des soirées "signatures" d'enveloppes sont organisées. Certains philatélistes souhaitent avoir les tampons des hivernants paraphés par ces derniers.
http://ilescrozet.blogspot.fr/2014/02/la-gerance-postale-de-la-base-alfred.html
Merci au chef de District et au GP pour ce reportage

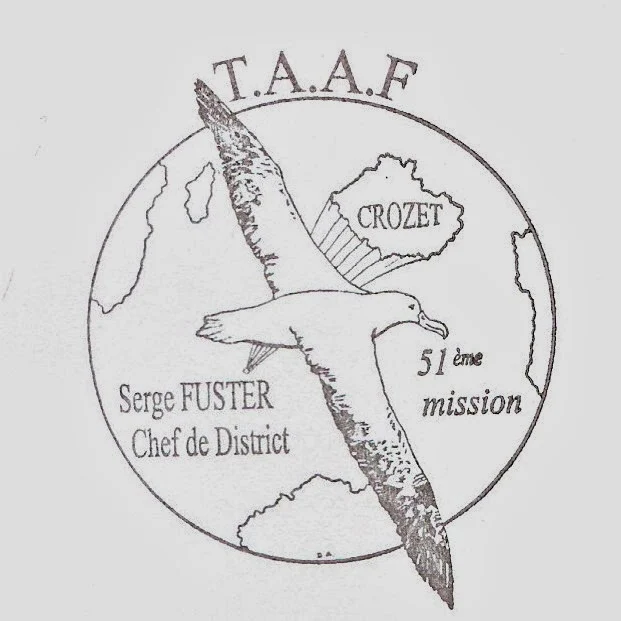





+Le%CC%81opold+HILY+(dernier+rang+2e%CC%80me+a%CC%80+gauche)+a%CC%80+Casablanca+(1940)+.jpg)