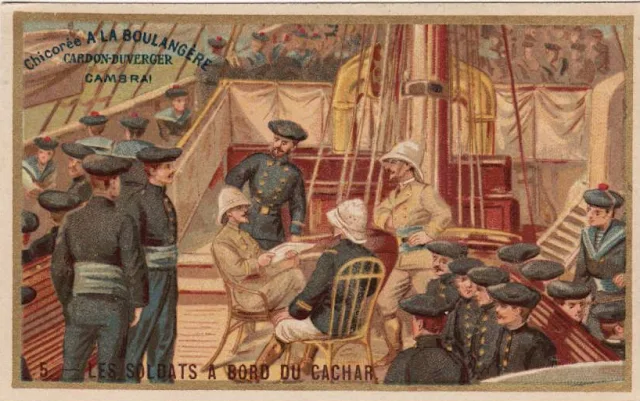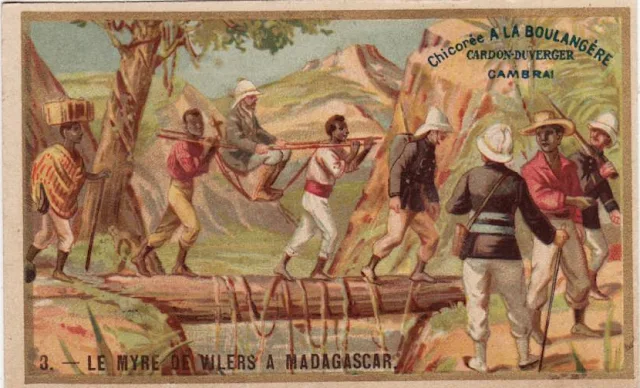Pli posté à l'occasion du congrès philatélique de Nancy du 10 au 12 juin 2011 TAD des Kerguelen du 30-06-2011. Signature de Madame Claude Perchat.
Feuilles de 18 timbres + 18 vignettes à l'effigie de Pierre Bignon.
- Format du timbre 26 x 80 mm.
Le manchot papou mesure entre 76 et 81 cm. Malgré cela, ce n'est pas le plus petit des manchots. Il pèse entre 4,5 et 8,5 kg. Son plumage est blanc sur le ventre et noir sur le dos. Il possède un bec orange fin, allant au noir au bout.
Le territoire des TAAF nous propose un nouveau timbre consacré aux manchots papous d’une valeur faciale de un euro, émis en feuille de 18 timbres. Il a été dessiné par Madame Claude Perchat. Ce tarif correspondra, le premier juillet, à la fois au tarif de la lettre de 20 à 50 g vers la France et au tarif pour la lettre jusqu’à 20 g postée depuis les TAAF vers le reste du monde. Le tirage est de 4 000 feuilles soit 72 000 timbres.
Sur une vignette attenante à chaque timbre figure le portrait de Pierre Bignon, fondateur, il y a quarante ans, de la SATA (Section Antarctique et Terres Australes de l’Association Philatélique de Metz) et premier président de la SFPP-SATA qui est devenue UFPP-SATA par la suite.