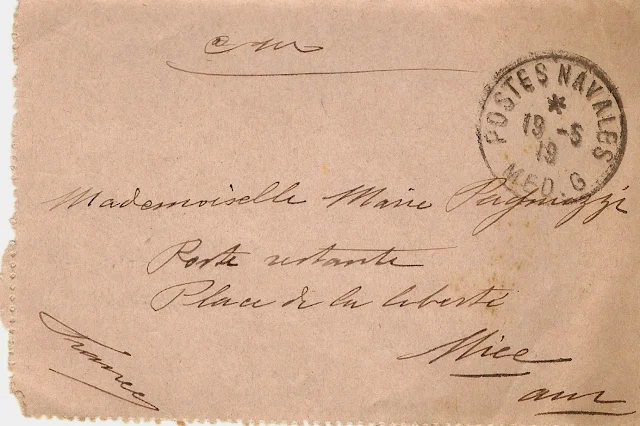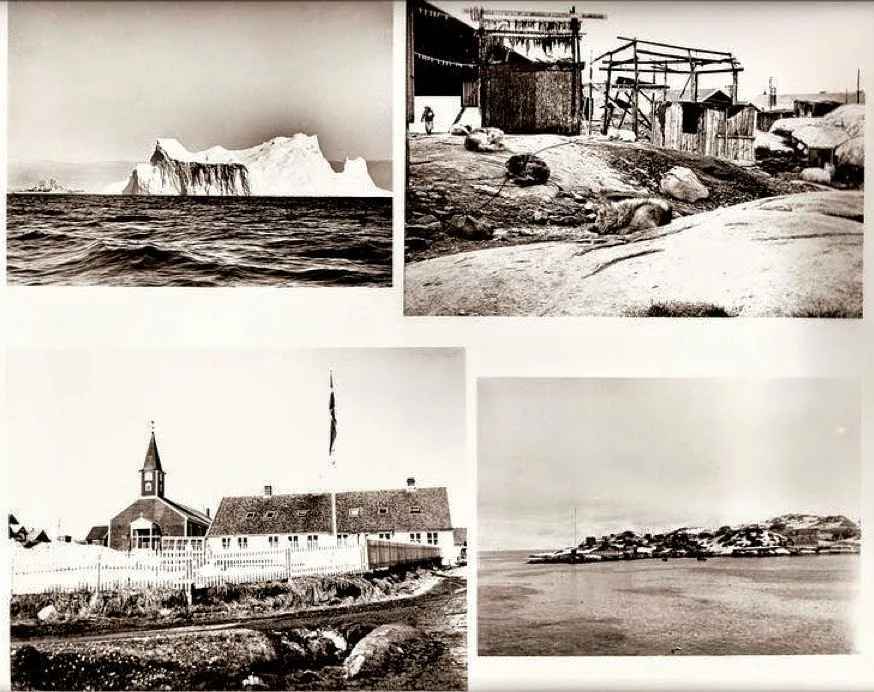Chantier Tramasset
Le Tourne / Langoiran
 |
| Un clin d'oeil aux recettes de Tante Jeanne Merci Rosine |
De passage en Gironde, mes hôtes m'ont fait découvrir quelques aspects du fleuve près duquel ils vivent et la renaissance d'un chantier naval, sachant que quelques jours avant, La Jeanne (Q860) arrivait à la cale sèche du chantier de Bassens.
 |
| enveloppe du jour de l'arrivée de la Q 860 à Bassens 14-10-2014 |
Le problème de la mémoire c'est l'oubli… et le temps. Les choses se font et se défont, les jours passent, les mois les années et sous le pont Eiffel coule la Garonne.
 |
| Le pont de l'Estey au Tourne (33) photo © JM bergougniou |
et dans la vase finissent de mourir quelques péniches ou automoteurs.
 |
| Epave photo © JM bergougniou |
Si on parle souvent des chantiers pour évoquer la Royale ou la Marine d'Etat par ses arsenaux, on évoque moins souvent la construction des bateaux qui assuraient le service du fleuve, ceux qui amenaient fûts et barriques à Bordeaux, le bois de chauffage pour les maisons ou les briqueteries ou les tuileries, ceux qui plus petits servaient les deux ou trois ponts, ceux qui permettaient de passer le fleuve.
 |
| LOGO photo © JM bergougniou |
L’ancien chantier naval Tramasset existait depuis 1837. Il faisait partie des 6 chantiers du Tourne et de Langoiran qui construisaient des yoles, des filandières des coureaux, des gabares et des sapines pendant la période où les bateaux en bois assuraient le transport sur la Garonne.
 |
| Les chantiers Tramasset photo © JM bergougniou |
C'est dans les années 1837 que ce chantier naval s'installe au Tourne, en bordure de la Garonne, près du port de Langoiran. Dans les années 1850, Pierre Tramasset rachète le chantier, crée et développe son entreprise de construction et de restauration de bateaux. L'activité décline, puis le chantier naval cesse son activité en 1983. Le site racheté par la commune et prêté à une association a relancé les activités de restauration navale depuis 1997.
DRAC Gironde
 |
| le hangar photo © JM bergougniou |
Cette entreprise florissante a employé jusqu’à 40 ouvriers dans les années 30. En déclin depuis le début des années 60, Les Chantiers Tramasset seront finalement fermés en 1985 et laissés à l’abandon.
 |
| photo © JM bergougniou |
La mairie du Tourne décide alors de racheter les bâtiments et l’association Les Chantiers Tramasset est créée en 1997 pour faire revivre ces lieux historiques.
 |
| photo © JM bergougniou |
Le patrimoine fluvial du secteur est en friche, il n’existe pas de bateau historique d’ampleur capable de transporter des passagers.
Les bords de Garonne sont fréquentés par de nombreux promeneurs, qui ne trouvent pas ou peu d’activités leur permettant de découvrir le fleuve et son histoire.
 |
| Ancre deux mers (jeu de mot) photo © JM bergougniou |
L’association les Chantiers Tramasset souhaite proposer une navigation à bord d' « un bateau à passager affecté à la découverte de la Garonne, Dordogne et Gironde entre Castets en Dorthe et Le Verdon ».
 |
| photo © JM bergougniou |
Il devra donc pouvoir naviguer en eaux intérieures et fluvio-maritimes. Sa zone «naturelle» sera plus sûrement celle que fréquentaient les anciens couraux-sloups : la Garonne jusqu’à Castets, la Dordogne jusqu’à Castillon, l’estuaire de la Gironde.
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
Les couraux étaient des bateaux qui transportaient des marchandises et/ou des matériaux sur le fleuve.
Ils constituaient une famille de bateaux à étrave et tableau arrière, à fond plat et flancs évasés, pontés ou semi-pontés à l’exclusion des plus petits de la famille.
 |
| photo © JM bergougniou |
On trouve :
- Les couraux de Dordogne, long de 24m environ pour 4,50m de large
- Les couraux de l’Isle plus petits, longs de 21m environ pour 4,45m de large.
Ces deux types ne se différenciaient que par leur taille liée aux dimensions respectives de la Dordogne et de l’Isle. Ils étaient grées d’une grand voile au tiers et, pour manœuvrer, d’une petite voile au tiers de « tape cul » doublée parfois d’une même voile placée sur l’étrave.
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
Les couraux de Gironde, plus courts, (18m de long étant quasiment la norme), et plus large (6m et plus). Leurs flancs étaient beaucoup plus évasés. Il s’agissait de l’adaptation du type à la navigation en estuaire. Leur gréement était « modernisé », avec une grand voile à corne, parfois surmontée d’un flèche et un foc sur guibre et beaupré. Le foc était équilibré sur l’arrière par un petit « tape cul » au tiers placé sur le tableau. Leur mât était à bascule afin de passer sous les ponts.
 |
| photo © JM bergougniou |
Repris en 1837 par Pierre Tramasset, ils se composent d'un «Petit chantier» destiné à la construction des bateaux en bois et d'un «Grand chantier» pour la réparation des bateaux plus importants.
 |
| photo © JM bergougniou |
Ces deux éléments sont reliés à la Garonne par des cales munies de rails permettant de hisser les bateaux.
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
une cale de construction ou slip-way en anglais permet d'amener les bateaux sous le hangar du chantier
photo © JM bergougniou |
la cale de construction (en anglais slipway) à l'aide de rails est destinée à mettre à l'eau ou à haler à sec dans le cadre de la réparation ou de la construction navale
 |
| photo © JM bergougniou |
Il peut être « en long », c'est-à-dire perpendiculaire au rivage, ou « en travers », c'est-à-dire parallèle au rivage.
 |
| photo © JM bergougniou |
Le bateau alors qu’il flotte encore est pris en charge au bas du plan incliné par une structure mobile, le ber, qui le transportera sur des rails hors de l’eau. Le navire est positionné sur le ber par rapport à la ligne de tins longitudinale sur lequel il va reposer : d’abord la proue puis progressivement toute la quille. En même temps, afin d’éviter tout basculement latéral, des clés de serrage sont mises en place le long des flancs du navire. Le navire étant enfin solidaire du ber, un treuil hissera l’ensemble hors de l’eau.
 |
| photo © JM bergougniou |
Une souille est creusée vers le fleuve, des rails sont posés.
Les berges de la souille sont protégées par une construction rudimentaire de rondins de bois et par la végétation naturelle qui pousse sur les bords
 |
| tunnel de séchage photo © JM bergougniou |
 |
| Etuve photo © JM bergougniou |
A cet ensemble s'ajoute une étuve pour le cintrage des bois par imprégnation de vapeur d'eau.
Un four chauffe de l'eau et produit de la vapeur. La vapeur est récupérée et éventuellement surchauffée passe dans un compartiment (l'étuve) où sont placées les pièces de bois à former.
Avec la chaleur et l'humidité, il devient "facile" de cintré le bois et de lui donner la forme voulue.
 |
| photo © JM bergougniou |
Une scierie est installée vers 1900, puis l'usine est électrifiée.
Les chantiers cessent leur activité en 1983. Après quelques années d'abandon, le site est racheté par la commune et prêté à l'association «Les chantiers Tramasset» qui après remise en état du chantier a relancé des activités de réparation navale (la gabare l'»Audiernais» classée parmi les monuments historiques a été restaurée par les chantiers en 1998)
 |
| le four à bois qui permet de chauffer l'eau et de produire la vapeur photo © JM bergougniou |
 |
| Le four en brique photo © JM bergougniou |
 |
| le séchage du bois pouvait se faire sur le côté du four photo © JM bergougniou |
 |
| L'étuve photo © JM bergougniou |
Comparé à celui des gabares, leur faible tirant d’eau présentait un avantage décisif.
La gabare, bateau en forme et à quille avait pour une capacité de charge équivalente, un tirant d’eau supérieur de 1m. Cela n’était pas gênant dans le port de Bordeaux mais l’était à l’amont ou les « maigres » étaient nombreux. Cela l’était aussi pour accéder aux nombreux petits ports implantés sur des esteys comme celui de Langoiran qui n’étaient en eau que quelques heures par jour.
 |
| photo © JM bergougniou |
Pourquoi l’Henriette ?
Le choix de l’Henriette est compréhensible, il est le dernier courau-sloup à avoir travaillé sur Langoiran (jusque vers 1970). Son souvenir reste vivace. C’est avec lui qu’un lien peut le plus aisément être renoué.
Ce choix appelle néanmoins plusieurs observations.
 |
| photo © JM bergougniou |
D’une part, l’Henriette, au long de ses 60 ans d’exploitation commerciale a subi de nombreuses transformations. D’autre part, ses plans, s’ils existent ne nous sont pas connus.
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
 |
| photo © JM bergougniou |
Le plan de forme retenu est celui du Roger Martha, pour des raisons sentimentales (il a fait l’objet d’un relevé de forme par Raoul Tramasset) mais aussi pour une raison technique : Georges Chourrier, membre de l’association et qui a travaillé dans les années 50 sur l’Henriette juge que cette dernière avait une muraille verticale, ce qui est le cas du Roger Martha.
Merci les amis pour cette belle ballade et au chantier Tramasset pour l'accès au site.
 |
photo © JM bergougniou
|