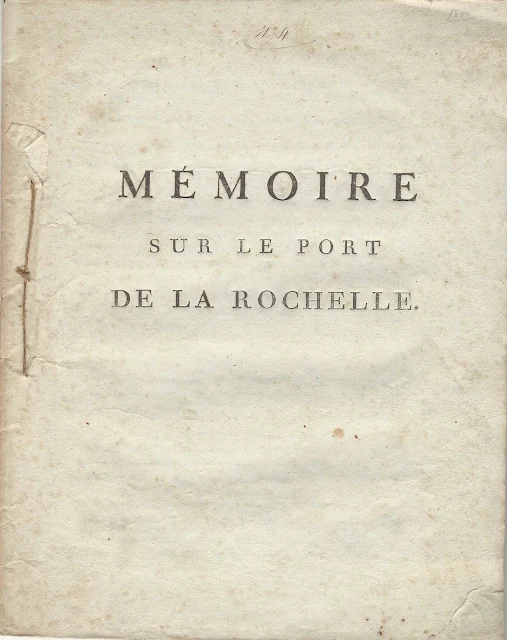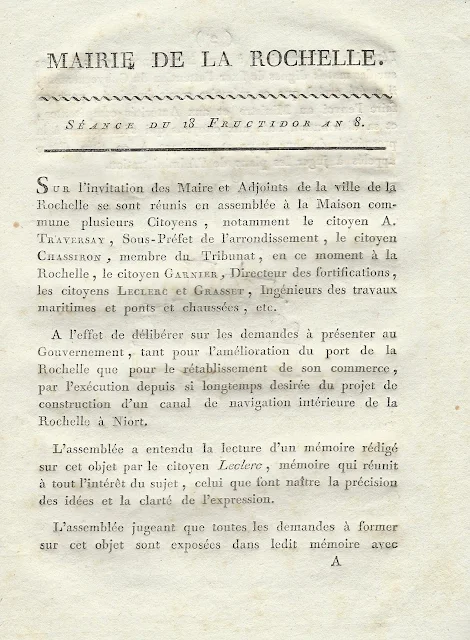Mémoire sur le port de la Rochelle 18 fructidor an 8
C'est l'achat à Denis Duet, chineur hors-pair d'une brochure du 18 fructidor AN 8 qui me donne l'occasion de parler du port de la Rochelle, de Richelieu et de l'aménagement du Canal de La Rochelle à Niort.
Ce port, dernière place de sûreté des huguenots, reçoit de la mer l’aide des Anglais, prompts à intervenir lorsqu’il s’agit de mettre en péril le pouvoir de leur grand rival. La principale crainte de Richelieu est que cette place forte devienne une sorte de bastion d’où les protestants, aidés financièrement par l’Angleterre, pourraient mettre en péril le pouvoir royal et étendre leur influence à l’ensemble du territoire. Il déclare : « il faut couper la tête du dragon ». Sa décision est donc prise : il faut prendre sans tarder La Rochelle.
La Rochelle est soutenue par l'Angleterre en tant que ville protestante, mais aussi pour freiner le développement de la marine française. George Villiers, duc de Buckingham (orthographié en français de l'époque « Bouquingan ») quitte le port de Portsmouth (que le cardinal appelle « Porsemus » dans ses Mémoires) avec 110 vaisseaux et 8 000 hommes, et débarque sur l'île de Ré le 12 juillet 1627. Informé, Richelieu réagit immédiatement. Il débute le siège de la ville et fait fortifier les îles de Ré et Oléron. L’armée royale déploie quant à elle ses 20 000 hommes autour de la ville, coupant toutes les voies de communication terrestres. Le ravitaillement ne peut plus venir que de la mer.
Le commerce est alors bloqué.
Richelieu entreprend le 30 novembre la construction par 4 000 ouvriers d’une digue longue de 1 500 mètres et haute de vingt. Les fondations reposent sur des navires coulés et remblayés. Des canons pointés vers le large sont disposés en renfort
Les vivres commencent à s’épuiser, et les navires anglais venus en soutien sont contraints de rebrousser chemin. La décision est alors prise, comme à Alésia, de faire sortir de la ville les « bouches inutiles ». Sont ainsi expulsés femmes, enfants et vieillards. Tenus à distance par les troupes royales, qui n’hésitent pas à faire feu sur eux, ils errent pendant des jours sans ressources et décèdent de privation.
Une deuxième, puis une troisième expédition anglaise échouent, malgré des tirs nourris. Les Rochelais sont contraints de manger chevaux, chiens, chats… Lorsque la ville finit par se rendre, il ne reste que 5 400 survivants sur les 28 000 habitants. Louis XIII leur accorde son pardon. Ils doivent néanmoins fournir un certificat de baptême, et les murailles sont rasées.
La capitulation est inconditionnelle. Par les termes de la paix d'Alès du 28 juin 1629, les huguenots perdront leurs droits politiques, militaires et territoriaux, mais conserveront la liberté de culte garantie par l'édit de Nantes.
Début 1793 la République annonce la reprise de la guerre de la course, c’est-à-dire le recours aux corsaires. De 1796 à 1802, le port de La Rochelle arme une douzaine de corsaires qui vont écumer les mers durant tout le Premier Empire.
 |
| le phare du bout du monde La Rochelle photo JM Bergougniou |
La capitulation est inconditionnelle. Par les termes de la paix d'Alès du 28 juin 1629, les huguenots perdront leurs droits politiques, militaires et territoriaux, mais conserveront la liberté de culte garantie par l'édit de Nantes.
Début 1793 la République annonce la reprise de la guerre de la course, c’est-à-dire le recours aux corsaires. De 1796 à 1802, le port de La Rochelle arme une douzaine de corsaires qui vont écumer les mers durant tout le Premier Empire.
Les guerres napoléoniennes, qui voient le Royaume-Uni s’assurer la maîtrise des mers et l’empereur Napoléon Bonaparte imposer le blocus continental, entraînent une réduction très importante du commerce maritime, et la ruine de La Rochelle, qui ne reviendra sur le devant de la scène qu’au cours du 20e siècle, à la faveur du développement de
l’industrie et du tourisme.
Le 6 août 1808, l’empereur visite la ville qui fait tirer des coups de canon en son honneur. Le 19 mai 1810, il signe un décret transférant la préfecture de Saintes à La Rochelle à compter du 1er juillet 1810.
Le canal de Marans à La Rochelle est par définition un canal de jonction par dérivation (de la Sèvre Niortaise vers l'océan). Il est par sa longueur le second canal de Charente-Maritime, après celui de la Charente à la Seudre.
Le canal de Marans à La Rochelle est par définition un canal de jonction par dérivation (de la Sèvre Niortaise vers l'océan). Il est par sa longueur le second canal de Charente-Maritime, après celui de la Charente à la Seudre.
Le projet a été lancé sur décision impériale de Napoléon 1er, en 1805 (décret du 28 messidor an XIII).
À l'origine, le canal devait relier Niort dans les Deux-Sèvres à La Rochelle, soit 44 kilomètres (voir carte de Cassini). Il fait partie du projet d'établir une liaison navigable Nord-Sud, de la Loire à l'estuaire de la Gironde.
Les travaux devaient s'étendre sur 5 années.

Contrairement au projet initial, seule la section La Rochelle à Marans sera creusée, soit 24 kilomètres. Les travaux vont s’échelonner de 1806 à 1888, mais le canal sera mis partiellement en service en 1875. C'est seulement en 1888 que le canal est relié au bassin extérieur ou bassin à flot via le bastion Saint-Nicolas. Le port du canal servira de piscine d'été et de lieux aux exercices militaires. Il a été comblé récemment. Le canal est toujours connecté au vieux port de La Rochelle via le canal Maubec.

Les délais prévisionnels furent largement dépassés principalement pour des difficultés techniques et judiciaires :
Le percement du tunnel Saint-Léonard qui fut creusé et achevé après 1850 duré beaucoup plus longtemps que prévu, à cause d'un calcaire très dur ;
La partie nord du canal (un tiers de sa longueur) traverse des marais. Il a donc fallu construire de nombreux ouvrages (ponts-siphons) qui permettaient un libre écoulement des eaux du marais et rendaient le canal indépendant ;
Autour de Dompierre-sur-Mer, le creusement du canal a provoqué l'assèchement de nombreux puits (déblais important à cet endroit). La colère des habitants aboutit à un procès, obligeant le concessionnaire à approfondir les puits