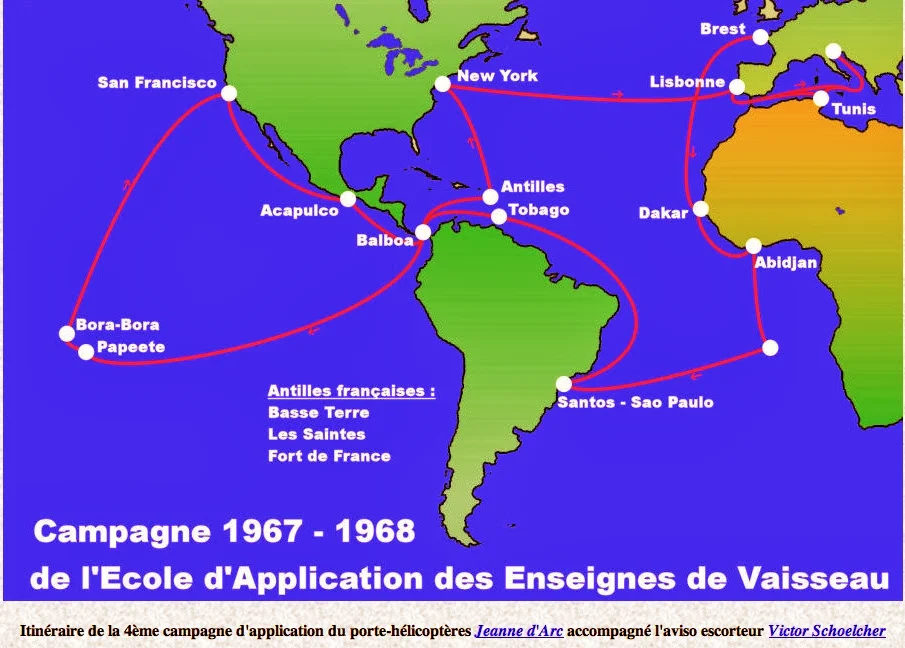PH Jeanne d'Arc
13 février 1973 Vancouver
 |
| Pavillon du Canada photo JM Bergougniou |
J'ai eu l'occasion de séjourner deux fois à Vancouver. C'est une ville très agréable.
 |
| Ville de Vancouver photo JM Bergougniou |
C'est une ville cosmopolite, ouverte sur le monde (principalement l'Asie) et sur le maintien de la tradition des peuples premiers.
Les parcs et musées sont nombreux et divers.
 |
| Escale à Vancouver le 13-2-1973 |
Fondée en 1867 en tant que zone d'exploitation forestière, Vancouver devient officiellement une ville en 1886 et a été nommée ainsi en hommage au capitaine de marine britannique George Vancouver qui a exploré la région vers la fin du xviiie siècle.
 |
| Georges Vancouver à Victoria BC photo JM Bergougniou |
En 1887, le chemin de fer transcontinental a été étendu jusqu'à la ville pour profiter de son grand port naturel, qui est rapidement devenu un maillon essentiel d'une route commerciale entre l'Est du Canada, l'Orient et Londres.
La GRC est le seul corps policier au monde à posséder des mandats d'application de la loi aux niveaux international, national, provincial et municipal, et cela sans être le seul corps policier du pays. En Ontario et au Québec, elle est dite non-contractuelle et a le mandat d'appliquer uniquement les lois fédérales, car ces deux provinces disposent de leur propre corps de police provincial : la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec. Ailleurs, elle opère sous contrat pour faire respecter les lois provinciales en plus du mandat national.
 |
| Canadian Pacific photo JM Bergougniou |
En 2009, Port Metro Vancouver est le port le plus grand et le plus achalandé du Canada, et le plus diversifié en Amérique du Nord. Même si l'exploitation forestière demeure sa plus grande industrie, Vancouver est réputée pour être un centre urbain entouré par la nature (montagnes et océan Pacifique), faisant du tourisme sa deuxième industrie.
 |
| Musée ethnographique de Vancouver photo JM Bergougniou |
Les studios de production cinématographique de Vancouver et de Burnaby ont fait de la métropole l'un des plus grands centres cinématographiques en Amérique du Nord, ce qui lui a valu le surnom de Hollywood North.
La conserve était le Victor Schoelcher
La Gendarmerie royale du Canada ou GRC (en anglais : Royal Canadian Mounted Police, abrégé en RCMP) est à la fois la police fédérale du Canada et la police provinciale de la plupart des provinces canadiennes. Les Canadiens français la désignent souvent par l'appellation générique de « police montée » et les Canadiens anglais par mounties ou red coats (« les manteaux rouges », en raison de leur uniforme rouge).
La conserve était le Victor Schoelcher
 |
| Arts premiers Musée ethnographique photo JM Bergougniou |
La Gendarmerie royale du Canada ou GRC (en anglais : Royal Canadian Mounted Police, abrégé en RCMP) est à la fois la police fédérale du Canada et la police provinciale de la plupart des provinces canadiennes. Les Canadiens français la désignent souvent par l'appellation générique de « police montée » et les Canadiens anglais par mounties ou red coats (« les manteaux rouges », en raison de leur uniforme rouge).
La GRC est le seul corps policier au monde à posséder des mandats d'application de la loi aux niveaux international, national, provincial et municipal, et cela sans être le seul corps policier du pays. En Ontario et au Québec, elle est dite non-contractuelle et a le mandat d'appliquer uniquement les lois fédérales, car ces deux provinces disposent de leur propre corps de police provincial : la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec. Ailleurs, elle opère sous contrat pour faire respecter les lois provinciales en plus du mandat national.